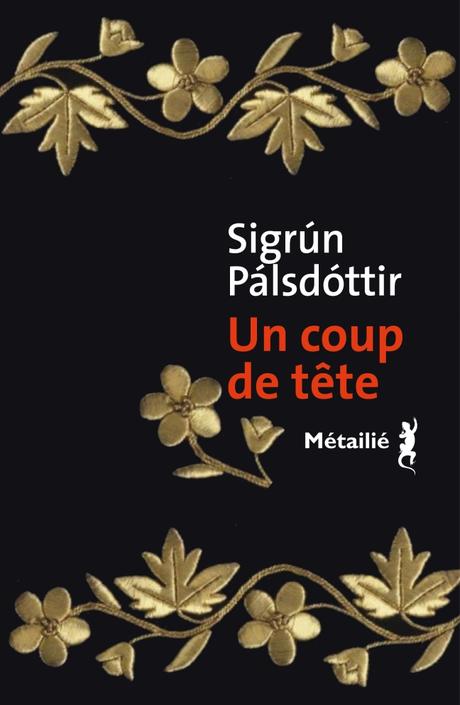


Prix de littérature de l’Union Européenne – 2021
En deux mots
Sigurlina ne supporte plus sa vie étriquée à Reykjavik et, après une agression sexuelle, décide de fuir le pays. Si elle trouve rapidement un emploi à New York, de tragiques circonstances vont la mener à la rue. Commence alors un difficile combat pour survivre.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
La fuite vers New York
En retraçant le parcours de Sigurlina qui, à la fin du XIXe siècle a fui Reykjavik pour New York, Sigrún Pálsdóttir réussit un roman qui mêle l’histoire et l’aventure aux sagas islandaises, sans omettre d’y ajouter une touche féministe.
Nous sommes à Reykjavik en 1896. Sigurlina y vit avec son père qui, après le décès de son épouse, se consacre presque exclusivement à ses collections. Au musée des Antiquités il passe son temps «au milieu de son fatras à répertorier les trouvailles qu’on lui apporte et qu’il s’efforce d’exposer pour les voyageurs étrangers.» Il en oublie sa fille qui n’a qu’à se consacrer à ses travaux d’aiguille et à trouver un bon parti.
Mais Sigurlina s’est forgé un fort caractère et entend mener sa vie comme elle l’entend. Elle est curieuse, aime lire et écouter les conversations, y compris lorsqu’elles ne lui sont pas destinées. Et elle a repéré un jeune rédacteur ambitieux. Mais ce dernier est promis à une autre. Alors, après avoir été troussée par un vieux sadique, elle décide de rassembler ses affaires, s’empare d’une fibule dans la collection de son père et prend le premier bateau vers l’Écosse, puis vers New York. Dans ses bagages, elle a aussi la lettre d’un important collectionneur que son père avait accueilli et guidé en Islande. Un courrier qui sera tout à la fois son sauf-conduit et sa lettre d’embauche. Installé dans une belle demeure, elle devient rapidement la secrétaire particulière de cet érudit. Mais, en voulant attraper un volume de sa bibliothèque, il fait une chute mortelle. Et voilà Sigurlina à la rue. Elle va parvenir à trouver un toit et un emploi de couturière, mais le destin va s’acharner contre elle. Un incendie détruit son immeuble et ses maigres biens. Dans la poussière et les cendres, elle parvient cependant à récupérer la fibule, se disant qu’elle pourrait peut-être en tirer un bon prix. Je vous laisse découvrir comment l’objet sera exposé au Metropolitan Museum avant de connaître des péripéties dignes des sagas islandaises, dont on finit du reste à l’associer.
On ne s’ennuie pas une seconde dans ces multiples pérégrinations qui, après avoir pris un tour dramatique vont virer au tragicomique. Et nous rappeler que l’Histoire n’a rien de figé, qu’elle se construit sur des récits plus ou moins authentiques, qui enflamment les imaginaires. Et à ce petit jeu Sigrún Pálsdóttir fait merveille, en retrouvant les recettes du roman populaire, en construisant son livre comme un feuilleton à rebondissements dans lequel chaque chapitre contient son lot de surprises. Bref, c’est un bonheur de lecture!
Un coup de tête
Sigrún Pálsdóttir
Éditions Métailié
Roman
Traduit de l’islandais par Éric Boury
192 p., 19 €
EAN 9791022612395
Paru le 20/01/2023
Où?
Le roman est situé en Islande, à Reykjavik et aux Etats-Unis, à New York. La traversée se fait avec une étape à Glasgow.
Quand?
L’action se déroule durant les dernières années du XIXe siècle.
Ce qu’en dit l’éditeur
À la fin du XIXe siècle, à Reykjavík, un veuf excentrique élève sa fille pour tenir la maison, cuisiner, broder (elle y révèle un talent rare), mais aussi l’aider à cataloguer ses recherches archéologiques islandaises. C’est sans compter sur les rêves de voyage et l’esprit d’indépendance de la jeune fille.
Elle décide sur un coup de tête de partir pour New York proposer ses compétences à un collectionneur en emportant avec elle un objet unique et inestimable. Un malheureux hasard la conduit dans un atelier de couture des bas-fonds de Manhattan. Elle nous surprendra grâce à sa ténacité et son intelligence.
Un court roman efficace et passionnant, une tragicomédie sur la préservation de l’héritage culturel, un texte sur les coïncidences qui déterminent les destins autour d’un personnage attachant et déroutant qui suit sans faille son chemin vers la liberté.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Voyage dans les lettres nordiques
Blog Lyvres
Blog Thé toi et lis
Blog Baz’Art
Sigrún Pálsdóttir présente son roman Coup de tête (en anglais) © Production EUPL Prize
Les premières pages du livre
Le bruit montait du salon. Des sonorités étranges. Un instant, ne comprenant pas un mot des paroles échangées, je crus que je rêvais. Puis j’entendis les ronflements discrets de grand-mère à mon côté et je compris que j’étais éveillée. Je me redressai dans le lit pour enjamber son corps frêle, me faufilai à travers la grande pièce commune sous les combles et m’allongeai sur le sol, le visage tourné vers la cage d’escalier. À travers la fumée de tabac qui flottait dans la pièce, je distinguais un homme d’âge mûr assis sur le canapé à côté d’une jeune femme. Il portait une veste brune et un foulard bleu, elle, un manteau vert et un chemisier clair orné d’un col en dentelle à la racine de son cou gracile, sous son menton. Le vieux Magnus était assis sur le tabouret en face des invités tandis que Gudlaug, debout, la cafetière à la main, remplissait les tasses. Mon père était installé dans le fauteuil sous la fenêtre et ma mère sur le coffre juste à côté, légèrement à l’écart de la fumée et du monologue du visiteur, interrompu par une remarque de la jeune femme au col en dentelle qui montra sa tasse du doigt. Elle semblait s’adresser à ma mère qui hocha la tête avec un sourire. Mais ce sourire ne m’était en rien familier, en réalité maman, adossée au mur du salon, avait un air étrange et le dos étonnamment voûté. Elle se redressa légèrement tandis que mon père prononçait quelques mots dont je compris qu’ils étaient la réponse aux questions de l’étrangère. Puis les invités se levèrent, ils prirent congé, et Magnus et mon père les raccompagnèrent à la porte. Voilà qui me permit de mieux distinguer les vêtements de la jeune femme, son ample robe longue qui s’évasait en partant de sa taille de guêpe et tourbillonnait sur son passage tandis qu’elle avançait dans le salon. Je me relevai, enjambai à nouveau grand-mère et fis semblant de dormir quand maman vint me caresser la joue. Elle me posa l’index sur le bout du nez et comprit que je ne dormais pas.
Le lendemain matin, personne ne fit état de la visite de la veille et je ne posai aucune question. Je n’éprouvais d’ailleurs pas le besoin d’en savoir plus. Le souvenir de ces senteurs exotiques me suffisait amplement, de même que l’image des hôtes dont la présence semblait avoir agrandi l’espace de notre salon. Je ne passais cependant pas le plus clair de mon temps à penser à ces étrangers élégants et, en réalité, j’avais presque oublié leur visite un jour que j’aidais ma mère à faire le ménage, jour où je découvris une image pleine de couleurs posée au sommet de la pile d’enveloppes que mon père n’avait pas ouvertes sur son bureau. C’était une carte postale. Je reposai mon chiffon pour l’examiner en la prenant à deux mains :
Le soir tombait sur une grande ville, les rues blanchies renvoyaient la lumière et des flocons étrangement épais descendaient vers la terre. Une petite fille entraînait sa mère vers la devanture d’un magasin pour lui montrer un grand renne, un homme en haut-de-forme noir, vêtu d’un manteau à col de fourrure, portait un paquet volumineux et tenait sa femme par la main. Derrière eux, un adolescent traînait un gros arbre de Noël et, de l’autre côté de la rue, des garçons faisaient des boules de neige pour les lancer sur le fiacre noir vernissé qui passait. Chacun avait une foule de choses à faire, mais se retrouvait figé dans sa course. Tous, sauf la jeune femme dans le coin à droite, qui semblait s’être immobilisée juste avant cet instant, et dont on ignorait si elle s’apprêtait à traverser la rue ou à continuer son chemin sur le trottoir. Vêtue d’un manteau bleu marine et d’un élégant chapeau rouge, elle protégeait ses mains du froid dans un manchon en cuir brun qu’elle serrait contre elle. Son visage était plus net que les autres détails de l’image : elle semblait perdue.
J’étais en train de me demander si elle était seule quand je sentis tout à coup la présence de ma mère derrière moi. Elle pencha la tête et posa le menton sur mon épaule pour regarder la carte. Du coin de l’œil, je la vis sourire en disant que ce courrier arrivait avec un certain retard. Puis elle se redressa et se remit au travail. Je retournai la carte adressée à Brandur Johnson. En haut, à droite, on lisait : New York, le 15 décembre 1879. L’écriture avait quelque chose de brouillon et, évidemment, je ne comprenais rien. Mais je pensais connaître l’expéditeur de cette carte.
Plus tard dans la journée, face à mon insistance, mon père consentit à me l’offrir. Je la rangeai dans le coffre que j’avais au pied de mon lit, où je pouvais la prendre quand j’avais du mal à trouver le sommeil après ma lecture du soir. Et, même au plus noir de la nuit de l’hiver 1880, je parvins encore à voir l’image en la maintenant assez longtemps devant mes yeux. Plongée dans les ténèbres, je distinguai en réalité des détails que je n’avais pas remarqués auparavant : au fond d’une étroite ruelle tapissée de neige, deux hommes chaudement vêtus se tenaient l’un face à l’autre en grande conversation. Plus je scrutais la carte, plus il me semblait que toute leur attention se concentrait sur la jeune femme au chapeau rouge. Désormais, j’avais l’impression que le désespoir qui envahissait son visage s’expliquait par le poids de leur regard, elle cherchait à savoir si elle devait se mettre à l’abri, ou si ce poids s’évanouirait.
Ma main retomba. La carte atterrit sur la couette et, aussitôt, la jeune femme au chapeau rouge traversa la rue, enjambant le MERRY CHRISTMAS en grandes lettres dorées en haut à droite de l’image, avant de s’échapper du cadre. Au même moment, les deux hommes se mirent en route et lui emboîtèrent le pas. Ils ne couraient pas, mais franchirent la chaussée à grands pas, traversèrent brutalement le Joyeux Noël, s’évanouissant lorsque j’entendis les craquements de l’escalier. Je sursautai et, dans ma torpeur, j’eus l’impression de voir grand-mère s’approcher du lit en boitant. Allongée, les yeux fermés, je cherchai la carte à tâtons et la glissai sous la couette. Grand-mère se coucha, je me tournai de l’autre côté. Et avant que ses ronflements discrets ne parviennent à m’enfermer dans le monde exigu de la pièce que nous partagions sous les combles, je m’engouffrai en chemise de nuit dans l’étroite ruelle où je suivis sur la neige blanche les deux hommes et la jeune femme qu’ils avaient prise en chasse.
I
Fin de réception à Reykjavik. Mars 1897
– Quant à cette boucle de ceinture finement ornementée, elle a souhaité l’acquérir pour la somme de quinze mille dollars américains. Auprès de sa propriétaire, une jeune Islandaise dénommée Branson. Miss Selena Branson.
Le Gouverneur se lève de son fauteuil et s’avance vers la fenêtre du salon. Il regarde le vol suspendu des flocons et la place Lækjartorg toute blanche de neige qui apporte un peu de lumière à la nuit sans fond :
– Eh bien, je vous demande, mes chers amis, s’il ne s’agit tout simplement pas là de Sigurlina Brandsdottir, la fille de Brandur Jonsson l’Érudit, le copiste de Kot dans le Skagafjördur.
Alors ça, c’était la cerise sur le gâteau ! Et ladite cerise laissait les invités du plus haut représentant du roi en Islande plus que dubitatifs. “Quelle absurdité !” tonna le Juge ; “Seigneur, non !” s’écria le Pasteur ; “Le petit bouchon de Brandur ?” se récria le Préfet ; “Le tout petit bouchon”, ricana le Poète ; “Un bouchon ?” claironna l’Historien ; “Quinze mille dollars ? s’étrangla le Trésorier du roi. Comment un objet aussi petit et aussi vieux pourrait-il avoir une telle valeur ? Une somme qui correspond à la quasi-totalité des réserves de la Banque nationale d’Islande ?”
Mais le septième invité, le Rédacteur en chef aussi svelte que bel homme, n’a aucune réaction. Il est assis légèrement à l’écart, tout près du mur, penché en avant, le regard concentré sur un détail du tapis d’Orient tissé main qui recouvre le parquet de ce salon d’apparat. Il essaie de se remettre en mémoire le visage d’une jeune fille, mais ne voit rien d’autre qu’un corps gracile enveloppé d’une robe aérienne retenue à la taille par une ceinture ornementée, une jolie poitrine sur laquelle retombent de fines mèches blondes et un col carré brodé au fil d’or dessinant un motif grec. Un ruban noir autour du cou et un bandeau doré sur la tête. Enfin, son visage lui apparaît. Il voit d’abord des lèvres fines qui esquissent un sourire, un nez élégant, légèrement épaté, puis des narines. La jeune fille les pince, comme pour essayer de retenir un rire, de maîtriser son énergie et sa vigueur. Ses yeux sont dissimulés derrière un masque noir, mais il les voit tout de même. Bleu d’eau derrière leurs paupières lourdes, soulignés de légers cernes. Un regard enjôleur qui le rend fou de désir, si bien qu’il sursaute, murmure le nom de Sigurlina, se redresse et se rend compte que tous le fixent d’un air inquisiteur : le Gouverneur, le Juge, le Pasteur, le Préfet, le Poète, l’Historien, le Trésorier du roi. Était-il censé dire quelque chose?
Le jeune homme recule et s’adosse à l’épais mur de cette ancienne prison au plafond bas devenue résidence officielle, bâtiment que certains qualifient de bicoque. Le Rédacteur a presque disparu derrière la plante tropicale chétive installée contre la paroi, au plus près de la porte laquée de blanc par laquelle on accède au salon. De l’autre côté du battant, l’oreille collée au bois, se trouve la servante, une grande femme imposante. Elle tient d’une main une carafe vide, son autre main plaquée sur la bouche. Voyant que les invités du Gouverneur n’ont plus aucun commentaire à faire sur l’histoire qu’il vient de raconter et qu’ils ne semblent guère désireux de répondre à sa question, elle recule lentement mais résolument. Puis elle longe le couloir, le pas rapide et décidé, et entre dans la cuisine. Elle repose la carafe en cristal, se débarrasse de son tablier et de sa coiffe, se dirige vers le vestibule et la porte de service, prend son manteau, le boutonne, et jette son châle sur ses épaules. Elle ouvre la porte d’un geste véhément. Un mur de neige qui lui monte jusqu’aux cuisses obstrue l’ouverture, mais qu’importe, elle sort et le traverse avec une telle énergie que la poudreuse virevolte devant elle. Elle s’avance à grandes enjambées vers le muret en pierre qui entoure la maison et le franchit lestement.
À petits pas, levant bien haut les jambes dans l’épaisse couche de neige, elle descend la rue Bankastræti. Lorsqu’elle atteint Austurstræti, en passant devant la demeure du Trésorier du roi, elle perd presque l’équilibre et laisse échapper un tout petit cri toutefois assez puissant dans la quiétude glaciale de Reykjavik pour faire sursauter la jeune fille à la fenêtre, qui se pique le doigt avec son aiguille, assise dans l’élégant fauteuil où elle brode au fil d’or des pantoufles vertes. La demoiselle se lève et pousse la petite lampe à pétrole sur le côté. Elle plaque son visage pâle à la vitre et ôte son index de sa bouche : “Eh bien, il y a des gens rudement pressés”, commente-t-elle, mais la servante du Gouverneur a déjà disparu, d’un pas vif, vers l’ouest de la ville. Et elle avance sans la moindre hésitation, elle accélère jusqu’à l’angle de la rue Adalstræti où elle tombe nez à nez avec deux chevaux affolés qui se cabrent, la font trébucher et atterrir de tout son long dans la congère. Une porteuse d’eau coincée dans la neige devant l’hôtel Islande hurle quelques paroles acerbes bien qu’incompréhensibles, puis se fraye un chemin vers l’accidentée à qui elle tend sa main bleue et gonflée. La servante la repousse et se relève sans son aide. Elle s’ébroue pour se débarrasser de la neige avant de reprendre sa route. Et elle allonge encore le pas, c’est presque une course qu’elle achève en rampant pratiquement dans la poudreuse. C’est qu’elle n’a pas une minute à perdre. Elle doit arriver au plus vite chez Brandur, à Brandshus. Tant que l’histoire de la petite Lina Branson, avec tous ses détours, ses rebondissements, ses ellipses et ses merveilles, est encore claire dans son esprit.
Partie de campagne. Fin d’été 1896
Tôt le matin, on frappa vigoureusement à la porte de Brandur. Silvia Popp était affolée. Elle faisait de grands moulinets de bras. Il fallait qu’on l’aide à préparer le pique-nique. La collation était destinée à des Américains qui devaient quitter la ville avec son père pour aller explorer la vallée de la rivière Ellidaa une demi-heure plus tard. Sussi Thordarsen lui avait fait faux bond au dernier moment, sans lui laisser le temps de se retourner. Silvia interpréta donc le large sourire de sa chère Lina comme un assentiment, puis repartit en toute hâte vers le centre. Sigurlina sortit pour suivre du regard son amie qui descendait au pas de course la rue Stigur, elle agitait frénétiquement la main, sachant pourtant que Silvia ne la voyait pas. Elle referma la porte, s’y adossa, le sourire encore aux lèvres. Puis, sur le point de monter s’habiller, elle s’arrêta à la porte du salon, fit volte-face et son regard tomba sur la table de la cuisine où reposaient les gigots de mouton de Gudmundur. “Bon sang”, murmura-t-elle, jetant aussitôt la viande dans la remise et se rappelant soudain tout ce qu’elle avait encore à faire. Le linge sale, les galons pour la veste de Thordis, le sol de la cuisine et toute la pile de papiers accumulés sur le bureau de son père. Papiers parmi lesquels se trouvaient deux lettres en anglais qu’elle devait mettre au propre et qui devaient partir le lendemain. Puis elle se dit que cela pouvait attendre, elle devait sortir. Sortir de la ville et rencontrer ces étrangers.
Environ quinze minutes plus tard, elle avait enfilé sa tenue d’équitation et se trouvait dans le bureau de son père, un petit papier à la main. Elle le déposa sur la table de travail, se gardant d’envisager sa réaction et préférant penser à sa mère dont c’était l’anniversaire du décès. Puis elle quitta la maison, descendit vers le centre, elle courait presque lorsqu’elle atteignit la rue Adalstræti. Un étranger aviné lui lança des jurons, mais elle n’y prêta guère attention car, au même instant, elle aperçut Jon Jonsson, le Rédacteur en chef, qui marchait dans la rue Austurstræti, en direction de l’ouest de la ville. Si beau et si profondément plongé dans ses méditations. Elle se demanda d’où il venait en cette heure matinale, mais resta de l’autre côté de la rue et baissa les yeux lorsqu’ils se croisèrent, préférant ne pas lui dévoiler sa destination.
En quittant la rue Austurstræti, elle vit devant la boutique du marchand deux hommes occupés à seller des chevaux, Silvia et son père étaient également présents. Bientôt arrivèrent trois robustes gaillards, rejoints presque aussitôt par deux jeunes femmes magnifiques vêtues de vestes cintrées et de robes en tissu épais. Sigurlina passa une main sur sa tenue, elle lui semblait bien banale et imparfaite, trop ample et confectionnée dans un tissu trop fin. On aurait dit un sac enveloppant son corps maigrelet et chétif. Mais elle avait mieux à faire que d’y penser puisque le marchand Popp donnait ses ordres, et qu’on installait les chevaux en ordre de marche. Tous étaient en selle et bientôt l’expédition quitta la place, franchit le pont et prit la direction de l’est, accompagnée des questions que les Américains posaient à Popp et au petit Pétur sur telle ou telle chose qui piquait leur curiosité en chemin. Le plus loquace, M. Watson, grossiste américain, parlait au nom du groupe. Le propriétaire du navire qui avait amené ces visiteurs en Islande était M. Wilson, un quinquagénaire à l’air bonhomme comme son ami Watson. Le troisième homme, M. Johnson, bien plus jeune, se montrait aussi bien moins loquace. L’une des femmes était l’épouse de Wilson, l’autre s’appelait Mlle Baker. Sigurlina ignorait les liens qui unissaient ces gens.
C’étaient les Américains qui ouvraient la marche. À travers le nuage de poussière soulevé par les sabots, elle observait les deux femmes de dos, leurs chapeaux exotiques, les rubans de soie qui pendaient à l’arrière avant de leur retomber sur les reins, entre leurs sacoches, si imposants qu’elles semblaient avoir une taille de guêpe. Leurs corps tressautaient sur la selle au gré des cahots du chemin tout en terre et en pierres. Peu à peu, le petit groupe s’éloigna du centre. Sigurlina en profita pour se confectionner mentalement une tenue de cavalière flambant neuve, en velours et en laine.
Arrivés au sommet de la colline de Skolavörduholt, ils prirent la direction de celle d’Öskjuhlid et continuèrent vers le nord, longeant la colline de Bustadaholt. Lorsqu’ils atteignirent leur destination, il faisait chaud, le soleil était haut dans le ciel. Ils s’arrêtèrent à côté de la cascade Kermoarfoss. Les étrangers observèrent les alentours tandis que Sigurlina et Silvia s’affairaient et sortaient les victuailles du coffre. Elles étendirent un linge immaculé dans l’herbe, sortirent le café et installèrent la collation sur la nappe, du pain, des gâteaux et un peu de viande ; des tranches de saucisse roulée au mouton et aux herbes. Les Américaines s’installèrent par terre et picorèrent tels deux petits oiseaux sous leurs ombrelles, puis ne tardèrent pas à se lever pour remonter ensemble la rivière. Et, bientôt, les hommes s’en allèrent également avec Popp et Pétur.
Après avoir tout rangé, Silvia redescendit en ville. Sigurlina s’installa sur l’herbe et sortit son ouvrage. Les galons pour la veste de Thordis. Le fil d’or scintillait joliment au soleil brûlant, mais elle avait si chaud sous ses jupons qu’elle brûlait d’envie de les relever. Puis, brusquement, le soleil disparut. Elle regarda devant elle et vit de grands orteils blancs dans l’herbe. “Bonjour !” lança une voix profonde avant de laisser éclater un rire. Elle leva les yeux. Celui qui avait le plus pris la parole pendant le trajet se tenait face à elle. M. Watson, grand et large, avec sa barbe fournie et ses cheveux bruns. Venu en Islande, disait-il, pour prendre du bon temps avec quelques amis. Il s’accroupit et se trouva si près d’elle que c’en était gênant. Il voulait toucher de son gros index les fleurs dorées que Sigurlina brodait sur le ruban de velours noir. “Un trésor. C’est à vendre ?” murmura-t-il. Sans même attendre la réponse de Sigurlina, il se releva, caressa sa barbe et regarda le ciel : “L’Occident est obsédé par les ruines et les objets antiques. Et ce n’est pas nouveau.” Puis il fit un pas de côté, s’allongea dans l’herbe, les mains sous la nuque, et prit une profonde inspiration. “Les musées et les cabinets des collectionneurs privés sont remplis de vestiges anciens, de marbres grecs et romains de toutes formes et de toutes tailles, de vases, de coupes et de statues.” Watson leva un bras et tendit son index vers le ciel : “Nous nous passionnons pour ces vestiges, et ils finiront par éveiller l’intérêt pour d’autres cultures, plus lointaines et particulières. Comme la culture islandaise !”
Sigurlina ne voyait pas vraiment comment réagir aux déclarations solennelles de cet homme, mais, alors qu’elle avait enfin rassemblé quelques mots dans sa tête pour lui donner un semblant de réponse, les autres membres du groupe les rejoignirent. Le plus jeune, M. Johnson, s’avança vers Watson en gloussant et lui donna une pichenette sur l’épaule du bout de sa chaussure. Watson feignit d’être endormi.
Le retour fut rapide. En descendant de sa monture devant le domicile du commerçant sur la place Lækjartorg, Watson prit congé de Sigurlina en lui promettant de passer à son domicile le lendemain pour lui acheter des produits de fabrication islandaise.
Le but de l’excursion était atteint. Tout en rentrant chez elle entre chien et loup, elle passa mentalement en revue le contenu de son coffre : des galons brodés, deux promis à Thordis et presque terminés, une pièce en lin, des galettes de chaise, des coussins pour canapé, un étui à épingles. Des chaussettes en laine ? Oui, Watson en avait parlé, si elle avait bien compris. Elle avait également des gants en quantité. Mieux valait vendre tout cela à des étrangers, plutôt que de passer son temps à tricoter pour les gens de la ville. Quoi d’autre ? se demanda-t-elle en entrant dans la maison. Elle passa de la cuisine au salon d’où elle aperçut son père par la porte entrouverte du bureau. Elle se débarrassa de ses vêtements. Il remarqua qu’elle était rentrée, mais ne prit pas la peine de lever la tête, et l’entendit monter l’escalier. Brandur était cette éternelle présence lointaine.
Elle se mit immédiatement à fouiller parmi ses affaires, plongée dans sa malle, elle secouait, étendait, tapotait et caressait les ouvrages qu’elle avait confectionnés. Puis elle entra tout entière dans le coffre, ferma les yeux et se vit disposer tous ses travaux d’aiguille sur la grande table du salon. À ce moment-là, son père serait parti au musée des Antiquités installé dans le grenier du Parlement, où il passait son temps au milieu de son fatras à répertorier les trouvailles qu’on lui apportait et qu’il s’efforçait d’exposer pour les voyageurs étrangers. Elle tendit le bras vers son livre, mais avait du mal à se concentrer. Du bruit arrivait par la fenêtre. La maison voisine était le théâtre d’une altercation avinée. Le couple qui l’habitait se disputait. Il y avait quelque temps, l’épouse avait mordu si fort son mari qu’elle lui avait presque arraché un doigt, aujourd’hui c’était elle qui hurlait sous ses coups. Sigurlina se boucha les oreilles et regarda le portrait de sa mère accroché au mur au-dessus de son lit : un visage apaisé, la douceur incarnée.
Tout à coup le silence revint, elle se retrouva comme projetée d’un bond à l’époque où le visage du cadre emplissait son univers. Elle n’en conservait que des instantanés : elle-même se bouchant les oreilles devant le hangar à la naissance de son petit frère, allongée sous une couverture avec sa mère qui lui lisait des contes, cousant avec elle une petite robe pour sa poupée, apprenant à lire, étalant de la confiture dans la pénombre sur de la génoise très fine pour en faire un gâteau à étages, scrutant une carte de Noël arrivée de l’étranger au beau milieu de l’été, jouant au Pouilleux avec sa grand-mère, sa grand-mère morte à côté d’elle dans le lit, un homme recouvert d’une étoffe noire, une explosion et un éclair si violents qu’elle n’osait pas bouger et franchir le linge blanc suspendu à la porte de la ferme, ni rêver de l’avenir qui débuterait par un long voyage vers Reykjavik en 1884. Elle avait alors quatorze ans. Elle se souvient de tout depuis le moment où elle a quitté son enfance à cheval, laissant derrière elle la ferme et la vallée, traversant l’impétueuse rivière Heradsvötn, arrivant à la ferme de Vidimyri où sa mère était restée alitée quelques jours, malade, enceinte. Puis ils avaient fait une halte à Bolstadarhlid et, enfin, à Gilshagi i Vatnsdal avant d’affronter la lande de Grimstunguheidi. Ils avaient campé sur les rives du lac Arnarvatn et, dès l’aurore, les chants d’oiseaux l’avaient réveillée. Sa mère et elle étaient sorties en rampant de la tente pour aller au bord du lac. Que lui avait-elle dit ? Sigurlina ne se le rappelait pas, elle se souvenait seulement du calme. Elle avait eu l’impression qu’elle allait mourir, plongée dans tout ce silence, c’est que dans les eaux lisses du lac et dans le sourire doux de sa mère, elle avait perçu comme une douleur, comme une inquiétude.
Jusqu’au moment où elle avait vu un petit caillou ricocher à la surface de l’eau. Son père et son frère étaient réveillés. Le quotidien avait repris son cours, atténuant la souffrance. Et sous la conduite assurée du chef de famille, ils avaient atteint leur halte suivante, Kalmanstunga. Comme ailleurs ils avaient été bien reçus, partout des paysans connaissaient son père. Ils avaient passé la nuit à la ferme où sa mère s’était bien reposée dans le grand lit de la maîtresse de maison avant le trajet du lendemain dans la vallée de Kaldidalur. C’était une longue étape, même si le soleil adoucissait l’air entre les glaciers, la route était semée d’embûches et ils avaient souvent dû mettre pied à terre et tirer leurs chevaux par la bride pour franchir les plus grosses plaques de neige. Puis cette image leur était apparue, presque identique à celle suspendue dans le cadre au-dessus de leur canapé, cette aquarelle représentant des plaines tapissées d’herbe au bord du lac.
Ils étaient arrivés à Reykjavik tard le soir. Cela lui avait fait un drôle d’effet de se retrouver parmi tous ces bâtiments qu’elle n’avait vus qu’en photo. Ils étaient allés droit vers la maison que son père avait achetée au printemps. Sigurlina la trouvait plutôt petite et plus exiguë que leur ferme dans le Nord. En outre, elle était vide puisque leurs meubles n’y avaient pas encore été installés. La première nuit, ils avaient dû dormir par terre, allongés sur des couvertures. La deuxième nuit aussi, celle où sa mère avait accouché. Sigurlina était endormie, mais, à son réveil, sa mère et le nouveau-né avaient disparu. Elle n’avait jamais vu ce petit garçon, on l’avait aussitôt placé en nourrice. Quant à sa mère, il était évident qu’elle ne reviendrait jamais.
Sigurlina était debout dans le salon vide. »
Extrait
« Le fiacre s’ébranle dans un cliquetis de métal. Sigurlina hésite entre tristesse et déception, mais fait de son mieux pour se convaincre que continuer à cohabiter avec cet homme lui aurait rendu la vie impossible. Que désormais une existence normale l’attend, faite de relations avec des gens de son âge, enfin elle va pouvoir tisser d’authentiques liens avec cette métropole. Elle garde donc la tête haute, assise dans cette voiture humide et froide, sans soupçonner que ce trajet la conduira dans le brouet grouillant d’existences humaines qu’abrite la partie basse de la ville. Où sa dextérité dans le maniement du fil d’or et de l’aiguille n’a pratiquement aucune valeur. Et où Sigurlina d’Islande disparaîtra. » p. 83
À propos de l’auteur
 Sigrún Pálsdóttir © Photo DR
Sigrún Pálsdóttir © Photo DR
L’autrice et historienne Sigrún Pálsdóttir est née à Reykjavík en 1967. Elle obtient son doctorat en histoire des idées à l’Université d’Oxford en 2001, après quoi elle est chargée de recherches et maître de conférences à l’Université d’Islande. Elle se lance comme écrivaine freelance en 2007 et édite entre 2008 et 2016 le journal Saga, la principale revue d’Histoire islandaise à comité de lecture. Pálsdóttir s’illustre initialement comme autrice de biographies historiques. Þóra biskups (L’évêque Thora), son premier ouvrage publié en 2010, est suivi de près par Ferðasaga (Récit de voyage), paru la même année, qui raconte l’histoire d’une famille torpillée par un sous-marin allemand en 1944 alors qu’elle navigue à bord d’un bateau entre New York et l’Islande. Pálsdóttir publie son premier roman, Kompa, en 2016 et Delluferðin, son second, à la fin de l’année 2019. Les biographies de Pálsdóttir ont été sélectionnées pour le Prix littéraire islandais, le Prix littéraire féminin et le Prix culturel du journal local DV (catégorie littérature). Ferðasaga est nommé meilleure biographie de l’année 2013 par les libraires islandais et Kompa est sélectionné pour le Prix littéraire féminin d’Islande en 2016 et publié aux USA en 2019 par Open Letter (Université de Rochester) sous le titre History. A Mess. Delluferðin (Un coup de tête) a remporté le Prix de littérature de L’Union européenne 2021. (Source: EUPL / éditions Métailié)
Page Wikipédia de l’autrice (en anglais)
Page Facebook de l’autrice








Tags
#uncoupdetete #SigrunPalsdottir #editionsmetailie #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteratureetrangere #litteraturecontemporaine #litteratureislandaise #lundiLecture #LundiBlogs #coupdecoeur #NetGalleyFrance
#RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie


