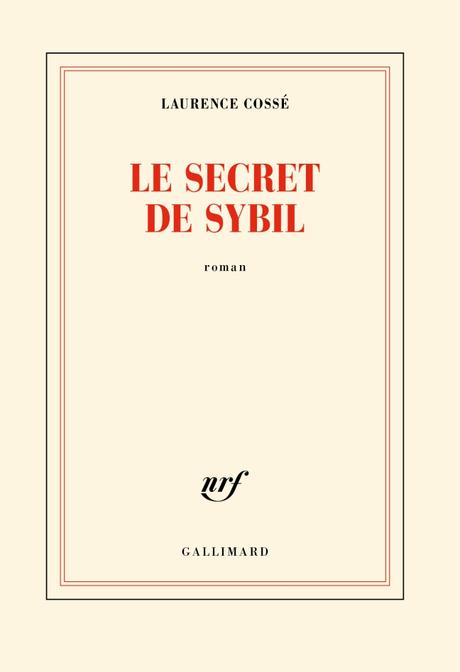
En deux mots
Laurence et Sybil deviennent les meilleures amies du monde au moment d’entrer dans l’adolescence. Pendant des années, elles vont tout partager avant que leurs chemins ne s’éloignent. Après le bac, elles se verront de manière épisode et Sybil va emporter son secret.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Ma meilleure amie, que je ne connaissais pas
Dans ce court roman Laurence Cossé raconte sa relation avec Sybil, de ses dix ans à sa mort. Une amitié très forte, mais aussi un portrait des femmes à la fin des années soixante. Et un parcours initiatique qui va virer au drame.
Comment se construit une relation? Comment se noue une amitié? Pourquoi finit-elle par s’étioler? Autant de questions qui hantent la narratrice au moment de raconter comment Sybil est entrée dans vie et y a occupé une place très importante. «C’est la sécurité affective dont j’ai le souvenir, la sécurité absolue nous baignant comme une mer chaude qui me fait appeler amour ce que nous avons partagé, Sybil et moi. Nous vivions là un privilège, une grâce que je ne pensais pas en ces termes mais dont toutes les fibres de mon être étaient sûres.»
De 10 à 14 ans, les deux amies vont s’entendre à merveille, au point même de voir leurs proches s’interroger sur cette complicité, cette proximité. En fait, c’est sur le plan intellectuel qu’elles se sont unies, échangeant leur savoir et leurs lectures. «Elle et moi, pendant des années, jour après jour nous avons parlé. Le cœur de notre amitié était là. Nous parlions avec délice, des heures.»
Des échanges qui vont les conduire à des études brillantes, mais aussi à un nouveau constat. Elles ne grandissent pas à la même vitesse, Sybil devenant une beauté qui faisait tourner les têtes alors que son amie avait tout du vilain petit canard. Mais surtout leurs différences qui les enrichissaient au début de leur relation, vont devenir des obstacles. La famille bourgeoise vise l’excellence et a les moyens de ses ambitions. On soigne sa tenue et son apparence, on fréquente la «bonne société» et on impose des règles strictes auxquelles Sybil ne songe pas à déroger. En revanche Laurence jouit de davantage de liberté. Mais ne peut s’empêcher de penser que cet hédonisme n’est pas choisi mais contraint, qu’il cache bien des lacunes.
En plaçant son récit durant cette période qui marque la fin de l’adolescence où se détermine les choix de vie, Laurence Cossé fait coup double. Elle nous livre les réflexions les plus intimes des deux jeunes filles, leurs interrogations et leurs aspirations et leur soif d’identité. Dans ce contexte les mères jouent un rôle primordial, que ce soit comme modèle ou comme repoussoir. Mais elle dresse aussi un panorama de la France à la fin des années soixante. Les questions féministes avaient alors une tout autre dimension. La femme qui travaillait faisait figure d’exception. Le compte en banque personnel n’est pas autorisé, pas plus que l’avortement. La pilule vient tout juste d’être légalisée.
Ajoutons-y un autre point fort, la construction du roman. Du roman initiatique on bascule dans la tragédie, de l’envie de vivre à la mort. Un contraste fort qui met en lumière toutes les facettes de cette relation, de la fascination au rejet. De l’enthousiasme à l’incompréhension. Il est alors fascinant de constater combien leurs cheminements respectifs s’inscrivent dans une trajectoire assez semblable, chacune restant enfermée dans un schéma bien difficile à dépasser.
Le secret de Sybil
Laurence Cossé
Éditions Gallimard
Roman
144 pages, 16 €
EAN 9782072985041
Paru le 5/01/2023
Où?
Le roman est situé principalement en France, à Paris et en proche banlieue. On y évoque aussi la Bretagne et Noirmoutier et le sud, de Collioure à la Sardaigne ainsi qu’un séjour en Angleterre.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
« De dix à quatorze ans, j’ai connu l’amour. Je ne le savais pas, j’aurais dit qu’il s’agissait d’amitié. J’ai fait le rapprochement bien plus tard, après m’être essayée à ce qu’il est convenu d’appeler amour: ce que j’avais connu à dix ans n’était pas d’une autre nature. À ceci près qu’il n’entrait dans la joie d’alors ni saisons ni brouillards, ce qui est rarement le cas entre adultes. C’est la sécurité affective dont j’ai le souvenir, la sécurité absolue nous baignant comme une mer chaude qui me fait appeler amour ce que nous avons partagé, Sybil et moi. Nous vivions là un privilège, une grâce que je ne pensais pas en ces termes mais dont toutes les fibres de mon être étaient sûres. »
Puis le froid est venu. Il m’a fallu longtemps pour admettre que Sybil s’était détachée de moi, et encore des années pour comprendre que j’en savais bien peu sur elle. L. C.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France Culture (Par les temps qui courent)
L’Indépendant (Michel Litout)
Le salon littéraire (Jean-Paul Gavard-Perret)
RCF (Christophe Henning)
Gallimard (entretien avec Laurence Cossé)
Blog Lily Lit
Les premières pages du livre
« Sybil
De dix à quatorze ans, j’ai connu l’amour. Je ne le savais pas, j’aurais dit qu’il s’agissait d’amitié. J’ai fait le rapprochement bien plus tard, après m’être essayée à ce qu’il est convenu d’appeler amour : ce que j’avais connu à dix ans n’était pas d’une autre nature. À ceci près qu’il n’entrait dans la joie d’alors ni saisons ni brouillards, ce qui est rarement le cas entre adultes. C’est la sécurité affective dont j’ai le souvenir, la sécurité absolue nous baignant comme une mer chaude qui me fait appeler amour ce que nous avons partagé, Sybil et moi. Nous vivions là un privilège, une grâce que je ne pensais pas en ces termes mais dont toutes les fibres de mon être étaient sûres.
C’était sa chevelure que l’on voyait d’abord. Le mot n’est pas de trop, en l’espèce. Elle n’avait pas des cheveux, comme tout le monde, elle était coiffée d’une chevelure. Pourtant, en classe, où je la rencontrai, jamais elle ne la portait dénouée. Sa mère y veillait. Elle avait deux énormes tresses dans le dos, luisantes, d’un brun chaud, qui lui auraient battu les cuisses si elles n’avaient été repliées sur elles-mêmes de façon à former deux boucles, deux lourdes pendeloques mordorées. J’avais lu tous les contes, les images affluaient, des fourrures, des toques, des écheveaux de soie, des turbans. Je ne crois pas avoir jamais éprouvé de l’envie devant cette foison, je me souviens d’un émerveillement indissociable de la joie. Il y avait là quelque chose d’exceptionnel et de somptueux, un don, une élection, une féerie.
Nous savions toutes, dans la classe, que cette cape de cheveux lui tombait aux genoux. Cela devait faire partie des questions usuelles : Jusqu’où ils descendent ? Car aucune de nous ne les avait vus libres. Les filles de dix ou onze ans que nous étions s’évaluaient entre elles en fonction des cheveux, pour une raison simple : nous ne savions distinguer que celui-là, des attraits physiques. Peut-être que des femmes laides se rappellent, enfants, avoir été objets d’admiration pour des boucles épaisses ou d’un blond tendre.
Les filles touchaient les cheveux qu’elles trouvaient beaux chez une autre. Elles les soulevaient, les faisaient jouer, les sentaient, elles se les enroulaient autour du poing. C’était bien la seule partie du corps d’autrui que nous pouvions explorer sans nous faire reprendre.
Je n’ai jamais touché les cheveux de Sybil, moi qui ai dû les regarder autant voire plus que les autres. Jamais vus défaits, ni être tressés. Et pourtant j’ai passé des vacances avec elle, nous partagions la même chambre, nous allions à la plage. Elle devait dormir les cheveux nattés, comme les femmes autrefois, du temps où, de leur vie, elles ne se coupaient pas les cheveux, et nager sans défaire ses tresses, ni dans l’eau ni après pour les faire sécher. Et quand sa mère la coiffait, c’était à l’écart des regards.
Il y avait une autre raison à ma retenue. Dans ma famille, nous étions priées, nous, les filles, de ne pas toucher, ni nos propres cheveux, ni surtout ceux des autres. On disait « ne pas tripoter ».
Je pense cheveux, Sybil, acajou, bai, chevaux. Crinière, animal, frisson, fauve.
Tous les matins sa mère démêlait cette masse vive, la lissait, la tressait, l’attachait. Cela devait lui prendre au moins vingt minutes. Sybil lisait-elle pendant ce temps-là ? Elle n’aurait jamais pu se coiffer seule, ses cheveux étaient trop épais, trop lourds.
J’imagine sa mère émue de cet amour particulier aux mères qui leur fait vivre comme une faveur ce qui apparaîtrait à d’autres comme une corvée. Ce rite du matin ne pouvait pas la laisser détachée. Madame D. ne coiffait pas Chloé, son autre fille, qui débrouillait seule d’un coup de peigne ses baguettes châtains, mi-longues. Elle-même avait les cheveux coupés court.
Brassant à pleines mains cette draperie, ce velours, comment n’aurait-elle pas été saisie par un désir de gloire pour l’enfant d’exception qui lui avait été confiée, ne ressemblant ni à père ni à mère et destinée à l’évidence à un destin hors du commun ?
Sybil avait par ailleurs des yeux en amande, un peu bridés, qui amenaient souvent les élèves à lui demander si elle n’était pas chinoise, sans tenir compte du vert de ses yeux ni de sa grande taille.
J’ai évoqué d’abord sa chevelure pour des raisons chronologiques. Quand on voyait Sybil pour la première fois, on ne voyait que cette exubérance. Des gens qui ne connaissaient pas son nom mais qui la croisaient quelquefois, dans la rue par exemple, devaient parler de la petite fille aux énormes tresses. C’était ne voir qu’un phénomène en elle, alors que cette singularité devenait vite insignifiante pour ceux qui la côtoyaient tous les jours.
À vrai dire, ces données physiques ne comptaient pas pour moi ces années-là. Passé l’étonnement du premier jour, si je savais ce que sa chevelure avait d’extraordinaire, je ne trouvais pas que Sybil fût particulièrement belle – et cela n’avait pas non plus d’importance. Notre amitié était intellectuelle. Je ne crois pas que le mot soit inadéquat à propos de petites adolescentes. Autant notre entente fut immédiate, autant dès les premiers mots échangés il fut flagrant et pour elle et pour moi que c’étaient nos esprits qui se plaisaient et qui se liaient l’un à l’autre.
Elle et moi, pendant des années, jour après jour nous avons parlé. Le cœur de notre amitié était là. Nous parlions avec délice, des heures. Je n’ai pas souvenir que nous nous soyons heurtées une seule fois, ni qu’il n’y ait jamais eu de tension entre nous, que l’une – elle ou moi – ait cherché à prendre le pas sur l’autre, l’ait contredite sans sourire ou lui ait coupé la parole.
Des filles de dix ou douze ans savent donc ce qu’écouter veut dire, s’écouter ? Savent qu’aimer commence là ?
Nous avions un bonheur intense à parler, à être ensemble et à parler, à nous retrouver en sachant que nous ne ferions rien d’autre.
Nous passions les récréations à parler. Sortant de classe, nous parlions sur le trajet dans un parfait oubli du temps si bien que, arrivées chez elle, ne voulant pas nous interrompre nous poursuivions ensemble jusqu’à ma porte. Mais là, nous n’avions pas fini et nous repartions jusqu’à la maison de meulière des D. Je te raccompagne, tu me raccompagnes. Passe et repasse la navette et la trame étoffe la chaîne.
Qu’avons-nous pu nous dire, tant d’heures, pendant des années ? Je n’en sais plus rien. De quoi parlent les enfants que l’on voit par deux, revenant de classe ?
Sans doute parlions-nous de notre quotidien, de l’école, des professeurs, des filles de la classe, d’un incident ayant brusqué la routine scolaire. Peut-être nous inquiétions-nous d’un devoir à rendre. Ou étions-nous électrisées par un sujet. Nous n’étions pas rivales mais nous avions toutes les deux le désir d’exceller. Je ne crois pas avoir jamais voulu la coiffer au poteau, ni m’être réjouie quand c’était le cas. Je me souviens par contre de notre joie commune le jour d’un contrôle de poésie – nous disions récitation – où nous avions eu vingt sur vingt l’une et l’autre. Joie commune, je veux dire même joie, joie d’être distinguées ensemble et joie d’être ex aequo. Sans doute aussi joie qu’il n’y ait que deux vingt dans la classe et que nous soyons ces deux-là.
J’imagine que nous parlions de livres car elle et moi étions grandes lectrices. Qui aurait soupçonné, entrouvrant la porte – peut-être étonné du silence – et nous voyant, assises dans la même chambre, l’une dans un fauteuil et l’autre sur le lit, plongée chacune dans un livre, que nous vivions l’accord parfait ?
Pour moi, c’était une évidence, lire était mon nom, mon lieu de naissance, ma vocation, mon destin. Tout le reste, l’étude, la compagnie de tiers qui n’étaient pas Sybil, la vie de famille, le sport – ce passe-temps absurde auquel mon père, pourtant si raffiné, attachait une importance incompréhensible, et qui faisait hurler mes frères de plaisir –, tout cela m’ennuyait.
Je lisais et j’aimais Sybil qui aimait lire autant que moi et à côté de moi.
Depuis longtemps, rentrée à la maison, j’avais pris l’habitude de ne pas traîner. Nous étions, chez nous, les enfants, laissés libres de notre temps jusqu’au dîner. Je faisais mes devoirs à toute allure. Alors seulement, je goûtais – les autres étaient dehors, à taper dans des balles ou à sauter des obstacles à vélo. Après quoi je lisais. Je plongeais dans les livres comme d’autres filent par la fenêtre et s’en vont dans les bois, ou dévalent jusqu’à la mer en déboutonnant leur chemise.
Madame D. emmenait ses filles à l’école en voiture et les y reprenait souvent à midi et le soir. Elle était la seule. Elle se garait cinq minutes à l’avance, au carrefour le plus proche de Sainte-Minime, toujours au même endroit, sur un petit parking où sa voiture aussi était la seule : c’est dire si elle faisait exception parmi les mères. Ses filles la retrouvaient là.
Aujourd’hui il y a des embouteillages à la sortie des classes. Les enfants, à l’époque, pouvaient marcher plusieurs kilomètres par jour. Ma mère, qui conduisait avec maestria un grand break familial, n’aurait pas imaginé nous emmener en classe en voiture. Mes frères y allaient à vélo et nous, les filles, à pied – chaperonnant une demi-douzaine de petits voisins comme, avant sept ou huit ans, nous l’avions été par des grandes qui nous houspillaient et que nous détestions. »
Extraits
« Il m’a fallu longtemps pour comprendre que c’était un parti pris chez mes parents. Ils étaient d’accord pour penser qu’il ne fallait pousser ni les enfants ni les adolescents mais qu’il était fondamental de leur épargner la compétition et de leur laisser beaucoup de temps libre, tout en leur donnant une autonomie qui fasse contrepoids à la pression scolaire : une espèce de détachement, une insoumission non théorisée et, à vrai dire, étrangement composite puisque s’y conjuguaient hédonisme et modération, non-conformisme et tradition, esthétisme et christianisme. » p. 34
« Je savais que ça n’allait pas. Je me doutais bien, par moments, que ça n’allait pas fort. Mais de mon côté, je boitais bas, ces années-là. Et un certain nombre de gens souffraient autour de moi, sans être pour autant considérés comme malades, pas plus que moi.
Quant à ceux qui l’étaient profondément, malades, ceux qui étaient atteints de troubles psychiques, on faisait tout pour le cacher. C’était une honte à l’époque, dans une famille, de compter une personne soignée pour ce genre de désordre. Nous avons peine à le croire aujourd’hui, on encourait le discrédit, la mise à l’écart. Les frères et sœurs risquaient d’être considérés comme impropres au mariage — «il y a de la folie dans la famille». Alors on taisait la réalité. On disait «Elle est fatiguée», « C’est un original, celui-là», «Il n’a jamais vraiment trouvé sa place». Tout était confondu. Les mêmes périphrases pouvaient désigner un homosexuel, un grand dépressif, ou quelqu’un qui avait commis une faute grave et en payait le prix d’un silence sur sa personne – une femme, faut-il le préciser, qui avait eu le tort de se laisser séduire avant d’être mariée, par exemple, ou qui, dûment mariée, avait fait un écart et, pire, n’avait pas su trouver moyen que cela ne se sache pas. » p. 122
À propos de l’auteur
 Laurence Cossé © Photo Francesca Mantovani
Laurence Cossé © Photo Francesca Mantovani
Laurence Cossé est l’autrice de romans, dont Le coin du voile, La femme du premier ministre, Au Bon Roman, de nouvelles, de pièces pour le théâtre et la radio. Elle a obtenu en 2015 le Grand Prix de littérature de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre. (Source: Éditions Gallimard)


Tags
#lesecretdesybil #LaurenceCosse #editionsgallimard #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2023 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #RentreeLitteraire23 #rentreelitteraire #rentree2023 #RL2023 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #litterature #bookstagram #book #bookobsessed #bookshelf #booklover #bookaddict #reading #bibliophile #bookstagrammer #bookblogger #readersofinstagram #bookcommunity #reader #bloglitteraire #aupouvoirdesmots #enlibrairie

