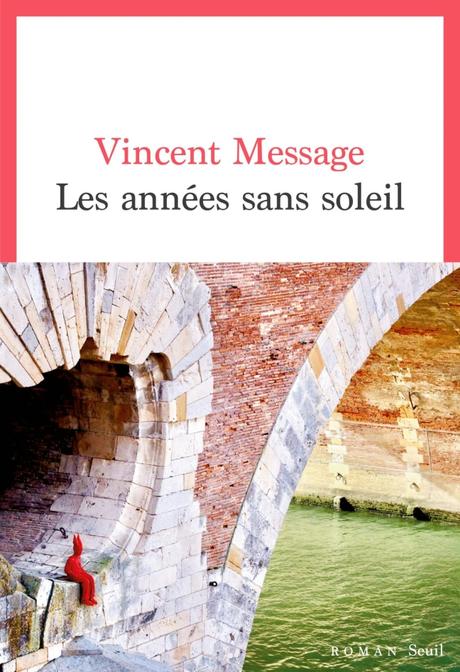
En deux mots
Elias Torres, libraire et écrivain, va devoir se confiner avec sa femme, son fils et sa fille dans son appartement toulousain. Une situation inédite qui va entrainer des tensions grandissantes et l’obliger à chercher une stratégie pour éviter l’explosion.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Une famille confinée à Toulouse
Vincent Message raconte le quotidien d’un écrivain confiné avec son épouse et ses deux enfants à Toulouse. Pour se rassurer, il va chercher dans les livres les pires périodes de l’Histoire. Et trouver une belle matière à réflexion au milieu du chaos.
Il y a quelques événements dans la vie d’un pays qui marquent tous les habitants ou presque. Le jour de la chute du mur de Berlin, le 11 septembre, la victoire en finale de la coupe du monde de football ou plus récemment le confinement. C’est cet événement qui sert de fil rouge au nouveau roman de Vincent Message. Son narrateur, l’écrivain Elias Torres, se souvient très bien où il était quand les restrictions ont été décidées. À l’aéroport de New York pour y rencontrer son éditeur et sa traductrice, car l’un de ses romans devait paraître aux États-Unis. Mais après les nouvelles mesures de restrictions sanitaires décidées à la hâte devant la progression de l’épidémie, il ne quittera JFK que pour repartir d’où il était venu, laissant derrière lui ses illusions et un livre quasiment mort-né.
Ayant retrouvé son épouse et ses enfants, il ne se doute pas qu’ils vivent leurs dernières heures d’insouciance. Revenus d’une escapade dans les Corbières, ils retrouvent leur appartement toulousain. «Et aussitôt après, tout a fermé. Le lycée de Maud, la crèche de Diego, la librairie, la plupart des commerces. Les rideaux de fer et les stores se sont baissés pour ne plus se relever, comme si on était entrés dans la stase d’un dimanche infini, ou qu’il faisait nuit en plein jour et que le soleil était une autre forme de lune.» Alors, il faut expliquer aux enfants une situation dont on a soi-même de la peine à appréhender les tenants et les aboutissants. Alors il faut faire bonne figure en se doutant que ce ne serait pas simple. «En temps normal déjà, nous sommes quatre personnes avec des besoins très distincts, pas évidents à concilier, avançant cahin-caha, d’un compromis frustrant à l’autre, mais face aux événements en cours, ce serait pire, aucun de nous ne serait libre et n’aurait ce qu’il voulait.»
Alors pour conjurer la peur, chacun cherche à s’occuper. D’abord à parer au plus pressé, même si cela est un peu irrationnel. Faire le plein de courses pour ne manquer de rien au cas où. Elias va jusqu’à commander des jerrycans pour faire des réserves d’eau. Achat qui s’avérera inutile mais va le pousser à ranger sa cave pour trouver de la place aux conteneurs. Après ce tri lui vient l’idée de creuser le sujet qui les préoccupe tous, essayer de connaître les pires moments que la terre a traversé. L’occasion de rendre visite à Igor Mumsen, un vieil érudit qui possède des livres de Procope de Césarée relatant l’ère de Justinien, les guerres et les catastrophes endurées par le peuple. «Je tenais avec cette œuvre de quoi m’occuper des semaines. Je ne savais pas encore ce que je pourrais en faire, si c’était du travail ou une lecture sans but, mais cela produisait sur moi l’effet exact que je cherchais. J’étais ailleurs, dans un autre espace-temps, à partager les préoccupations et les vicissitudes d’un historien, d’un général et d’un empereur qui n’étaient plus que poussière depuis mille cinq cents ans. Je lisais avec avidité ces histoires de massacres, de villes assiégées et pillées, de revirements d’alliances, d’assassinats qui faisaient passer les années 1970 pour un bal des débutantes, et je relativisais un peu nos malheurs de Modernes, et je respirais mieux.»
Vincent Message ne nous cache rien des tourments de son personnage, des difficultés psychologiques au sein de la famille, du degré de saturation que la situation engendre. Sa fille de dix-huit ans qui s’éloigne toujours un peu plus de lui, sa femme qui n’en peut plus de tenir le ménage à bout de bras. Mais le romancier nous offre aussi les clés pour s’affranchir de cette période très pénible à vivre. Avec les livres, avec la poésie d’Hölderlin, avec des projets d’écriture, avec les rencontres qu’il va faire.
Après Cora dans la spirale qui nous confrontait, à la complexité de la vie d’une femme soumise à une société de la performance et à la violence du management, Vincent Message se penche, tout au long de cette chronique d’une année particulière – durant laquelle tous les repères sont brouillés – sur une France de plus en plus dure, une jeunesse opprimée et un avenir incertain face aux enjeux climatiques. Et semble s’interroger sur les prochaines années sans soleil.
Les Années sans soleil
Vincent Message
Éditions du Seuil
Roman
304 p., 19,50 €
EAN 9782021495553
Paru le 7/01/2022
Où?
Le roman est situé aux États-Unis, à New-York pour un très bref séjour, puis à Paris, Narbonne et un village dans les Corbières ainsi qu’à Rodez. Mais c’est à Toulouse que va se dérouler le confinement.
Quand?
L’action se déroule principalement en 2020.
Ce qu’en dit l’éditeur
Écrivain au succès modeste, libraire à ses heures, Elias Torres vit à Toulouse avec Camille et leurs enfants. Un certain mois de mars, tout se resserre autour d’eux : ils n’ont plus le droit de quitter le pays, leur ville, puis leur quartier. Elias s’inquiète pour sa fille, Maud, qui ne décolère pas contre l’inaction des dirigeants face à la crise écologique, et à qui la situation coupe toute perspective d’avenir. Il doit aussi prendre soin de son ami, le vieux poète Igor Mumsen.
Afin de relativiser la détresse du présent, Elias mène des recherches pour savoir quelles ont été les pires années de l’histoire de l’humanité. Pour lui, la réponse ne fait pas de doute : ce sont les décennies qui ont suivi 535-536. Ces années-là, le soleil a cessé de briller pendant près de dix-huit mois. Tout en luttant pour protéger les siens, Elias se passionne pour ce petit âge glaciaire qui a marqué l’histoire d’une empreinte aussi méconnue que décisive.
Dans ce roman porté par une voix inquiète et vive, l’amour de la littérature devient un des antidotes possibles aux angoisses qui nous hantent.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
goodbook.fr
Le Télégramme
En Attendant Nadeau (Sébastien Omont)
Les premières pages du livre
« Chacun d’entre nous se souvient où il était quand ça a commencé, ou plutôt quand il a compris que ça n’était pas anodin, que ça ne toucherait pas que les autres, que c’était parti pour durer et que ça allait changer nos vies. En ce qui me concerne, je venais de descendre d’un avion après huit heures de vol, et je patientais avec quelques centaines d’autres passagers dans les files d’attente tortueuses d’un contrôle aux frontières. Je rêvais d’entrer sur le territoire des États-Unis d’Amérique, comme d’autres rêveurs avant moi. Je ne fuyais rien. Je n’étais pas venu me construire une autre vie. Je m’apprêtais seulement à passer quelques jours à New York, pour ce que mon visa désignait comme un voyage d’affaires, même si l’expression sonnait faux pour parler de moi et de mon travail. J’étais fier de me dire qu’un livre m’avait précédé, s’était faufilé avant moi de l’autre côté de la frontière. Mon quatrième roman, Hibernation, paraissait chez Atlas Maior, dans une traduction d’Emily Kent que j’avais relue ligne à ligne, l’automne dernier, pendant que tout mon petit monde dormait malgré le vent d’autan qui battait à nos fenêtres. C’était mon premier livre traduit en anglais, et la première fois également que je remettais les pieds aux États-Unis après la période où nous y avions vécu, Camille Lanneau et moi, douze ans auparavant. Ce jour de mars ainsi était un jour de joie, à marquer d’une pierre blanche.
Je me rappelle très bien. La file n’avançait pas. Les autres avaient sorti leur téléphone, j’ai donc fait comme les autres et me suis reconnecté distraitement au réseau, sans vouloir voir que le thermomètre mondial s’affolait. Je savais qu’Emily Kent était venue me chercher, que James Barrister, mon éditeur, serait également là, et je fantasmais le panonceau sur lequel mon nom serait inscrit en lettres capitales, tout en sachant très bien qu’ils n’avaient pas de raison de pousser l’hospitalité jusque-là, puisque je connaissais leurs visages et qu’ils reconnaîtraient le mien. Tout de même, je me demandais si Emily Kent serait raccord avec la poignée de photos que j’avais trouvées d’elle. Le réseau avait beau nous livrer d’avance des images chaque jour plus fidèles de la réalité, je ne savais jamais à quoi ressembleraient les visages, ni quelle allure auraient les autres avant qu’ils ne surgissent devant moi.
Maintenant la file avançait. J’ai ouvert mon passeport à la page qui établissait, en mentions dénuées de la moindre ambiguïté, que j’avais quarante-trois ans, que j’étais citoyen français, qu’on m’appelait Elias Torres. Il était également écrit que j’avais les yeux verts, ce qui était plus audacieux, ou sujet au moins à débat. Mon tour est venu, j’ai rengainé mon téléphone. Le préposé au contrôle avait la bouche usée par la répétition de formules incontournables et, sous son képi bleu marine, un regard que la bureaucratie privait de toute lumière. Je l’ai laissé scanner mes empreintes digitales. J’ai regardé se dessiner ce labyrinthe délicat dont je n’avais jamais essayé de sortir, parce que personne ne m’avait dit que je risquais de m’y perdre. Je me sentais si heureux et si inoffensif que j’ai cru avoir mal entendu lorsqu’un de ses collègues est venu me chercher. On avait besoin de moi, j’étais requis, convié à ce qui s’appelle un entretien approfondi. J’ai tout de suite trouvé ça injuste et angoissant. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je sais que c’est comme ça que les ennuis commencent, de nos jours : par un sourire et un follow me please.
Je me rappelle très bien. Un bureau sans fenêtres, ce qu’il y a de plus aseptisé, l’ordinateur qui trône et un banc pour m’asseoir. Le type a scanné mon passeport, puis l’a examiné avec une attention louable, comparant la photo au visage qu’il avait devant lui, comme s’il lui restait des pouvoirs que les machines n’avaient pas pillés. Les bases de données moulinaient, il ne leur faudrait pas dix secondes pour exhumer des choses que même Camille ne savait pas, des choses que je n’avais confiées à personne et que j’avais moi-même oubliées. Sans cesser de bavarder, avec une bonhomie dont l’hypocrisie manifeste me tapait sur les nerfs, le type a enfilé une paire de gants en latex et m’a demandé de bien vouloir me lever. Il a pris ma température avec un thermomètre frontal, qui ressemblait un peu trop à une arme. Il a entrepris de me fouiller, a palpé les pans de ma veste, mon torse, mes cuisses jusqu’à l’entrejambe. Lorsque j’ai pu me rasseoir, lui demander ce qu’on me voulait, il m’a dit de ne pas m’en faire : il s’agissait seulement de répondre à quelques questions. Vu la période, vu la situation, je devais comprendre que les autorités prennent des précautions supplémentaires.
Ensuite l’homme a examiné le formulaire que j’avais rempli, six semaines auparavant, de dénégations vigoureuses. Je n’étais pas un terroriste. Je n’avais jamais été mêlé, de quelque manière que ce soit, au trafic d’armes ou de stupéfiants. Je ne comptais pas m’impliquer dans des activités criminelles ou immorales, même si je soupçonnais que la moralité faisait ici comme ailleurs, et peut-être ici plus qu’ailleurs, l’objet de définitions dangereusement variables. En somme, je n’avais pas d’intention maligne à l’égard de ce pays dont les clivages et les errements me préoccupaient parfois jusqu’à me mettre en orbite pour un atroce tour d’insomnie, mais dont je continuais à me sentir très proche, et où j’avais vécu une des plus belles années de ma vie.
L’homme m’a demandé d’énumérer les pays où je m’étais rendu au cours de la dernière décennie. Tandis que je me creusais la tête, il feuilletait mon passeport, recensait mes visas pour contrôler chacune de mes affirmations. J’ai vu surgir mon père, assis sur le lit dans ma chambre, une liasse de polycopiés à la main, quand il m’écoutait réciter les poèmes de Friedrich Hölderlin ou d’Edgar Allan Poe que j’apprenais par cœur dans mes années d’études. Jusqu’au jour dont je parle, les contrôles à l’immigration ne me faisaient pas plus peur que la fréquentation des poètes. J’ai évoqué l’Italie et la Grèce, le Mexique, la Chine et le Japon – chacun de ces mots amenant un monde. J’ai hésité à mentionner Cuba. Il n’y avait pas trace dans mon passeport du séjour que j’y avais fait, puisque le régime castriste, histoire de ne pas transformer en enfer l’existence de ses hôtes, tamponnait un papillon de carton éphémère au lieu de délivrer des visas. Prononcer ce nom, Cuba, aggraverait les soupçons qui pesaient contre ma personne. Le taire, c’était mentir, et s’ils s’en avisaient mentir était plus grave. D’un autre côté, je restais persuadé que je n’étais coupable de rien. L’homme m’a interrompu et tiré d’embarras : il a nommé d’autres pays, pays voyous dans la vision des choses qui faisait pour lui quasiment force de loi, États ennemis où je n’avais jamais mis les pieds. Je lui ai dit que le Moyen-Orient ne m’intéressait pas, ce qui était abrupt, mais pas loin de la vérité.
Une femme corpulente, peau brune, teint mat, est entrée dans la pièce, tirant derrière elle ma valise récupérée au sortir de la soute. L’homme l’a aidée à la soulever jusqu’à la table. J’étais frileux, c’était encore l’hiver, je voulais être élégant dans la mesure de mes moyens, la valise était lourde. La femme m’a demandé d’ôter ma veste et a entrepris d’en ouvrir les doublures avec un découseur. Elle s’excusait, bien sûr, elle recoudrait ensuite, mais c’était le protocole : il se cachait, d’après leur expérience, beaucoup trop de choses là-dedans. Pendant ce temps, l’homme alignait en piles instables mes vêtements froissés. Je transportais quelques exemplaires de mes romans précédents, que je comptais offrir à certaines des personnes que je rencontrerais. À qui, je ne savais pas, c’était la beauté de la chose. Ils se sont accrochés à ces produits de contrebande. Cela leur paraissait improbable que j’aie traversé l’océan pour parler d’un de mes livres. C’est vrai que ça n’était pas strictement nécessaire. On pouvait craindre du reste que le public, aux trois rencontres prévues, soit assez clairsemé. Moi-même je ne comprenais pas pourquoi c’était Hibernation, plutôt qu’un autre de mes livres ou le livre d’un autre écrivain, qui avait retenu l’attention des éditeurs d’Atlas Maior. Les deux policiers en tout cas désiraient tout savoir de ce que racontait le roman. Rien ne leur aurait été plus facile que de vérifier par eux-mêmes, mais ils aimaient décidément que tout sorte de ma bouche.
Cueilli au pied de l’avion, je parlais un anglais bien bègue pour résumer l’intrigue d’une manière décente. J’ai dit que c’était l’histoire d’un groupe d’hommes qui franchissait les Pyrénées, une fin d’hiver, pour fuir une menace dont la nature n’était pas précisée. Si on était adepte d’explications d’ordre autobiographique, on pouvait supposer que cela se passait en 1939, au moment de la Retirada, à laquelle mon grand-père Lluís avait participé, fuyant avec les républicains catalans devant des phalangistes qui n’aspiraient qu’à leur tirer dans le dos. Dans le récit, néanmoins, je restais délibérément flou sur les lieux et les dates. Ce qui était sûr, c’est que ces hommes se retrouvaient bloqués dans la montagne, et partageaient, quelques semaines durant, le territoire d’un ours. Cela se passait bien, d’abord, puis très mal. Et en leur disant cela, j’en disais peut-être assez, non ? Je m’en serais voulu de tout leur révéler. Bien sûr, j’étais au courant que les ours n’hibernaient pas. Ils hivernaient. Leur cœur ralentissait, mais leurs réveils étaient fréquents, et c’était souvent en janvier que les femelles donnaient naissance. L’hibernation requérait un ralentissement bien plus fort du métabolisme animal, elle plongeait dans une léthargie profonde. Pourtant j’avais maintenu ce titre, parce que le mot était plus courant, parce qu’il me plaisait plus et parce qu’il avait à mes yeux une portée plus large, peut-être métaphorique ou discrètement allégorique. Lorsqu’on écrit une histoire d’ours, ce n’est jamais seulement une histoire d’ours. Mais cela, croyez-moi, je ne leur ai pas dit.
C’était peine perdue de toute façon. À chacune de leurs relances, j’avais le sentiment qu’ils ne me faisaient pas confiance, qu’ils s’étaient fait leur opinion, qu’Elias Torres n’était qu’une couverture maladroite dissimulant ma véritable identité. Je pouvais avoir publié des livres sans les avoir écrits moi-même. Je pouvais avoir une femme, une fille de dix-sept ans et un fils de deux ans et demi simplement pour faire bonne mesure. Je me suis demandé avec qui ils me confondaient, qui était celui qu’ils cherchaient, et ce qui se passerait si un jour je me trouvais face à cet homme. J’ai même pensé avec regret qu’il y avait peu de chances que cette rencontre se produise.
Ils n’ont rien découvert, curieusement, à l’intérieur de ma veste. La femme s’est mise à recoudre. Ses gestes étaient aussi rapides que ceux d’une ouvrière dans une usine textile. Et c’est à ce moment-là, je me le rappelle très bien, que les haut-parleurs m’ont demandé de me présenter en salle d’embarquement. Les policiers n’ont pas eu l’air surpris. C’était l’issue qu’ils attendaient. Ça n’avait rien de personnel, mais je ne pouvais pas être admis sur le territoire américain. Pas cette fois-ci, pas dans ces circonstances. Vous devriez prendre ce vol, m’ont-ils répété à deux voix, sinon vous payerez de votre poche le billet de retour. Ils m’ont demandé pardon pour le désagrément. Ils espéraient pouvoir me souhaiter la bienvenue en bonne et due forme, lors de mon prochain séjour.
Le décollage était dans vingt minutes. J’avais péché par négligence et m’étais mis en retard. J’ai attrapé ma veste qui n’était qu’à moitié recousue, enfilé mon manteau de laine, et j’ai couru jusqu’à l’embarquement en suant à grosses gouttes. Les deux femmes au comptoir se sont réjouies d’entendre mon nom, mais ont relevé avec mécontentement l’existence de ma valise. Je devais bien voir moi-même qu’elle ne passerait jamais en cabine. J’ai bafouillé une sorte d’excuse. Elles n’avaient pas le temps de m’écouter et n’étaient pas autorisées, de toute façon, à me laisser errer dans les limbes de cette zone de transit. Alors elles ont étiqueté la valise pour qu’elle reparte en soute et elles m’ont gratifié de leurs sourires de commande : il n’y avait aucun souci, pas le moindre souci, je la retrouverais à l’arrivée.
Elias Torres s’est écroulé sur le siège 24F, le même siège qu’à l’aller, avec beaucoup de soulagement. J’ai bouclé ma ceinture. Je sentais la peur et la sueur. J’aurais aimé changer de chemise, pour être franc, mais on ne fait pas toujours ce qu’on veut dans la vie. Je plaignais simplement ma voisine, dont le profil d’ailleurs me disait quelque chose. Tordant le cou à droite à gauche, j’ai regardé autour de moi. J’ai mis une minute à comprendre. La composition du vol était quasiment la même qu’à l’aller. Il y avait dix sièges vides et quelques nouvelles têtes. Sinon, c’étaient les mêmes personnes, occupant les mêmes places. Est-ce que tout le monde avait été refoulé ? Tous ceux qui n’étaient pas des citoyens états-uniens ? Est-ce que tout le monde avait subi la même épreuve que moi ? J’avais eu l’impression d’être l’un des seuls à être pris à part, mais mon champ de vision et le périmètre de mon attention avaient pu rétrécir sous le coup du stress. Il n’y aurait rien eu d’inconvenant à demander à mes voisins ce qui s’était passé pour eux. Si ce n’est que personne n’avait envie de parler. Les gens avaient la tête rentrée dans les épaules. Ils pianotaient sur leurs écrans ou regardaient dans le vide. Tout le monde semblait avoir honte. Ou alors c’était l’inquiétude qui faisait régner dans la cabine ce silence d’après la bataille.
Je me rappelle très bien. Nous sommes restés une demi-heure immobilisés sur le tarmac, sans que le commandant de bord nous fournisse d’explications. Et puis nous avons décollé. Avec un cœur plus calme, je ne jugeais plus que je l’avais échappé belle, et je sentais monter la colère de l’occasion perdue. J’écrivais depuis quinze ans et je n’arrivais pas à vivre de l’écriture. J’espérais que ce séjour et cette parution donneraient un nouvel élan à ma carrière. Je savais que cet espoir risquait d’être illusoire : le plus probable était que je passe quelques jours inspirants à discuter littérature, que j’aie le temps de deux ou trois promenades sur les lieux que j’avais aimés quand j’habitais le nord de Manhattan, ou bien dans des quartiers dont la rumeur voulait qu’ils aient beaucoup changé, et que je rentre à Toulouse avec d’autres images dans l’œil, heureux d’avoir faussé un moment compagnie au rythme de mon quotidien. Le plus probable était que mon roman, dans sa version américaine, connaisse des ventes encore bien plus confidentielles que dans sa version originale. Ce qui m’arrivait n’en était pas moins terriblement rageant.
Je pensais à Emily Kent. Nous n’avions échangé que par écrit, mais notre correspondance me plaisait. Je m’inquiétais parfois de la voir faire des fautes même dans les quelques lignes de français qui accompagnaient ses envois, sans pouvoir m’empêcher de juger ces fautes charmantes. La traduction elle-même m’avait pleinement rassuré. Elle était vive, ne s’éloignait du texte que pour y recoller plus loin, avec une ingéniosité, une souplesse syntaxique que je n’étais pas sûr d’avoir dans ma langue maternelle. J’étais impatient de voir à quel style de parole et de pensée s’articulait ce style de traductrice. J’avais regardé une conférence où elle parlait de son travail. Elle avait écrit un roman qui n’était pas encore paru en France : trois générations racontées à travers le jardin de la maison familiale, les haies qui montent trop haut et les parterres de fleurs, les nids de guêpes et les galeries de taupes, les arbres plantés pour fêter une naissance, élagués lorsqu’ils sont dangereux, mourant de sécheresse ou abattus d’un coup par la tempête. Je m’étais figuré que nous tomberions fous amoureux, que je me sentirais écartelé, mais que je déciderais de recommencer ma vie là-bas, à ses côtés. J’hésitais encore légèrement sur les prénoms de nos enfants. Autrement dit, j’étais un de ces mecs incapables d’entretenir quelque relation que ce soit avec une femme séduisante (même la relation la plus ténue ou la plus éphémère) sans me perdre aussitôt dans la joie un peu pathétique des fantasmes.
Je pensais aussi à la police. C’était moins excitant. J’étais pyrénéen, donc caucasien (comme ils disaient), j’avais de quoi payer mes titres de transport, je ne consommais plus de drogue qu’à des occasions rares, chez des copains plutôt que dans la rue, je me dispersais de moi-même avant la fin des manifestations, mes vêtements trahissaient d’emblée mon appartenance à la classe moyenne, et même sans doute à un milieu urbain, intellectuel ou artistique, c’était la première fois de ma vie qu’une interaction avec les forces de l’ordre se passait aussi mal. Je pouvais considérer que je n’avais pas eu de chance. Ou au contraire que j’avais jusqu’alors été extrêmement chanceux.
Je pensais à tout ça. Et lorsque j’aspirais à ne plus penser à rien, je profitais de ma place à côté du hublot et je regardais les nuages. Les couettes duveteuses des nuages dans lesquelles on aimerait plonger, pour y trouver un sommeil plus réparateur ou peut-être plus définitif. Les forteresses de nuages, leurs barbacanes et leurs chemins de ronde, leurs murailles sophistiquées que même une armée suicidaire assiégerait des mois en vain. La nuit abolissait le continent américain et me rapprochait de l’Europe aux anciens parapets. La nuit noyait dans notre dos l’océan Atlantique, et je commençais à comprendre qu’une autre nuit nous attendait, plus noire et insidieuse que toutes celles que nous avions connues.
Il m’a fallu du temps pour arriver chez moi. Au sortir de la gare, les rues de Toulouse étaient plus remuantes qu’un samedi midi ordinaire. Un premier souffle de printemps nous caressait le visage. Les gens se préparaient, achetaient des choses dont ils pensaient avoir besoin, ou qui risquaient de manquer.
Je n’ai pas aimé le silence de l’appartement. Camille avait emmené Maud et Diego à la campagne. C’était le premier week-end où il faisait assez beau pour sortir de la ville sans piétiner sur des chemins de boue. Je l’avais prévenue que je rentrais, comment dire?, plus tôt que prévu, que c’était lié à la situation, mais je n’avais pas dit un mot de ce qu’on m’avait fait subir. Ce n’était pas une de ces galères qu’on détaille à qui veut l’entendre, dans une joie de raconter qui compense en partie la mésaventure. Je me sentais victime, j’avais cette honte terrible que les agresseurs aiment provoquer pour ne pas être trop honteux eux-mêmes de ce qu’ils font. Je verrais selon la fatigue et l’humeur, avais-je annoncé à Camille, si je les rejoignais. « Tu fais ce que tu veux, vraiment », avait-elle répondu. Le simple son de sa voix était un réconfort. J’ai ouvert les placards, boulotté un sachet de pistaches qui traînait, puis des poignées de noix de cajou, enchaîné sur du fromage blanc à la crème de marrons. Je ne me suis pas senti moins vide.
Lors de l’arrivée à Paris, on m’avait confirmé après une heure d’attente que ma correspondance ne serait pas assurée. Mieux valait que je récupère ma valise et que je prenne le train. Allongé sur mon lit, paupières fermées, j’ai revu le carrousel à bagages qui faisait tourner sans fin ses écailles de caoutchouc noir. La bouche déversait des tombereaux de bagages, de toutes formes et couleurs, qui n’étaient jamais ma valise. J’étais debout à faire les cent pas, à taper des textos, à regarder les autres qui récupéraient leurs affaires comme si de rien n’était. J’ai fini par croire que je l’avais perdue. Au comptoir des réclamations, ils m’ont demandé plus de patience : rien d’illogique à ce que les derniers arrivés soient les derniers servis. La valise a fini par leur donner raison. Expulsée de la bouche d’ombre lors d’une ultime fournée, elle m’a reconnu, apparemment, s’est dirigée vers moi. Je l’ai saluée de la main. Je lui ai dit, petite valise, pardon de n’avoir pas su te protéger. Qu’est-ce que j’ai fait, petite valise, pour qu’ils te fassent subir tout ça ? Je l’ai appelée petite valise mais en réalité elle ne s’appelait pas comme ça. C’était une grosse valise, trapue, abîmée, baroudeuse. Le surnom m’est venu parce que j’avais de la tendresse pour nos souvenirs communs. Elle était seule sur le tapis. L’éclairage diminuait pour m’intimer de foutre le camp. C’était triste à mourir.
Avant de quitter l’aéroport avec les derniers passagers, d’abandonner aux techniciens et aux équipes de sécurité cette infrastructure gigantesque qui ne servait plus à rien, et dont d’autres humains, à une époque pas si lointaine, découvriraient les ruines, j’ai eu le réflexe de photographier le panneau des départs où tous les vols s’annulaient en cascade. Il y a le moment où on regarde ces noms, Karachi et Hong Kong, Copenhague et Tokyo, Bogota, Jakarta, Moscou, avec le désir d’embarquer à l’improviste pour une ville inconnue. Le voyage qu’on fait n’a de sens que dans un monde de voyages possibles, les pays qu’on connaît un peu, ceux qu’on découvrira plus tard, ceux où (sans qu’on le sache encore) on ne se rendra jamais – une carte mentale qui se précise. J’ai repensé au premier jus de canne bu sur la route qui mène de l’aéroport au centre de La Havane. J’ai repensé au poids que l’air des tropiques abat sur les épaules. J’ai revu les vagues qui se fracassent de tout leur long sur les digues du Malecón. Comme aux pires heures d’éruptions volcaniques, mais dans un ciel très clair, que n’obnubilait aucune fumée toxique, la possibilité même du voyage à l’autre bout du monde semblait en train de s’effondrer.
J’ai tenu à rouvrir les yeux avant que le sommeil ne me prenne. Les livres s’empilaient à terre, bien trop nombreux depuis que nous avons vidé le bureau pour que Diego ait sa chambre. « Pour un livre qui rentre, il en faut un qui sorte », tentait de me convaincre Camille. Je n’y arrivais pas. J’avais trop griffonné leurs marges, ils étaient liés par trop de souvenirs aux lieux où je les avais achetés, aux gens qui me les avaient offerts, à l’endroit où j’étais et à ce que je vivais lorsque je les avais lus. Parfois je fouinais jusqu’à en trouver quelques-uns dont j’étais prêt à me séparer : ils m’avaient fait forte impression mais n’étaient plus mon genre, ou bien le succès avait rendu leur auteur démagogue, ou bien je m’avisais que je les possédais en triple. Dans la semaine qui suivait, je revenais de la librairie avec le dernier album d’une série que j’aimais lire à Diego, un essai féministe auquel Maud serait sensible, la retraduction d’un classique que nous voulions, Camille et moi, découvrir depuis longtemps – et les interstices se fermaient, tout ce monde se serrait sur les étagères jusqu’à ne plus pouvoir bouger, ou aggravait encore le vertige des tours à mon chevet au risque de la chute. J’ai regardé la ville par la fenêtre. Au lieu des gratte-ciel attendus et des citernes d’immeubles si caractéristiques, c’étaient les toits de tuiles et les façades de briques de la ville où je suis né. Un genre de beauté que je connaissais mieux. J’étais libre de mes mouvements. J’aurais pu appeler des amis, sortir acheter le journal ou déjeuner seul en terrasse. Quelque chose me retenait. L’instinct soufflait : danger dans l’air, où sont les miens ?
Ce sont eux qui m’ont secouru, sauvé des idées noires en venant me chercher à la gare de Narbonne. La maison que Camille avait louée se trouvait un peu à l’écart d’un village situé dans les premiers contreforts des Corbières. Les rues étaient bordées de pins parasols et de cyprès, les talus envahis par les figuiers de Barbarie où les gamins gravent leurs initiales.
Le crépuscule est venu alors qu’on marchait dans les vignes.
J’ai eu du mal à trouver le sommeil dans ce lit au matelas mou, au milieu des meubles anciens qui rétrécissaient la chambre. Je suis descendu au salon, j’ai rencontré par chance une bouteille de cognac, Camille m’a rejoint et nous avons lampé tour à tour au même verre. « Je suis déçue pour toi. » Elle aurait préféré me retrouver enthousiaste après quelques jours de voyage. On était rarement loin l’un de l’autre, et il nous arrivait de penser qu’on ne se quittait pas assez pour se manquer. C’était mieux à coup sûr que de ne faire que se croiser, comme beaucoup de nos amis en couple, mais c’était tout de même dommage, en un sens. « Qu’est-ce qui va se passer, maintenant, à ton avis ? » Nous avons prononcé cette phrase-là en même temps. Comme il n’y avait pas de réponse, que nous n’avions pas d’expertise sur le sujet, que nous avions lu les mêmes articles dans les mêmes journaux, que nous pouvions en tirer toutes sortes d’hypothèses, parmi lesquelles les hypothèses nocturnes seraient sans doute les moins lucides et les plus angoissées, comme les tommettes se faisaient froides sous nos pieds nus et que le feu s’éteignait, nous avons bu le cognac jusqu’à la dernière goutte et nous sommes remontés faire ce qu’il y avait de mieux à faire, se serrer dans les bras, chercher le sommeil et rassembler nos forces. »
Extraits
« Je sentais néanmoins depuis des années que la dégradation était trop rapide pour qu’on ait le temps de s’y adapter, mais trop progressive également, trop graduelle pour que les discours d’alerte nous fassent battre le cœur. Un dixième de degré en plus ; le taux de concentration d’un gaz s’élevant de quelques parties par million: trop techniques, ces mesures-là, ça ne nous parle pas. Ou bien des arbres qui tombent à chaque seconde, mais hors de notre champ de vision et loin des caméras. Ou bien une espèce animale que les locaux observent de plus en plus rarement, mais qu’on ne sait pas reconnaître, voire dont on apprend l’existence le jour où la mort de son dernier représentant est annoncée dans les médias. Trop loin de nous, tout ça. Tant que le désastre n’est pas sur nos têtes. Tant qu’il ne nous frappe pas en personne… Toutefois je savais aussi que la science nous prédisait des accélérations, des événements extrêmes de plus en plus violents et fréquents — et surtout de l’inattendu. Eh bien voilà. Nous y étions, peut-être. » p. 34-35
« Et aussitôt après, tout a fermé. Le lycée de Maud, la crèche de Diego, la librairie, la plupart des commerces. Les rideaux de fer et les stores se sont baissés pour ne plus se relever, comme si on était entrés dans la stase d’un dimanche infini, ou qu’il faisait nuit en plein jour et que le soleil était une autre forme de lune.
Je n’ai pas eu le temps de penser à grand-chose, parce qu’il y avait les enfants. Nous leur avons expliqué la situation du mieux que nous avons pu, en les réunissant, puis en prenant chacun à part, puisque leur capacité à comprendre et les répercussions que la crise aurait pour eux étaient très différentes.
J’ai senti tout de suite combien ce serait dur d’affronter cette épreuve avec les enfants. En temps normal déjà, nous sommes quatre personnes avec des besoins très distincts, pas évidents à concilier, avançant cahin-caha, d’un compromis frustrant à l’autre, mais face aux événements en cours, ce serait pire, aucun de nous ne serait libre et n’aurait ce qu’il voulait. » p. 53-54
« Ça commençait à devenir long. Chacun chez soi, jour après jour. Les riches dans leurs résidences secondaires ou leurs maisons de famille, les étudiants dans leurs studios comme des religieux en cellule, les pauvres rêvant d’une chambre en plus, ou de voir des choses belles à travers leurs fenêtres. Ça engloutissait des médocs, ça buvait trop et ça allait divorcer sec. À côté des victimes directes, ça se paierait en suicides, en femmes battues à mort et en enfants violés, et tout le monde le savait. Les murs des pièces se rapprochaient. L’étau se resserrait autour de nos tempes. On en parlait dans nos fils de conversation, avec Gaëlle, Dounia, Marcus. Nous étions tous les quatre des créatures de centre-ville, nous avions renoncé à l’idéal de la maison et du jardin. Nous nous rendions compte que nos corps dépendaient de la ville, que les rues, les cafés et les berges du fleuve prolongeaient nos appartements au moins autant, dirait Bernard Stiegler, que nos téléphones prolongeaient nos cerveaux. » p. 111
« Je tenais avec cette œuvre de quoi m’occuper des semaines. Je ne savais pas encore ce que je pourrais en faire, si c’était du travail ou une lecture sans but, mais cela produisait sur moi l’effet exact que je cherchais. J’étais ailleurs, dans un autre espace-temps, à partager les préoccupations et les vicissitudes d’un historien, d’un général et d’un empereur qui n’étaient plus que poussière depuis mille cinq cents ans. Je lisais avec avidité ces histoires de massacres, de villes assiégées et pillées, de revirements d’alliances, d’assassinats qui faisaient passer les années 1970 pour un bal des débutantes, et je relativisais un peu nos malheurs de Modernes, et je respirais mieux. » p. 128-129
À propos de l’auteur
Vincent Message © Photo Astrid di Crollalanza
Vincent Message est né en 1983. Il est l’auteur des romans Les Veilleurs (2009), Défaite des maîtres et possesseurs (2016) et Cora dans la spirale (2019), parus au Seuil, qui ont rencontré un large succès critique et public. (Source: Éditions du Seuil)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Compte instagram de l’auteur
Compte Linkedin de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
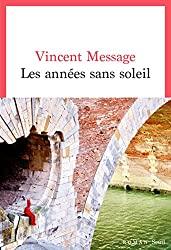


Tags
#lesanneessanssoleil #VincentMessage #editionsduseuil #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2022 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #Rentréedhiver2022 #rentreelitteraire #rentree2022 #RL2022 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict


