
En deux mots
Des femmes se retrouvent à l’hôpital. Elles ne se connaissent pas, mais ont toutes été victimes du machisme, de la domination des hommes. Par bribes, elles racontent leur parcours, leurs espoirs, leur combat.
Ma note
★★★ (bien aimé)
Ma chronique
Vivre une vie de merde et le savoir
Dans un premier roman choc, Paule Andrau a choisi de donner une voix aux femmes qui sont avant tout des victimes. Elle raconte leur quotidien, les violences qu’elles subissent et le difficile combat qu’elles mènent.
C’est à l’hôpital qu’elles se retrouvent, attendant d’être «prises en charge». Comme dans les administrations, on leur a donné un numéro. Elles sont là, un peu au bout de leur chemin de souffrance, pour essayer de se réparer. Mais le chemin est long. Car avant de pouvoir envisager une issue, il va falloir lâcher sa douleur, pleurer, crier, dire leur peine et leur mal-être, leur vie fracassée. « Écrire quoi? Que j’étais une fille à papa occupée à danser, à vibrer sous les mains des garçons d’abord, sous l’effet de toutes les drogues ensuite, à jouer ma vie sur un baiser, un shoot, une course de voiture, les cheveux déliés, la gorge pleine de rires. » Une histoire qui vient s’ajouter à d’autres histoires toutes aussi difficiles à vivre, toutes aussi violentes. Alors l’alcool, alors la drogue, alors tous les expédients sont bons pour ne plus « vivre une vie de merde et le savoir ». Sauf que ce n’est plus la vie. Tous ces artifices voilent une réalité qui finit toujours par leur revenir en pleine figure. Peu importe le milieu social – même riche, on peut être bafouée et humiliée, quittée pour une plus jeune – et peu importe l’âge. À dix ans, quand son père vous viole dans la buanderie, à vingt ans quand l’amour se confond avec le désir, à quarante ans quand on comprend qu’il sera difficile d’échapper à un quotidien éreintant qui ne laisse guère de loisir entre le ménage et les enfants ou à soixante ans, quand on est délaissée, abandonnée, vidée.
Quand on ne veut plus subir le poids d’une société qui pose l’égalité comme principe mais s’autorise à le bafouer outrageusement, à se complaire dans une mâle domination, alors on rêve de vengeance, de violence. On s’imagine Phoolan Devi faisant payer à tous ses violeurs leurs crimes abjects. Cette héroïne qui rend justice à « tous les enfants souillés, violés, battus à mort, tous ceux dont la rage de vivre a été brisée comme leurs mains, leurs dents, leurs membres ». Ou alors, on décide d’en finir. De se jeter dans le vide ou de foncer tout droit au volant de sa voiture.
Paule Andrau a construit son livre comme un puzzle, nous livrant les pièces d’une vie, celles d’une autre et d’une autre encore… Un récit éclaté qui correspond parfaitement à ces existences marquées à jamais. Ces mater dolorosa aimeraient tant pouvoir faire table rase d’un passé qui leur a tout pris, ne leur laissant au mieux que la colère. Pour que tous ces faits divers, ces histoires devenues trop banales ne se répètent plus dans l’indifférence générale.
Violence(s)
Paule Andrau
Éditions Maurice Nadeau
Premier roman
190 p., 18 €
EAN 9782862313047
Paru le 10/09/2021
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Violence(s) est roman construit sur une douzaine de récits de femmes évoquant les violences ordinaires ou extraordinaires qu’elles ont subies dans leur vie. Elles n’ont pas de nom. Mises bout à bout, les bribes de leur destin surgissent à travers ces paroles de femmes jamais dites, car elles se taisent, en devenant invisibles aux autres. Elles passent leur vie à attendre: leurs hommes, leurs enfants, leur vie même. Ce sont les vies de femmes rabaissées, humiliées, frappées, violées, torturées avant d’être tuées, juste parce qu’elles « sont femmes », celles dont on parle dans nos journaux et qu’on oublie. À travers ces paroles, ces cris interdits par toutes les conventions, elles témoignent de la violence qu’appelle partout cet « état de femme ». Toutes, même celles dont on dit qu’elles « ont réussi », malgré le « genre » auquel elles appartiennent. Ce roman les fait entrer dans la littérature pour ce qu’elles sont: des héroïnes du quotidien que sauvent leur courage et leur force de résilience, au bout du chemin.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Goodbook.fr
En Attendant Nadeau (Gabrielle Napoli)
La Viduité
Proprosemagazine (Karen Cayrat)
Paule Andrau présente Violence(s) © Production Éditions Maurice Nadeau Les lettres nouvelles
Les premières pages du livre
« X.1
Depuis des mois, depuis des années, la visite rituelle à l’hôpital. Et chaque fois ce déferlement de la souffrance des autres qui la laisse gorgée d’horreurs pour plusieurs jours. Là, dans ce couloir qui sert de salle d’attente, des heures souvent avant l’entrée dans le bureau du professeur. Des femmes. Des femmes dont les yeux vides ressemblent à ceux des saintes du Greco. Derrière ces visages que la maladie consume, des histoires, des vies qui l’assaillent inexorablement et qui la consolent de la visite pas vraiment rassurante, pas complètement positive puisqu’il faut continuer le traitement et revenir le mois prochain sans savoir quand ça finira.
L’hôpital, lieu hors du monde et monde en soi. Dès l’ouverture de la porte vitrée, un sas qui fait basculer dans l’ailleurs. L’attente au guichet : il a fallu prendre un ticket comme pour le rayon fromage ou viennoiserie dans les grands magasins. Consommateurs ici aussi, tous consommateurs. L’attente parfois interminable, souvent entrecoupée par l’arrivée de brancards et les soignants qui passent devant tout le monde pour une urgence. Prioritaires. L’attente et la pensée qui court malgré soi pendant l’attente. Sous l’apparence neutre, rester assise, ne pas bouger les mains, faire semblant de ne pas sentir la tension monter dans les jambes, nouer le ventre. La pensée qui s’emballe vers les peurs les plus folles et loin au bout, la mort, la mort, la mienne. Ne pas regarder les autres car s’apitoyer sur eux, c’est s’apitoyer sur soi et alors, la grande débâcle, le grand déballage. Attendre les documents, ces petits carrés de papier automatiquement fournis par la machine et formant une ou deux pages de chiffres, de sigles incompréhensibles.
Chacun de ces petits carrés, un sésame pour un examen, un prélèvement, un soin spécifique. Munie de ce viatique, traverser des couloirs pour atteindre le service où elle a rendez-vous. Les secrétaires à qui il faut remettre les feuilles reçues du guichet de l’entrée. Moins douloureux: au fil des mois elle les a apprivoisées, les secrétaires. Elles parlent de leurs enfants, je parle des miens, elles demandent des nouvelles, elles me reconnaissent. Et puis le couloir qui sert de salle d’attente et où nous restons pêle-mêle, les urgences, les cancéreux, les sidéens, les leucémiques. Surtout ne pas se regarder, ne pas lever les yeux parce que chez chacun, la parole est au bord des lèvres, qu’un seul regard suffit à la mettre en œuvre et que quand elle se met en branle, plus rien ne peut l’arrêter. Nous le savons tous ; alors nous regardons nos mains, nous feuilletons un agenda, nous comptabilisons dans notre sac les petits papiers pense-bêtes utiles à la semaine, nous faisons semblant de lire les journaux qui sont là sur une table basse.
Et si écrire lui donnait de déposer enfin ces confidences et ces non-dits lourds du poids de l’humain qui l’empêchent de vivre elle aussi ? Si écrire c’était déposer entre les mains de tous les autres, dans la conscience de chacun un peu de ces secrets pour les partager enfin? Les mots, trouver les mots.
Peut-être juste laisser parler ces voix qui s’entrecroisent en elle, les laisser tisser cette toile de vies meurtries, brisées, les laisser faire, juste comme elles viennent, les laisser faire.
Y arriverai-je ? Je ne sais pas. Vais-je essayer ? Je n’en sais rien. Seulement dans ma mémoire le chant de cette femme kurde sous la tente qui récite une dernière fois l’épopée de sa race, celle qui va disparaître, celle dont le poème même dit la mort à venir, chant qu’elle déroule d’une voix ferme à visage découvert tandis que les autres femmes pleurent sous leurs voiles et que les hommes eux-mêmes cachent leur face de leur main. Mélopée étrange dont chaque strophe est un éloge guerrier qui se clôt pourtant sur une note tremblée et rauque comme un égorgement. Récit de hauts faits et de souffrances dont la célébration est dévolue à une femme comme si c’était à elle, plus qu’à tout autre, qu’incombait la déploration de la misère humaine, le thrène funéraire de ceux qui ont vécu et qui vont mourir.
Pleurer, c’est tout ce qui nous reste, pas vrai ? Pleurer parce que toute cette merde… Pleurer quand on est jeune, parce qu’après… On voit bien que ça continue, que tout continue au-delà des pleurs. Les mêmes erreurs, les mêmes à vous faire mal. La même laideur. La vie, ça dure.
Alors on apprend à ne plus pleurer. Ça ennuie les autres de vous voir pleurer, ils se sentent coupables. Au début, ils consolent. Ensuite, ils deviennent rogues. Alors, on pleure toute seule. C’est plus simple. Parfois, on étouffe. On croit qu’on va crever. On crève. Ça coule, ça coule sans arrêt, bêtement dans des endroits idiots, dans des moments sans signification particulière. Sans raison. Devant le visage fermé d’une postière derrière son guichet. Quand on est prise dans un embouteillage et qu’on sait qu’on n’arrivera pas, qu’on n’arrivera pas à l’heure, qu’on n’y arrivera pas, qu’on n’arrive à rien. Ou simplement parce qu’une bouteille d’eau qu’on remplissait vous a sauté au visage.
On se retrouve trempée. La fermer, s’asseoir sur une chaise et pleurer.
On pleure pour tout mais sans que jamais personne ne le voie. On pleure pour l’autre qui une fois de plus a menti. On pleure pour les enfants devenus ennemis. Pour la vie si longue et si vide. Rien toujours.
Avant, je me disais pour tenir, pense à ceux que tu aimes. À quoi penser aujourd’hui? Où sont-ils les gens que j’aime? Les ai-je jamais aimés? Y en a-t-il encore aujourd’hui?
J’ai été ridicule, j’ai cru à toutes ces choses qui n’existent pas. D’ailleurs, s’il fallait les dire, les nommer, je ne pourrais pas, je ne pourrais plus. Trop bête. Même les dire me paraît trop bête. Alors, les avoir pensées ! Mais il n’y a rien, rien, nada. Rien nulle part. Rien partout. Que reste-t-il de ceux à qui je pensais pour tenir ? Tous m’ont bien eue, le père, le fils… Et le Saint-Esprit. Et moi, je vivais de ça, ce frémissement de tout l’être pour le plaisir donné à l’autre, cette fébrile projection vers le moment où il serait prévenu dans ses désirs, cette attente imbécile d’un regard, d’un geste, d’un mot dont l’absence a chaque jour empoisonné ma vie. Quelle bêtise. Il faut être au bout de la route pour en mesurer l’étendue.
Moi je bois. Je m’imbibe. De façon lente, systématique. Jusqu’au moment où je me sens ailleurs. C’est si facile, si précis : je peux dire l’instant où tout va basculer, devenir enfin vivable. Au début, ça brûle. Je ne peux même pas dire que c’est bon. Ma lèvre inférieure gonfle, durcit. J’en ai une conscience aiguë, presque douloureuse, mais je sais que le plaisir en dépend. Ma lèvre brûle et peu à peu je ne sais plus que cela. Puis ça descend. Ça prend les membres.
Ils s’ankylosent, s’affaissent. Et je suis libérée. Libérée de moi-même. Cette sourde pesanteur. Le visage comme de la pierre. Je bois encore. Jusqu’à la paralysie, l’insensibilité.
Je ne sens plus rien. Je suis sûre qu’on pourrait me blesser, me faire saigner sans que je crie. Invincible, je suis devenue invincible.
Ça commence à être bien. Mes paupières tombent, ma bouche s’emplit d’eau et le monde s’efface, s’éteint dans la distance. Je sens mes pommettes comme si toute ma vie s’y trouvait condensée et alors j’oublie. J’oublie tout : mon amant trop jeune, mon argent trop présent, mon passé si dérisoire, si vide, mon avenir néant. Je bois et le soleil inonde mon corps épuisé, détend tous les fils d’acier des convenances, adoucit toutes les souffrances, comble tous mes manques, ces tenailles présentes dans chacune de mes articulations, chacun de mes muscles. Il me semble qu’alors je peux tout dire, tout faire. Toutes les murailles tombent et seule compte ma musique, ma musique à moi, celle qui rythme mes non-sens.
Moi, je bois. C’est si simple. Tout s’éteint dans une nuit si douce et moi je flotte, loin, sans lien avec rien.
Qu’est-ce que je bois ? N’importe quoi. Dans n’importe quel ordre. Avec la vodka, ça va plus vite. Avec des alcools doux, je fais durer le plaisir du naufrage. Je sens l’ankylose me gagner, je la devance. Douceur suave de la pierre qui prend lentement possession de moi. J’aime cet état minéral qu’anime seule la pensée. Je ne veux plus faire un geste.
Extase.
On se tait. Attendre la visite au professeur. On pénètre dans le bureau l’un après l’autre. L’importance des premiers mots : toujours pour moi une entrée en matière qui colore le commentaire des analyses, les indications données sur les marqueurs. Il faut encaisser, ranger quelque part en soi les informations avec leur netteté immédiate et leur imprécision sur l’avenir. Toujours le dialogue se fait pédagogique : le professeur veut que je comprenne ce qui se passe, il répète
J’ai besoin de vous, je ne peux rien sans vous, il doit le répéter à chacune et chacun de ceux qui viennent dans son bureau avant moi et derrière moi. Il faut trouver la force de rester assise, d’écouter avec attention, de faire reformuler certaines phrases pour m’assurer que j’ai bien compris. Ça n’est pas fini, ça n’est jamais fini. Épuisée, épuisée au point de me sentir tomber alors que je suis assise. Parfois je pleure. Il sait bien que ce n’est pas sur moi, je ne suis jamais comme il le dit qu’une petite malade, une malade presque guérie et qui a eu la chance de survivre. Je pleure sur cet univers inhumain, en marge de la vie, antichambre de la mort.
Je quitte l’hôpital. Je ne sais ni pourquoi ni comment chaque fois j’entends ces femmes qui ne m’ont pas parlé et que je ne connais pas. Je ne sais pas de quelle partie de moi elles se lèvent mais elles sont là, partout dans ma vie, obsédantes ; je vois les événements de leur vie, ce qui les a amenées là elles aussi. Elles sont si fortes, si violentes, si pleines des cruautés qu’elles ont subies qu’elles marchent à mes côtés et qu’elles couvrent le réel de leur cri. Écrire. Il faut écrire pour donner vie à tous ces corps abandonnés, marmoréens dans leur pesanteur et informes dans leur défection totale, écrire pour donner sens à ces regards égarés de celles qui sont en train de passer du côté de la mort.
J’ai été bête, bête. J’aurai dû partir, il y a dix ans, quand j’ai commencé à douter, quand un soir je me suis retrouvée chez moi, étrangère à ma propre maison, me demandant ce que je faisais là. Partir. Et au lieu de ça, j’ai travaillé. Travaillé deux fois plus. Un tourbillon d’activités. Une journée si dense qu’elle était à elle seule toute une vie: de six heures du matin à minuit, tout, travail, gym, heures supplémentaires, et la maison, les enfants, le mari. Tout ça pourquoi ? Au bout de la route, le grand trou. Ce creux au fond de la poitrine qui s’élargit à l’infini, le désir que tout s’arrête, que tout finisse, le désir obscur, tenace de l’immobilité, de l’insensibilité de la tombe, s’arrêter enfin. Que tout cesse, tout cesse.
Des années à haïr, à se refermer sur la souffrance comme sur un noyau dur. Construire de la vie tout autour et pour tenir, haïr. Haïr l’autre pour son silence abrupt, cette absence du regard qu’on ne rencontre plus. Cette présence pesante et aveugle pendant des années, là, en face de moi. Le bruit de ses mâchoires qui mastiquent. Pas un mot. Et quand on lui parle, rien. Pendant des années, moi aussi, je me suis tue. J’ai cru que ne pas dire me préserverait et surtout sauverait les autres, donnerait un sens à ce tas de souffrances obscures, à ces miettes de peine que chaque jour laissait derrière lui. J’ai cru que parler ce serait tout casser, tout détruire et le peu que j’avais, j’y tenais tant. Alors je me suis tue.
Mais ce n’était pas encore assez. Il m’a tout pris. Vous pensez, vous qui passez, quelle vieille femme laide, négligée, repoussante. Oui, je suis tout ça. Et méchante aussi, j’ai tant de haine. Il a fichu ma vie en l’air. Il a quitté son métier.
Alors, moi, je l’ai épaulé. Je continuais. Un coup de plus.
Se taire. Marcher la route de la vie. Serrer les dents. Se taire.
Il a fallu vendre la maison, se réfugier dans un quartier périphérique. Moins cher. Vivoter à deux sur mon salaire. Car moi, n’est-ce pas, j’étais fonctionnaire, une planquée, une qui ne foutait rien mais dont on avait besoin quand même. Une qui aurait une retraite, elle, tandis que lui… Une qui touchait de l’argent à la fin de chaque mois. L’argent, il le prenait, il en vivait, sans un merci, sans un regard, sans un geste qui m’aurait fait exister. L’argent, il le prenait, comme
il m’a tout pris. Alors, aujourd’hui, plus de maison, plus d’enfants, une petite retraite, la certitude d’avoir tout manqué, l’assurance de n’avoir plus rien à vivre. Je le hais. Je le regarde en silence, je le regarde pisser sur lui, je le regarde et il sait que je le
regarde.
C’est tout ce qui me reste : ce caillou de haine qui ne passera jamais. Je mourrai nouée autour de lui si je ne suis pas devenue lui toute entière avant.
Ces journées de folie, ce tremblement, chaque matin, quand il fallait quitter les enfants, les jeter devant une porte d’école encombrée et partir pour une journée interminable.
Le temps qui se détraque et qui vous talonne sans cesse des dix minutes qui vous ont manqué dès le début. Et, pendant douze heures, le sentiment d’être orpheline, dépossédée par l’abandon forcé des enfants. L’exil sans recours dans un monde incohérent, hostile qui nie tout de la maternité. Le déchirement de les avoir laissés derrière soi, les êtres aimés, sans savoir comment ils allaient passer cette journée, ballottés au gré de personnes que l’on ne connaît pas. Et la terreur, brusquement qui fige tout en soi, tout sauf le bruit du sang qui bat aux tempes : s’ils mouraient, si elle revenait de cette traversée chaotique de la journée pour les trouver morts. S’ils devaient s’éteindre, là, brutalement, sans elle – c’est si courant – un choc, une voiture, une chute. Chaque jour, pendant toutes ces années, cette certitude qui parfois la rendait idiote : la mort omniprésente que toute cette vie nie et qui seule est vraie.
Si fort, si dur, comme une pierre dans la gorge, le désespoir de ne pouvoir sortir des rails bien huilés de la vie sociale, de ne pouvoir se dégager et courir à eux pour dire.
Pour dire quoi ? Qui aurait compris ? Elle aurait paru folle, elle aurait dérangé l’ordre des choses comme elle provoquait la haine de cette mère d’élève qui lui reprochait d’inventer pour sa fille des chapelets de mots tendres, des guirlandes d’invocations matinales pour atténuer la séparation de chaque jour. D’ailleurs ils avaient tous beau jeu de lui dire qu’il ne tenait qu’à elle de ne pas travailler…
Ces images : brisé, à terre, broyé, sanglant, son enfant.
Et l’angoisse qui envahissait sa tête, incendiait sa poitrine silencieuse, le cri réfréné de la révolte et de la peur. Et quoi aujourd’hui ? Rien de tout ça n’existe puisque
personne ne l’a su. Elle n’a jamais rien dit. Avec qui partager ?
Et est-ce que tout ne devient pas pire quand on a dit ?
Plus rien ne peut me faire pleurer. Même pas moi. Surtout pas moi. Au fond, je me hais aussi. De tout ça.
D’avoir traversé tout ça. D’exister encore après tout ça. De ne pas en être morte. Mais je ne peux pas pleurer. Plus de larmes. C’est pas faute d’en avoir versé. Peut-être que ça se tarit un jour. Plus de source des larmes. Moi : quoi d’autre que cette poignée d’os desséchée ? Dès l’origine. Rien d’autre.
Rien d’autre. Bizarre quand même cette souffrance toujours neuve dans ce corps tout déformé par l’âge. Penser que j’ai été jeune. Penser que j’ai été belle. Quand ça? Penser que j’ai été une petite fille à la robe de broderie anglaise empesée.
La seule chose qui peut encore me toucher. Ce regard de petite fille que pose parfois sur moi une femme inconnue, au hasard de la rue. Cette tendresse pitoyable pour la vieille femme que je suis devenue et dans cette tendresse le double visage de l’enfance et de la beauté retrouvé pendant un court instant. Cette femme belle et douce qui me sourit et me pardonne tout ce que je suis, ce moment sans paroles, nos deux gorges nouées, la sienne de tout ce qu’elle devine, la mienne de tout ce à quoi j’ai renoncé. Deux femmes qui se regardent et qui savent. Celle que j’ai été, celle que, je l’espère, elle ne deviendra jamais.
J’ai cru à des mots, des mots vides de sens auxquels j’ai voulu croire. C’est ma faute bien sûr. Le mot de mon fils «parce que tu le veux bien». Oui, je voulais les aimer.
Même malgré eux. Mais l’amour donne plus de force aux coups qu’on reçoit. Le pire, découvrir que les êtres qu’on aime, une fois qu’ils se sont saisis de l’amour qu’on a pour eux, se constituent en continents étrangers. Hostiles. Durs et tranchants comme des couteaux. À chaque parole une entaille.
D’abord, les coups, on les prend. Ensuite on se rétracte, on les évite d’un brusque recul. Enfin on se blinde et on les fuit. On se contracte. On se racornit. Toute desséchée comme une vieille orange oubliée sur un coin de cheminée.
La peau durcie, figée. Encore de la couleur mais comme vernie. Vitrifiée par le temps.
Elle désormais, cette vieille femme où tout s’était recroquevillé, appauvri. Et chaque matin, la contemplation de ce désert, de ce sable. »
Extraits
« Alors le psy m’a dit d’écrire. Écrire quoi? Que j’étais une fille à papa occupée à danser, à vibrer sous les mains des garçons d’abord, sous l’effet de toutes les drogues ensuite, à jouer ma vie sur un baiser, un shoot, une course de voiture, les cheveux déliés, la gorge pleine de rires. Et que quand papa est mort, j’ai soigné ma mère, que je l’ai accompagnée et que, après, plus rien, seule avec moi-même, le visage glacé dans le miroir, trop apprêté, trop travaillé pour être encore vivant. Écrire quoi? Mettre de la merde sur le papier et après relire la merde refroidie. Dégueulasse, J’aurai été la seule à me relire. Vivre une vie de merde et le savoir, c’est une chose. Mais l’avoir tous les jours sous les yeux à travers des phrases qui se décomposent non merci. Alors je bois c’est plus simple. Et quand je bois, la merde devient paillettes et ce n’est plus la vie. » p. 25
« Oui, c’est moi Phoolan Devi. Dans ces minutes où j’attends l’adhésion ou le rejet de l’Assemblée, je ne pense qu’à ce moment d’ivresse où ma vengeance rendait à l’enfant suppliciée le poids de sa souffrance désormais assumée par les bourreaux, à un taux usuraire. Je suis Phoolan Devi: la foule dans les coursives de la rotonde scande mon nom et les députés sont eux aussi saisis de cette folie. J’entre sous la coupole au milieu des applaudissements. Et avec moi, marchent dans les acclamations, tous les enfants souillés, violés, battus à mort, tous ceux dont la rage de vivre a été brisée comme leurs mains, leurs dents, leurs membres, peuple d’ombres que chacun de mes pas réveille. » p. 59
« La facilité avec laquelle les êtres entrent dans votre vie. Un regard seulement et ils s’installent. Ou alors, ils arrivent sans même qu’on le sache, à la fois étrangers et intérieurs. Tout petit d’abord. Et puis ça grandit, ça devient tout, ça vous dévore. Et quand ils vous ont dépossédée de vous-même, que vous n’existez plus qu’à travers eux, ils décident que c’est mieux ailleurs ou que vous n’existez plus ou que vous n’en valez plus la peine ou qu’ils en aiment une autre.
Pour tant de femmes autour d’elles, ce statut ambigu d’épaves de la vie, laissées-là par le flot des êtres aimés, comme déshabitées et incapables de vivre autrement qu’au passé. Alors la peur d’être un jour confrontée à cette désertion. De voir se tarir un jour ces années de soins et d’amour, ces années où ils étaient son air et sa lumière, d’avoir à les regarder comme on fait des mirages, à la fois pénétrée de leur puissance, de leur présence, et toujours frustrée de leur évanescence. La preuve de son idiotie irrémédiable. » p. 104
À propos de l’auteur
 Paule Andrau © Photo DR – Youtube
Paule Andrau © Photo DR – Youtube
Agrégée de lettres classiques et professeur de chaire supérieure, Paule Andrau a longtemps enseigné la littérature. Elle a écrit jusqu’ici des monographies consacrées à Voltaire, Rabelais, Diderot, Stendhal, Barbusse, Gide ou Queneau. Elle est venue au roman en saisissant des bribes de destins sur les tickets de caisse des grandes surfaces. Elle a ensuite orchestré cette «partition» en imaginant ces histoires morcelées et inaudibles. Paule Andrau habite la région de Nice. (Source: Éditions Maurice Nadeau)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
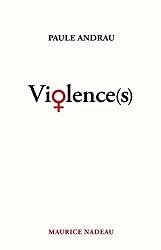


Tags
#violences #PauleAndrau #editionsMauriceNadeau #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #RentréeLittéraireaout2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict


