
En lice pour le Prix Goncourt et pour le Prix Femina
En deux mots
Une sortie à vélo qui tourne mal. La narratrice est violée dans un bois par un homme qui disparait, laissant sa victime hébétée. Sa plainte sera classée sans suite, jusqu’au jour où dans une autre affaire, on retrouve le suspect.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
«Le désespoir n’a jamais empêché personne d’être heureux»
Dans ce court et fort roman, Elsa Fottorino raconte le viol dont elle a été victime à 19 ans et comment, bien des années plus tard, la justice a arrêté le coupable. Des détails de la procédure au cheminement intérieur de la jeune femme, on suit ce difficile parcours.
Une sortie à bicyclette va devenir une histoire une «horreur banale». Alors étudiante en classe préparatoire, la narratrice vient passer le week-end dans sa famille et, pour se changer les idées, enfourche le vélo blanc préparé par son père pour une sortie dans les environs. En entrant dans le bois, elle ne voit pas l’homme qui l’a repérée, qui va l’arrêter et la violer là, près «d’un mur couvert de lichen et de givre». Une agression qui la laisse d’abord incapable de réagir. «J’ai attendu qu’il ne revienne pas. Cela paraît insensé. Attendre ce non retour. Il m’avait dit «tu bouges pas», j’ai pas bougé, c’est tout. Il est parti et j’étais libre. J’ai tardé à réaliser. J’étais sûrement captive d’autre chose. Ou alors, j’avais déclaré forfait. J’ai pensé qu’ils reviendraient à plusieurs. Je ne sais pas pourquoi. Toutes sortes de pensées irrationnelles m’ont étreinte à ce moment-là. Puis plus de pensées du tout.» Ce sont plutôt ses jambes que sa tête qui vont réagir et l’entrainer loin de ce bois. Secouée, elle reprend peu à peu ses esprits et va porter plainte. Mais avant, elle s’est lavée, détruisant ainsi toute trace d’ADN. «Le onze février 2005 n’a vécu dans aucune mémoire, sinon celle de l’administration, un courrier du tribunal de grande instance de Versailles qui indiquait le classement sans suite de mon affaire.» Ce qui aurait pu signifier la fin de cette horreur banale n’est pourtant qu’un épisode de plus dans une histoire qui va resurgir douze ans plus tard. Comme les enquêteurs le lui avaient expliqué, il arrive que l’on puisse confondre les criminels s’ils récidivent. C’est ce qui s’est passé avec l’arrestation d’un suspect qui a le profil du violeur. La justice va dès lors rassembler tous les dossiers pour un procès durant lequel elle va pouvoir se porter partie civile. Mais ne préfèrerait-elle pas ne pas remuer ce passé? N’avoir pas à se confronter avec une histoire dont elle et ses proches ont déjà beaucoup souffert, surtout quand on est la «fille de». Et puis n’a-t-elle pas réussi à se reconstruire dans des yeux qui «avaient bu le soleil». Une voix sombre et régulière écoutant une voix qui se limitait «à ceux qui étaient tout près. Ceux qui voulaient bien m’entendre parler tout bas.»
Avec des mots choisis, dans un style classique et sans fioritures, Elsa Fottorino raconte les différentes étapes qu’elle traversé, de la sidération à la mémoire traumatique, de l’enquête et des démarches, du procès à la reconstruction. Émouvant autant qu’édifiant, ce roman élargit aussi le cadre des livres parus autour de la question du viol, comme Se taire de Mazarine Pingeot ou Les choses humaines de Karine Tuil, pour ne pas parler des récits de Vanessa Springora ou Camille Kouchner, en donnant toute sa place à la littérature. Voilà sa force, voilà qui explique que «le désespoir n’a jamais empêché personne d’être heureux».
Parle tout bas
Elsa Fottorino
Éditions du Mercure de France
Roman
160 p., 15 €
EAN 9782715257375
Paru le 19/08/2021
Où?
Le roman est situé en France, principalement à Paris et banlieue, à Auteuil et Versailles, Nanterre ainsi qu’à La Rochelle et environs.
Quand?
L’action se déroule de 2005 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Je ne pouvais plus échapper à mon histoire, sa vérité que j’avais trop longtemps différée. J’avais attendu non pas le bon moment, mais que ce ne soit plus le moment. Peine perdue. La mienne était toujours là, silencieuse, sans aucune douleur, elle exigeait d’être dite. J’ai espéré un déclenchement involontaire qui viendrait de cette peur surmontée d’elle-même. La peur n’est pas partie mais les mots sont revenus.
En 2005, la narratrice a dix-neuf ans quand elle est victime d’un viol dans une forêt. Plainte, enquête, dépositions, interrogatoires : faute d’indices probants et de piste tangible, l’affaire est classée sans suite. Douze ans après les faits, à la faveur d’autres enquêtes, un suspect est identifié : cette fois, il y aura bien un procès.
Depuis, la narratrice a continué à vivre et à aimer : elle est mère d’une petite fille et attend un deuxième enfant.
Aujourd’hui, en se penchant sur son passé, elle comprend qu’elle tient enfin la possibilité de dépasser cette histoire et d’être en paix avec elle-même
Elsa Fottorino livre ici un roman sobre et bouleversant, intime et universel, qui dit sans fard le quotidien des victimes et la complexité de leurs sentiments.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
goodbook.fr
Gang Flow (Anne-Sandrine di Girolamo)
Blog Le tourneur de pages
Elsa Fottorino présente son roman Parle tout bas © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
« Je vais vous parler de l’horreur. L’horreur banale, anonyme, qui nous cueille sur le sentier de l’ordinaire et nous rend à lui sans laisser de traces. Parfois elle ne rend rien. Je fais partie de celles qui ont eu de la chance, celles qui ont été remises à leur place initiale sans que personne ne constate l’effraction. Sinon peut-être un léger décalage par rapport à la position d’origine, un déséquilibre tout juste perceptible provoqué par ce déplacement. Mais rien qui indiquerait de rupture avec une version précédente de soi. J’ai conservé mes airs trompeurs de fille à papa, j’ai laissé sans trop m’en préoccuper régner ce malentendu et j’ai continué à imiter encore longtemps cette image-là, accessoire, de moi-même. Et qui devait me rendre par contagion, à mon tour, accessoire.
Certaines ne se remettent jamais. Je le sais car je les ai entendues à la radio ou à la télévision dire: «De cela, on ne peut pas guérir.»
J’ai encore en tête la phrase de l’avocate générale dans son réquisitoire : « un meurtre de l’âme ». C’est en cherchant les coupures de presse que je suis tombée sur cette phrase. Elle m’a paru juste mais je ne suis pas sûre de bien la comprendre.
Je n’ai mal nulle part. Aucun symptôme. Je peux même tout raconter comme ça, d’une traite, sans émotion. Pourtant, j’ai bien eu peur un jour, dans la gangue de la forêt, au milieu des pierres, des injures et du bois mouillé.
On disait que j’allais bien. Je le disais à mon tour pour ne pas décevoir. Et aussi, je crois, parce que c’était vrai.
De toute façon, je ne me sentais pas malade. Peut-être l’étais-je, mais alors tel un malade qui s’ignore. À un certain stade, les maladies de l’esprit sont impossibles à défaire. J’y avais échappé.
À moins que l’absence de symptômes ne soit l’œuvre d’un mal insidieux et clandestin. Avec ces choses-là, on peut tout renverser en son contraire. Même les mots. Il y a ceux que l’on enroule, vélo, volé, lové ; ceux que l’on conjure, peur, pure et repu ; les prénoms qui se retournent en paysages, Mila, Mali, Lima.
Mais le seul qui puisse décrire ça ne permet aucun travestissement. On ne peut en faire l’économie. Ses quatre lettres échouent à former d’autres combinaisons. Au mieux, on peut l’amputer d’un caractère. Cela donne : vil. Ou vol. Ou loi.
Aujourd’hui, je ne peux pas le dire dans sa totalité. L’écrire encore moins. C’est devenu pour moi, l’innommable. Peut-être la seule anomalie qui en découle.
Je vais bien, donc. Puis, il y a appel.
C’est un vingt-deux mars vers dix heures du matin, le deuxième matin du printemps. J’approche ma main, je coupe le son. Inconnu. Je passe mon tour. Inconnu, pas pour moi. J’ai toujours entendu, les inconnus c’est « non ». Encore faut-il savoir le dire. Quand on ne peut pas, il existe d’autres moyens. Le chemin le plus simple vers le « non » n’est pas toujours le mot lui-même.
Dans les récits fantasmés des parents, il est parfois question de bonbons. D’un inconnu à bonbons. On installe cette peur-là dans l’esprit des enfants. Les parents aussi ont leurs contes maléfiques.
L’inconnu insiste. Je l’expédie sur ma messagerie, pas ma voix, une boîte vocale automatique, je prends toutes sortes de précautions. Je pense à un démarcheur. Et puis je ne pense plus à rien. Il n’y a rien à penser d’ailleurs. Des matins comme ça. Des saisons intermédiaires où rien ne vient. On attend quelque chose. Le retour du printemps par exemple. Toujours très attendu. On le guette, il finit par nous prendre de court. Répondeur. Une femme. Capitaine Lepic. Dix-septième arrondissement. Une convocation à récupérer. La cour d’assises de Pontoise. Le mois d’avril. Je ne connais pas de capitaine Lepic ni de Pontoise. Sans raison, j’ai cherché « Pontoise » et j’ai lu « au confluent de la Viosne et de l’Oise ». J’imagine une petite ville replète. Sa gare, ses ruelles, ses commerces. Les places pavées et l’église de Pontoise. Les jurés, les assesseurs, la présidente, l’avocat général, les onze autres filles. Certaines ont changé de nom. Certaines n’étaient plus joignables pendant des années. On m’a dit « il n’y a plus que vous ». J’ai cru que c’était vrai. Que j’étais seule. J’ai cru aux fantômes. Et puis le nom des onze autres est apparu. En toutes lettres sur le papier. Celui de Tiphaine Bonin, je l’ai tout de suite reconnu. Je l’avais déjà entendu au cours de mes multiples auditions avec le capitaine Mentalo. J’en parlerai plus tard si j’en ai le courage.
Onze, c’est beaucoup. Douze avec moi. Une douzaine. Chiffre plein. C’est nous. La petite marchandise de la cour d’assises. Plus facile à conditionner.
Je tente une sortie de l’hiver. Avenue Trudaine dans un sens, square d’Anvers, lycée Jacques-Decour, place Ventura. Escale au magasin de jouets. Je suis la seule cliente de la boutique. L’heure des enfants n’est pas encore arrivée. Pourquoi pas un tambour. Je l’attrape des deux mains. Elles tremblent et je suis certaine que si je parle, ma voix se mettra à trembler elle aussi. Les tremblements gagnent le reste de mon corps, des secousses à retardement qui traversent la décennie pour bouleverser mes gestes alors que quatorze ans plus tôt, dans la forêt, j’avais été d’une immobilité souveraine. Une femme-tronc.
« Tout va bien madame ? » Je paye le tambour, la vendeuse le glisse dans un sac un peu gros. Avenue Trudaine dans l’autre sens, changement de trottoir. Côté impair. Je n’avais pas prêté attention plus tôt au Sacré-Cœur à découvert au travers des branches nues. La basilique paraît, sous ce ciel brouillé, plus blanche que grise. C’est grâce au travertin, cette roche qui prend de l’éclat avec l’âge, que la pluie ne s’infiltre pas. On distingue quelques bourgeons sur les platanes. La sève montée dans les arbres peut provoquer des dérangements d’ordre sexuel chez certains hommes, il paraît. Ce sont des policiers qui l’ont dit à une amie de quinze ans dans les années quatre-vingt.
Je m’arrête devant la vitrine d’un magasin de vêtements. Pour anticiper l’après. Quand ma silhouette aura retrouvé sa forme naturelle. Je n’entre pas à cause de mon sac un peu gros. J’ai toujours été maladroite. Avec mon ventre j’ai besoin de place pour circuler. Un enfant est sur le point d’apparaître. C’est un garçon. Quand on m’a annoncé son sexe, j’ai songé « un garçon, c’est bien. Il sera en sécurité», c’est venu tout seul, je n’ai pas pu l’empêcher. Il paraît que ce n’est pas bien d’avoir ce genre de pensées, il faudrait ne pas se préoccuper du sexe, un garçon, une fille, cela ne fait pas de différence, exit le rose d’un côté, le bleu de l’autre, il n’est pas né, j’ai déjà tout faux. Sauf sur un point. Pour lui, il est préférable que je ne me rende pas à ce procès. Cette réflexion m’a traversée comme un éclair devant cette vitrine. Je n’irai pas. Je suis rentrée d’un pas plus léger avec ma pensée comme un ballon au bout d’un fil.
Le soir, la douleur est là. Tout en longueur, étirée dans ma jambe. Arrivée juste avant la nuit, à pas de velours. Impossible de trouver le sommeil. J’ai d’abord envisagé un problème de position. Je fais quelques pas pour vérifier que je peux encore marcher. J’éprouve une sensation étrange. Comme si ma jambe se dérobait dans le sol. Mais je parviens à gagner la pièce voisine. Beaucoup de choses que je peux faire : rappeler la dame du répondeur, fixer un rendez-vous, attendre le jour du rendez-vous, laisser la confusion s’installer un peu partout, dans mon corps, mon esprit surtout, mon appartement, se répandre dans le regard immense de ma fille, commander un taxi avec la trace obsédante de ce regard.
Cette zone du dos m’est fragile depuis l’enfance. Mon kinésithérapeute me fait souvent observer que je me tiens légèrement voûtée. Un jour, d’un geste, il a redressé mes épaules et souligné de sa voix douce, « c’est rassurant pour un enfant d’avoir une maman alignée ». Ce mot, « alignée », m’est resté.
Depuis, quand je me tiens face à ma fille, je m’applique à détacher des unités de conscience dans la région dorsale. C’est comme enfiler un déguisement. Par un simple roulement d’épaules, je me glisse dans un personnage auquel je m’efforce de correspondre, avec plus ou moins de succès. Toujours est-il que cette douleur en embuscade aurait dû m’alerter.
Je n’ai pas pris la peine de me maquiller ce matin. Habitude que je perds en avançant dans l’âge, alors que cela devrait être le contraire. Il est surtout question d’éliminer tous les gestes superflus. Comme me tenir debout devant un miroir. Adieu les miroirs et les yeux cernés. J’ai entendu : « Ça ira mieux quand le bébé sera sorti. » Il faudrait que les gens arrêtent de donner leur avis. Pouvoir leur dire « ce que vous pensez ne m’intéresse pas ». Oui, ça c’est bien. Ce n’est pas pour les filles dociles comme moi. Trop bien élevée. Tout ce qu’on imagine d’une fille docile. Tout sauf cette phrase dans sa bouche.
Je présente ma carte d’identité aux deux sentinelles en uniforme qui se tiennent devant l’entrée du commissariat du dix-septième arrondissement. Les gars jettent un rapide coup d’œil et s’écartent pour me laisser passer. L’homme derrière la vitre de l’accueil passe un coup de fil pour m’annoncer. J’identifie tout de suite la femme du répondeur lorsqu’elle apparaît. Échange cordial et formel, la plupart des policiers que j’ai croisés possèdent un talent singulier pour maquiller leurs émotions avec les traits de l’indifférence sans paraître malpolis pour autant. Ils connaissent les principes de la distance raisonnable. Comme les médecins.
Certains sont parfois très dégradés. Sûrement qu’ils n’ont pas réussi à la tenir, la distance. Comme ce psycho-criminologue qui m’auditionnait quatre ans plus tôt dans la salle exiguë du commissariat de la rue Chauchat, juste derrière l’hôtel Drouot. C’est moi qui lui avais donné rendez-vous ici. Pour des raisons pratiques. Je l’avais rejoint à l’heure de ma pause déjeuner. L’entrée se faisait dans un demi sous-sol, on descendait quelques marches et on tombait sous la lumière jaune de l’accueil. On m’avait dirigée vers une petite pièce rectangulaire, avec une fenêtre au vitrage opaque qui semblait donner sur un bloc de béton surélevé, un interstice entre deux immeubles. Un homme de taille moyenne m’attendait. Jean, chemise sombre, yeux creusés. Couperose, tabac. Et un regard qui ne s’étonne plus de rien, ni de la violence, ni de ses auteurs. J’ai retenu cette phrase d’un expert psychiatre : « On a besoin que le coupable porte le visage du mal quand il porte celui de l’ordinaire. » On peut tout imaginer derrière un visage. Même l’impensable. Dans leur métier, ils savent ça. Il faut pouvoir le supporter.
Ma perception s’était à son tour déplacée dans un monde défini par de nouveaux axiomes, dictés en grande partie par la crainte et les soupçons. Les policiers évoluaient-ils eux aussi dans ce royaume du danger imminent ?
Je m’étais assise sur une chaise noire en PVC au dossier molletonné – détail insignifiant qui a survécu pour une raison que j’ignore – et j’avais répondu sans plus de formalités aux questions d’usage. D’abord, mes coordonnées. Ça commençait toujours pareil. Nom, âge, adresse, profession. Puis, il m’avait tendu plusieurs planches de photos. Encore des inconnus. Tellement de photos offertes à mon jugement cette dernière décennie. Je savais tout de suite. Au premier coup d’œil. Il n’y était pas. Jamais. Je secouais la tête par la négative avec un certain fatalisme et je rendais le document. Cela se finissait toujours ainsi. Comme cela avait commencé, d’ailleurs. Par le fatalisme. Quand je me suis engagée sur le mauvais chemin parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire.
« Vous êtes sûre de n’avoir rien remarqué ? » « Sûre. » J’ai relevé la tête. « J’aurais dû remarquer quelque chose ? » « Je ne peux rien vous dire. » « Vous avez une piste sérieuse ? » Il refusait de me donner une réponse précise, je n’obtenais jamais rien de concret, les enquêteurs avaient sûrement peur de donner de l’espoir mais la peur et l’espoir n’ont jamais fait bon ménage, c’était soit l’un, soit l’autre, il fallait choisir. J’ai dit que je n’espérais rien. Il a seulement répondu ces paroles sibyllines : « Très bien. » J’avais peur surtout. Du dénouement. Mon amie de quinze ans dans les années quatre-vingt m’a dit ça aussi. Qu’elle n’aurait pas supporté non plus un dénouement.
Il prit ma déposition en répétant ce qu’il écrivait à voix haute, tous le faisaient, je m’étais habituée avec le temps à ce procédé, la traduction de mes pensées à l’oral dans un langage télégraphique pour éviter toute ambiguïté, tout contresens, comme si la pauvreté du style devait faire émerger une certaine vérité. Avant de me voir franchir la porte, il me lança comme dans un film : « Vous vous en êtes bien sortie. » Que voulait-il dire au juste ? Que j’aurais pu être morte ? Comme d’autres peut-être. Ou que je m’étais bien remise. J’avais un travail et je me tenais encore debout, un miracle.
Le capitaine Lepic est déjà en haut des marches. J’ai cherché quelques instants plus tôt à la retenir mais elle n’a pas entendu ma voix. Ah. La voilà qui redescend du premier étage. « Les escaliers, je ne peux plus. » Elle se dirige vers l’ascenseur, je me traîne à sa suite. « J’ai connu ça moi aussi. Mais quand le bébé s’est retourné, plus de douleur, plus rien. » Je lui souris comme je peux. Il me reste quelques réserves de courtoisie pour les cas d’urgence. Elle tape un code qui met l’ascenseur en branle, il fait un bruit de carlingue épouvantable, j’ai l’impression de partir pour la mission Apollo, on est sacrément secouées là-dedans, je comprends pourquoi elle lui préférait l’escalier. Je la suis jusqu’à son bureau, pareil à tous les autres bureaux des commissariats que j’avais fréquentés pour des raisons semblables, l’obscurité, les néons, les dossiers débordant des étagères malgré le semblant d’ordre. Elle me remet un papier sorti du télécopieur, cela fait longtemps que je n’ai pas vu pareille machine, mais dans les administrations publiques, peu de choses me surprennent encore. Ces endroits ont pour moi rejoint l’univers de la fiction. Il doit exister sur le seuil un protocole de déformation invisible qui affecte les gestes, les êtres, les raisonnements et les objets. Tout ce que je peux dire, faire, penser dans ces lieux me paraît toujours irréel.
Elle me tend la convocation. La plupart des caractères sont effacés. Sûrement à cause de sa machine hors d’âge.
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE …
À LA DEMANDE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Pa… élisant domicile…
M. …, Huissier de justice, Audiencier près la Cour… donne citation à Mme F
à comparaître en personne en votre qualité de témoin à l’audience de cour d’Assises qui se tiendra devant…, Nouvelle Cité Judiciaire…
Je relis tout haut : « en personne en votre qualité de témoin ».
« Vous pouvez encore changer d’avis.
— Changer d’avis ? De toute façon, je ne pourrai pas me déplacer.
— Rassurez-vous, j’ai déjà prévenu le greffe. Ne tardez pas à les contacter. »
Elle saisit le document de mes mains. « Voyez ici, vous avez toutes les coordonnées. » Ces informations sont illisibles. Elle repasse tout à l’encre bleue et me rend le papier.
« Si vous décidez de vous constituer partie civile, faites-le vite. Le greffe a insisté, réfléchissez-y bien. Il ne reste plus beaucoup de temps. » J’ai déjà entendu cette phrase, rangée dans un vieux dossier de la mémoire. Prononcée par la juge d’instruction du tribunal de Pontoise. Et voilà que Pontoise refait surface sur la plaine du Vexin. J’avais oublié Pontoise, comme tant d’autres choses. Puis c’est revenu, la pente légère pour monter vers le centre, puis redescendre vers le tribunal. Nouvelle cité judiciaire, 3, rue Victor-Hugo, c’est écrit sur le document. Les immenses parois vitrées du tribunal. Les collines au-dehors. Je n’avais pas dû emprunter le chemin le plus court. Je m’étais arrêtée dans une boulangerie, sur la place de l’église. J’avais acheté un palmier. Et je l’avais mangé dans le train du retour. Le temps nuageux. Le paysage à travers le train, c’était le brouillard harmonique, les sons, les couleurs mélangés. Et cette question en forme de ville revenue me hanter. À cause du mot « témoin ». Qu’on aurait pu remplacer par « rien ». « En qualité de rien. » Autant le dire. Ma voix perdue vers les étages, remontée dans les spirales en colimaçon des commissariats. Remontée vers le silence. Mon silence, comme une entente secrète avec celui qui le réclame. L’accusé dans son box. Cette idée-là m’est insoutenable. Facile à chasser. À portée d’un coup de téléphone.
Pendant le trajet du retour, je parcours le document. Il mentionne mon ancienne adresse. Avenue de Clichy. Ils n’ont trouvé personne de ce nom-là, dans l’ancien relais de poste au troisième étage de l’immeuble sur cour. C’est pour cela qu’il a atterri au commissariat du dix-septième arrondissement. Si j’avais changé de numéro, il aurait pu ne jamais me parvenir. Et je n’aurais rien su du procès.
Les chefs d’accusation, je savais que je les lirais. Que je ne pourrais pas m’en empêcher. Ils sont énumérés tout en bas de la page, en lettres capitales. Je m’arrête sur le dernier: «DÉTENTION ARBITRAIRE SUIVIE D’UNE LIBÉRATION AVANT LE 7e JOUR». Je vois: une voiture blanche de type Clio qui sillonne la banlieue et un bras qui rafle les gamines sur le trottoir des vacances. Pour moi, c’est ça cette phrase. »
Extraits
« Le onze février 2005 n’a vécu dans aucune mémoire, sinon celle de l’administration, un courrier du tribunal de grande instance de Versailles qui indiquait le classement sans suite de mon affaire. La date était surlignée en caractères gras au milieu de la page. C’est là que j’ai réalisé l’ampleur de l’amnésie. Il n’y a pas eu d’après, pas de gestes, de mots ni d’intentions. Tout était resté à l’identique. La vie et ce qui la composait dans les moindres détails. Les jours étaient les mêmes, à s’y méprendre. » p. 45-46
« J’ai attendu qu’il ne revienne pas. Cela paraît insensé. Attendre ce non-retour. Il m’avait dit «tu bouges pas», j’ai pas bougé, c’est tout. Il est parti et j’étais libre. J’ai tardé à réaliser. J’étais sûrement captive d’autre chose. Ou alors, j’avais déclaré forfait. J’ai pensé qu’ils reviendraient à plusieurs. Je ne sais pas pourquoi. Toutes sortes de pensées irrationnelles m’ont étreinte à ce moment-là. Puis plus de pensées du tout. Pousser un cri de délivrance, ou du moins remettre humblement mon corps en mouvement pour dire ma gratitude d’être en vie; cela je ne l’ai pas fait. Le soulagement n’est pas arrivé tout de suite. Est-il jamais venu? Je suis restée figée quelque part dans la saison, «à l’arrêt». L’émotion m’a quittée pour se perdre ailleurs, là-haut, dans le ciel blanc. Mon corps, en partie dénudé, restait immobile et n’éprouvait pas le froid. J’ai vaguement pensé à la stupeur mais je crois que l’état de stupeur doit être plus superficiel et plus bref dans le temps. À moins que ce ne soit la stupeur et la peur additionnés. » p. 58
« Il s’allongea dans l’herbe. Ses yeux avaient bu le soleil. Ils me regardaient. Je lui disais de jolies choses que souvent il me faisait répéter. La portée de ma voix se limitait à ceux qui étaient tout près. Ceux qui voulaient bien m’entendre parler tout bas. C’était ainsi depuis l’enfance. On s’habituait à cet état, légèrement en dehors. Il me dit un jour que ma voix était comme de la porcelaine fêlée, qu’il y passerait bien un coup de polish. » p. 111
« À force, on finit par vivre comme tout le monde, Même si on garde nos petits récits intimes et secrets. Chacun invente ses propres remèdes. Par exemple, Schubert, quintette à deux violoncelles, avènement du possible. De retour chez moi, je l’écoutais en boucle. Sur le trajet, c’était une obsession. Il fallait que je l’entende à nouveau. La grâce des pizzicatos déposés sur une mélodie presque trop belle à entendre qu’elle en devenait douloureuse. La Jeune Fille et la Mort, aussi. Les ciels déchirés de bonté. Il existe cet élan dans la musique de Schubert. Qui donne le sentiment, venu des lointains, non pas que la vie m’appartient, mais que moi je lui appartiens à nouveau, qu’elle me reprend. Comme quand on aime pour la première fois. On regarde les autres et on se dit: «Ils ne savent pas.» On a envie de leur communiquer cette beauté-là. Cette chance, encore devant soi, de connaître. » p. 124
À propos de l’auteur
 Elsa Fottorino © Photo DR
Elsa Fottorino © Photo DR
Elsa Fottorino est née en 1985. Journaliste spécialisée en musique classique, elle est rédactrice en chef du magazine Pianiste. Elle est l’auteure de trois romans, notamment Mes petites morts et Nous partirons. (Source: Éditions du Mercure de France)
Page Wikipédia de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
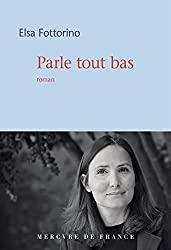


Tags
#parletoutbas #ElsaFottorino #MercuredeFrance #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #lundiLecture #LundiBlogs #RentréeLittéraireaout2021 #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict


