
En deux mots
Dans ce livre le roman alterne avec le journal. On suit d’une part l’histoire de Laura dont le remplacement au pied levé d’un spécialiste de littérature japonaise lors d’une rencontre en librairie va changer la vie, d’autant qu’à partir de ce moment, elle va recommencer à grandir, gagnant régulièrement des centimètres. Et d’autre part, les affres de la romancière en panne d’inspiration nous entraînent dans une réflexion sur la place de la femme dans notre société.
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Quand la femme prend toute sa place
Murielle Magellan nous revient avec un livre aussi surprenant que passionnant. En racontant l’histoire de Laura, sa passion pour la littérature japonaise et sa curieuse affection – elle recommence à grandir – et en la doublant du récit de la genèse de cette œuvre, elle double notre plaisir.
Une fois n’est pas coutume, vous me permettrez d’évoquer un souvenir personnel pour commencer cette chronique. Lors de mes études de journalisme à Strasbourg, notre professeur nous demandait systématiquement de rendre non seulement l’article demandé – reportage, portrait ou interview – mais ce qu’il appelait un «méta-papier» qui devait retracer l’expérience vécue dans la conception et la rédaction de l’article. Nous devions y retracer la manière dont le sujet nous est venu, les difficultés rencontrées, l’amabilité ou non des interlocuteurs, l’ambiance et les circonstances ou encore les lieux parcourus. Quelquefois ce méta-papier s’avérait tout aussi intéressant que l’article lui-même. Si j’évoque aujourd’hui ce souvenir, c’est parce que Murielle Magellan a construit son nouveau livre sur ce principe, faisant alterner les chapitres du roman et son journal de romancière à la recherche de l’inspiration.
Le roman raconte comment Laura, qui voue une passion pour la littérature japonaise, s’est soudainement vue propulser sur scène aux côtés d’un journaliste local pour animer une rencontre dans une librairie de Marmande, le spécialiste convoqué pour l’occasion ayant été bloqué dans le train qui l’amenait dans le Sud-Ouest.
Le journal quant à lui revient sur l’émission La Grande Librairie du 6 février 2019 durant laquelle François Busnel recevait aux côtés de Murielle Magellan Andreï Makine, Patrice Franceschi, Vanessa Bamberger et Joseph Ponthus. Murielle retrace les coulisses de l’émission, le regard qu’Andreï Makine portait sur elle et la teneur de leurs échanges lors du pot qui a suivi l’émission. Le romancier conseillant à sa consœur d’écrire sur une femme que l’âge va priver de sa beauté. Goujaterie ou vrai conseil d’auteur? Vous en jugerez.
Retour au roman et à la gloire de Laura qui éclabousse de toute sa beauté les pages culture de La Dépêche. La parution de cet article va lui valoir une brassée de compliments, à commencer par son mari Paul qu’elle seconde dans leur entreprise de Peintures et rénovations. Mais l’article va aussi la conduire à une proposition de collaboration de la part d’une vigneronne qui veut préparer au mieux sa conquête du marché nippon. Laura sera chargée de mieux faire connaître la culture et la littérature du pays du soleil levant à l’équipe et de la seconder dans son travail de communication.
La voilà sur un petit nuage, même si son bonheur s’accompagne d’un bien curieux effet: Laura a repris brutalement sa croissance! Au fil des jours sa peau se tend, sa silhouette s’affine et sa taille augmente, augmente… Mais où cela va-t-il s’arrêter?
Murielle cherche toujours pour sa part le sujet de son prochain roman, tournant autour de la proposition de Makine sans vraiment être convaincue. Comment aborder ce rapport entre jeunesse et beauté, entre âge et déchéance physique? Dans ses lectures autant que ses conversations elle enrichit sa réflexion.
Si on se doute que ce n’est qu’au bout de notre lecture que l’on découvrira comment le journal et le roman finiront par se rencontrer, on ne peut lâcher le des deux récits, avides de savoir de quelle façon va s’achever le parcours de la géante et curieux de pénétrer dans le laboratoire de la créatrice. En passant, on aura pu se constituer une imposante bibliothèque japonaise à l’aide des jolis résumés de Laura et comprendre comment Murielle Magellan écrit, aidée par ses anges. Après Changer le sens des rivières, ce nouveau portrait de femme qui s’émancipe, qui entend ne pas rester figée dans son statut. Grâce à sa touche de fantastique, on la voit prendre de plus en plus d’espace jusqu’à faire peur. Son mari et son employeur ne résisteront pas à cet «envahissement», dépassés par l’ampleur de la chose. Voilà comment Laura est grande. Et voilà comment les hommes doivent apprendre à laisser davantage de place aux femmes. Jusqu’en haut!
Reste à savoir comment est venue la belle idée de ce «dispositif narratif». Pour cela notamment, je me réjouis de notre prochaine rencontre*.
* Murielle Magellan sera l’une des invitées du Festival MotàMot 2021 qui se tiendra dimanche 29 août de 10h à 20h à la bibliothèque Grand’Rue et à la Chapelle Saint-Jean de Mulhouse et dont le programme complet se trouve ICI.
Géantes
Murielle Magellan
Éditions Mialet Barrault
Roman
288 p., 19 €
EAN 9782080219947
Paru le 18/08/2021
Où?
Le roman est situé en France, principalement du côté de Marmande et Beaupuy.
Quand?
L’action se déroule de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Laura Delabre vit paisiblement à Marmande où elle gère l’entreprise de peinture de son mari. Passionnée de littérature japonaise, elle est heureuse d’apprendre que la médiathèque de la ville organise une rencontre avec Takumi Kondo, un de ses auteurs favoris. Le hasard veut que le spécialiste parisien qui doit animer la soirée se retrouve bloqué dans son TGV. La directrice du lieu, paniquée, demande à Laura de le remplacer au pied levé. La prestation de la jeune femme est remarquable. Très agréablement surpris, le romancier en parle le lendemain sur une grande chaîne de radio. À la suite de ce succès inattendu, elle est félicitée et sollicitée de toute part. Ces changements produisent sur Laura une étrange réaction. Elle grandit. Un mètre soixante-dix… Un mètre quatre-vingts… Mais plus elle grandit, plus sa vie se fragilise. Son mari, ses amis, tous ceux qu’elle aime et apprécie se détournent d’elle, l’abandonnent. Si elle en souffre, elle fait aussi d’autres rencontres. Un mètre quatre-vingt-dix. Deux mètres… Et elle continue à s’épanouir. Deux mètres dix… Elle est devenue une géante magnifique.
À ce récit mené tambour battant, avec une allégresse communicative, Murielle Magellan mêle des extraits de son journal où vient résonner en écho l’évolution de la place des femmes dans notre société.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Goodbook.fr
Blog Sur la route de Jostein
Blog envie de partager les livres
Blog Des livres aux lèvres
Murielle Magellan présente son roman Géantes © Production Mialet-Barrault Éditeurs
Les premières pages du livre
« Roman
Laura aime les rituels. Au réveil, elle fait glisser ses petits pieds dans des surippas qui enveloppent du talon aux orteils, et lui procurent immédiatement une sensation de confort élégant. C’est Mélodie, une amie du club d’œnologie, qui lui a rapporté du Japon ces chaussons en satin rose et parme, ornés d’éventails dessinés à l’encre par une main experte. Ensuite Laura enfile un kimono, qui souligne son embonpoint sans le dénoncer, et allume la machine à café avant de se diriger vers la salle de bains. Là, elle ne manque pas de jeter un œil dans son miroir pour rectifier ce que la nuit a pu déranger de sa chevelure blonde et mi-longue. Elle n’aime pas son reflet ; elle déteste plus encore prendre son petit déjeuner la tête en vrac. Certes, le plus souvent, Paul, son mari, est déjà sur un chantier, mais il lui arrive de commencer sa journée à la maison, lorsque par exemple il doit vérifier les stocks, répondre à des commandes ou se documenter sur les couleurs tendance. Son entreprise « Peintures et Rénovations » fait parfois du conseil et, s’il n’est pas architecte, il se plaît à dire qu’il n’est pas qu’un peintre en bâtiment non plus. Il a du goût, un œil attentif à l’esthétique des choses, et c’est pour cela que Laura ne souhaite pas se montrer à lui dans une tenue négligée, même si on doit à la vérité de dire qu’il ne lui a jamais fait le moindre reproche à ce sujet.
Ce jour-là, Paul est déjà parti et Laura poursuit sa danse des habitudes : elle revient vers la cuisine, sort la confiture, met du pain à griller, appuie sur le bouton de la cafetière, ouvre le frigo et en extrait la bouteille de lait, tient la porte ouverte avec son genou pendant qu’elle en verse quelques gouttes au fond d’une tasse puis la remet dans son compartiment, retire sa jambe, ce qui suffit à refermer en douceur le battant docile ; elle répartit le tout sur un plateau qu’elle trimballe habilement vers la table en verre du salon sur laquelle repose déjà le livre qu’elle est en train de lire : Le Rire du hibou, l’un des premiers romans de Takumi Kondo, le seul qu’elle n’avait pas encore lu. L’écrivain célèbre vient ce soir à la médiathèque de Marmande présenter son œuvre et Laura ne veut rater ça pour rien au monde. Depuis l’enfance, la jeune femme, à l’esprit pourtant plutôt scientifique (elle a fait une école de commerce à Bordeaux), lit des romans japonais, et ce de façon presque exclusive. Tout est parti de la mort de son arrière-grand-mère Marthe, survenue quand elle avait 10 ans. Laura, à cette époque-là uniquement passionnée de couture, aimait Marthe d’un amour inconditionnel. La vieille femme, un peu honteuse de ne pas avoir étudié, portait en elle mille récits d’Occitanie qu’elle avait l’art de dérouler en roulant les « r » et en chantant les nasales, ce qui ralentissait la narration et créait un suspens involontaire mais efficace. Parfois, lasse de fouiller sa mémoire, elle choisissait de raconter à Laura un roman en cours de lecture qu’elle dévorait à la loupe. Le plus souvent, le livre avait été emprunté à la bibliothèque ou prêté par une voisine institutrice à la retraite en laquelle elle avait entière confiance.
Quand Laura se rendit à Agen avec son père pour un dernier adieu à l’appartement vide, elle se déroba à l’attention paternelle pour pénétrer dans la chambre de Marthe. L’ancêtre reposait dans un cercueil fermé. Pour lutter contre son imagination macabre, l’enfant se mit à scruter la chambre comme si elle contenait un antalgique puissant dissimulé quelque part : le lit, dans les draps duquel elle s’était si souvent blottie pour écouter les histoires de la vieille, le chien en bronze sur l’armoire, le tapis berbère mal dépoussiéré. Quand son regard flottant se posa sur la table de nuit, il s’ajusta pour noter la présence d’un livre duquel dépassait un marque-page fluorescent. Elle s’approcha ; manipula l’objet. C’était un livre de bibliothèque dont le titre, Gibier d’élevage, sonnait comme un roman du terroir lot-et-garonnais. Le nom de l’auteur en revanche, Kenzaburô Ôé, transportait de quelques milliers de kilomètres vers l’Est et l’Asie inconnue. « Mamie ne connaîtra jamais la fin de cette histoire. » Cette pensée glaça l’enfant plus encore que la présence assourdissante de son arrière-grand-mère dans la boîte près d’elle. Elle prit le livre, le mit dans sa poche, et l’emporta chez elle avec une seule obsession : finir la lecture de Marthe. Laura n’avait jusqu’ici lu que Les Six Compagnons ou la série des Alice en Bibliothèque verte et ignorait qu’on écrivait des livres au Japon. Qu’importe. Le soir même, elle reprit la lecture de son aïeule là où elle l’avait laissée, se retrouva en 1944 dans ce village pierreux des montagnes japonaises, suivit les aventures de l’enfant et du prisonnier noir américain sans y rien comprendre et tourna la dernière page à 3 heures du matin, épuisée mais sûre d’avoir maintenu son arrière-grand-mère en vie quelques heures de plus en s’imposant l’achèvement de ce texte mystérieux. Dès lors, elle troqua sa passion des aiguilles et des machines à coudre pour celle, inaltérable, des romans japonais.
La vie de Laura reprit son cours serein. À 17 ans, elle rencontra Paul et son regard doux, l’épousa à 23, avec la simplicité des femmes qui reconnaissent en elles l’amour profond, puis choisit de l’aider à mener à bien ce projet joyeux : être l’un des meilleurs ouvriers peintres de la région. Son époux construisit presque de ses mains leur maison de Beaupuy, dont le salon-cathédrale vitré et le jardin à l’arrière ont une vue sur Marmande et toute la vallée. Ils en firent le siège social de la société, et c’est d’ici que Laura s’applique à la comptabilité de « Peintures et Rénovations », délestant son époux de l’aspect administratif pour qu’il puisse se dévouer à la qualité de sa tâche. La société compte à présent neuf employés et Paul est un homme respecté et épanoui. Sa dégaine ramassée de rugbyman, sa chevelure épaisse et brune, son regard clair attirent la sympathie de tous. Il ne manque jamais de citer Laura quand il évoque son succès ; il n’aurait rien pu faire sans elle. La petite flamme dans ses yeux à cet énoncé prouve sa sincérité. Leur difficulté à avoir un enfant est la seule ombre à leur jolie vie, mais le docteur Bombard leur a promis qu’ils y parviendraient ensemble. Laura n’est pas pressée, elle profite du temps qu’elle a pour bien tenir sa maison – elle aime ranger – et surtout lire. Des livres japonais donc. Et ceux de Takumi Kondo en particulier.
Journal
J’ai rencontré Andreï Makine hier quand je suis passée à La Grande Librairie. Il m’a dit un truc dingue quand j’y réfléchis. Avant de faire l’émission, je pensais justement que pour écrire le livre qu’il vient de publier, Par-delà les frontières, aussi désespéré, aussi ambigu, aussi provocateur, il fallait « être Andreï Makine ». Qu’un autre écrivain ne pouvait pas produire un livre comme ça et espérer être lu, à part Houellebecq peut-être, ou un auteur agonisant, fidèlement édité, dont la mort prochaine permet tous les excès. Et ce qu’il m’a dit lors du sympathique pot qui suit l’émission, c’est du même ordre : il faut être Andreï Makine pour le dire. Très peu d’hommes se permettraient ce genre de propos.
J’avais mis une belle veste achetée cher pour l’occasion – ou plutôt dans l’espoir de l’occasion – quelques semaines plus tôt. C’est une taille 40, ils n’avaient pas plus grand. Moi, je porte facilement du 42 en ce moment, mais la vendeuse a argumenté, ça peut se porter ouvert, elle vous va bien, et Jean-Pierre [mon compagnon] a confirmé elle te va bien, de toutes celles que tu as essayées c’est celle qui te va le mieux. Mon miroir me le disait aussi, l’absence de col fait ressortir mon cou, mes cheveux, les petits fils dorés éclairent tout en restant sobres, je m’y sens bien. Bon achat. J’avais mis également des bottines à hauts talons que j’adore. Elles m’allongent, elles ont une touche de fantaisie, elles sont noires (donc discrètes) avec des éclats de rouge sur le côté, bref, je les ai choisies pour l’émission ainsi qu’un pantalon en toile et un chemisier noir légèrement transparent, un petit top en dessous, c’est bien. C’est ample. Ça cache la misère. Je n’ai pas à tirer dessus sans cesse. Être à l’aise, surtout, c’est ce qui comptait pour moi. Si possible élégante et à l’aise.
J’avais envie de parler de mon livre, de saisir l’opportunité précieuse, défendre le bébé. Je suis assez premier degré il faut dire. Très consciente de la chance que j’ai, quand j’en ai. Pas du genre à penser que ça m’est dû. Impressionnée par la qualité du plateau (Vanessa Bamberger, Patrice Franceschi, Andreï Makine, Joseph Ponthus), j’ai tenté de dissimuler derrière un visage fermé ma sensation ravie de la crèche. Malheureusement pour moi, elle trouve toujours un interstice pour s’exprimer, souvent sous la forme d’un sourire benêt. Cette béatitude enfantine ne me prive pas de mon aptitude à observer. L’un n’empêche pas l’autre.
Roman
Quand Laura arrive ce soir-là à la médiathèque au bras de Paul fatigué, elle remarque aussitôt que les choses ne se déroulent pas comme d’habitude. Le public stationne dans l’entrée et les ouvreurs bloquent l’accès à la salle de conférences alors qu’habituellement, à cette heure, les spectateurs entrent. Mais ce qui la surprend encore davantage, c’est l’air affairé de Nadja, la directrice du lieu, quinquagénaire à mèche blanche, pendue à son téléphone tout en écoutant trois collègues qui paraissent lui parler en même temps. Son regard rebondit sur chacun, perçant, à la recherche d’une bouée de sauvetage. Un cinquième énergumène court rejoindre le groupe et articule une information qui fait cesser toute agitation. Sans doute une mauvaise nouvelle puisque Nadja raccroche son téléphone, abattue. Ses yeux balayent le grand hall, dont elle connaît chaque vibration, en quête d’une solution à son problème. Laura tente de lui faire un signe courtois et un sourire mais elle devine, à l’indifférence de la bibliothécaire, que même si ses yeux noirs se sont arrêtés sur son cas, elle n’a pas été vue. Il faut dire que la pression autour de cette rencontre littéraire est grande : l’écrivain japonais a préféré Marmande à Bordeaux pour dialoguer, et des lecteurs sont arrivés de toute la région. Nadja a même fait venir de Paris Emmanuel Depussé, spécialiste de littérature japonaise et exégète reconnu. C’est lui qui interrogera Kondo. On peut s’attendre à un entretien de grande qualité. Même France Bleu s’est déplacée et compte diffuser un florilège des meilleurs moments de la soirée.
Laura s’inquiète soudain. Est-il arrivé quelque chose à Takumi Kondo ? Il a déjà fait un arrêt cardiaque et elle sait sa santé fragile. Elle avance cette hypothèse à Paul, qui consulte ses alertes, serviable, et ne voit rien pour attester un tel drame. Soulagée, elle fixe à nouveau Nadja, toujours à sa sidération malgré le babillage qui l’entoure. C’est alors qu’elle voit Laura. Mais plus de cette façon éthérée de tout à l’heure, non, elle la voit réellement. L’information visuelle, cette fois, se coordonne avec le cerveau et crée l’étincelle. Nadja voit Laura, finalement, comme personne ne la voit. Elle voit Laura, pourtant, de la seule façon possible pour elle. Non pas comme l’épouse discrète et rieuse de Paul. Non pas comme une petite ronde à qui ça irait bien, sans doute, de perdre une dizaine de kilos. Non pas comme une jeune femme qui n’arrive pas à avoir d’enfant, élément qu’elle ignore d’ailleurs. Elle voit Laura comme cette lectrice passionnée de littérature japonaise qui se faufile discrète dans les rayons de sa bibliothèque pour n’en extraire que des Murakami, ou des Ogawa, ou des Kawabata. Alors, sans hésiter, faussant compagnie à son entourage affairé, elle se dirige vers elle.
— Madame Delabre, je peux vous parler ?
— À moi ?
— Oui ! Bonjour monsieur.
Paul salue, surpris.
— Oui, oui, bien sûr…
— Venez.
Nadja s’isole avec Laura. Elle a une voix grave qui intimide, tant elle sort d’un corps émacié et longiligne.
— Voilà, nous avons un problème. Emmanuel Depussé, qui devait interviewer Takumi Kondo, est bloqué dans un train entre Paris et Bordeaux. Le pire c’est qu’il n’y a aucune raison valable, simplement un principe de précaution qui fait que la SNCF, suite à un appel malveillant concernant une pièce manquante du train, ne veut pas repartir sans avoir vérifié. Ce n’est pas Tanizaki qui a écrit un éloge du risque ?
— Un Éloge de l’ombre. Je l’aime beaucoup.
— Ah oui ! Bref, Depussé ne pourra pas interroger Kondo. Nous avons convoqué le journaliste culturel de La Dépêche, Gérard Lartigue, qui se réjouit, mais autant vous dire qu’il ne connaît rien à son œuvre.
— Ah…
— Alors je me demandais… Vous avez lu Kondo ? Je ne sais même pas pourquoi je vous pose la question.
— Oui. J’ai tout lu.
— Est-ce que vous accepteriez d’épauler Lartigue ? Je vous rassure, madame Delabre, il ne s’agirait pas de mener l’entretien mais de faire référence aux textes de Kondo, de lui montrer qu’il a été lu. Il n’y a rien de plus blessant pour un auteur que d’être interrogé par quelqu’un qui ne l’a jamais lu.
— Mais vous voulez dire… comment ça… ?
— Vous iriez sur scène avec Lartigue, vous pourriez intervenir pour préciser, donner des exemples tirés des romans que vous connaissez. Je sais, madame Delabre, à quel point vous êtes férue de littérature japonaise. Je me dis que ça peut donner une couleur joyeuse à cet entretien. Quitte à subir un incident imprévu, autant l’affronter avec une solution originale.
— …
— Qu’est-ce qui vous ennuie ?
Nadja vient de mettre le cœur de Laura dans un tambour d’enfant violent. C’est une panique inconnue pour la jeune femme qui n’a plus vécu de sollicitation exceptionnelle depuis la mort de ses parents et le discours exigé par son frère cadet pour la cérémonie d’enterrement. Impossible de refuser tant il l’avait ligotée dans ses certitudes : ne pas prendre la parole pour la mort de ses parents c’est ne pas savoir aimer – ne pas dépasser sa douleur c’est de l’égoïsme – ne pas trouver les mots c’est ne pas chercher. Son frère renvoyait chaque argument de Laura chargé d’explosif. Elle était si démunie, si éprouvée, que sans Paul, elle se serait noyée au sens littéral du terme. Elle aurait suivi le chemin du canal du Midi et se serait laissée glisser lentement dans l’eau verte. C’est Paul qui a tenu sa main pour écrire le discours-torture. C’est lui qui l’a poussée à aller au-devant de la soixantaine de personnes présentes ce jour-là (tous les collègues de l’usine de confiserie). Cet homme, sentinelle en éveil dans ce hall agité, a servi de tuteur au tronc malade qu’elle était devenue. Mais ce qu’elle ressent aujourd’hui n’a rien à voir. Cette chamade en elle, au contraire, est un influx stimulant. Pourtant, se tenir sur une scène, dans la lumière, aux côtés de Lartigue (dont Paul qui a repeint sa maison ne pense pas grand bien d’ailleurs) pour interroger Takumi Kondo, ce n’est pas sa place. Elle aime écouter, de temps en temps, les spécialistes parler. Elle ne comprend pas toujours, mais l’érudition a un effet presque érotique sur elle. Ceux qui approfondissent, confrontent, affirment, doutent, même publiquement, l’élargissent, comme des cuisses ouvertes pour l’amour ou la naissance. Mais elle n’est experte en rien. Et c’est cela qu’elle formule à Nadja, sans coquetterie. « Ce qui m’ennuie, c’est que je connais bien les romans de Kondo, mais j’oublie souvent le nom des personnages, il peut m’arriver de les confondre aussi. Je lis des romans japonais, mais je ne suis pas spécialiste. C’est pour mon plaisir. Je n’analyse jamais. Enfin, je crois pas. Ça ne m’intéresse pas tellement. C’est un loisir pour moi. Ce n’est pas vraiment ma place d’interroger Kondo. C’est un métier. »
Un sourire à ridules égaye le visage mat de Nadja, émue par cette sincérité. Sans chercher à argumenter davantage, se fiant à un instinct qu’elle n’a ni l’envie ni le temps de mettre en doute, elle dit :
— On peut essayer quand même ? Au pire, on se plante. Au mieux…
Et dans un geste surprenant, elle enserre le cou de Laura de son bras vigoureux, presque virile, et ainsi flanquée, se dirige vers Paul à qui elle lance :
— Vous savez quoi, monsieur Delabre ? C’est votre épouse qui va interroger Takumi Kondo ce soir.
Sur le visage de Laura rosit une joie brouillonne qui lui donne un air de lycéenne à quelques heures de l’oral du bac. La foule va pouvoir entrer dans la salle.
Journal
Je passe au maquillage. La maquilleuse, grande quinqua bienveillante et fine, me demande si j’ai une requête particulière. Je dis non, à part le rouge à lèvres. Je n’en veux pas. Juste du gloss. Pour le reste je la laisse faire. Elle élabore particulièrement le teint. Elle m’explique qu’il faut varier les fonds selon les zones. C’est l’une des plus grandes difficultés du maquillage, le teint. Elle est parfois enseignante dans une école et elle insiste beaucoup là-dessus auprès de ses élèves. Le teint, les cernes (j’en ai !), la poudre. Elle s’attarde ensuite sur mes yeux avec les consignes habituelles, les cils, le rimmel. La deuxième magicienne demande si Makine a été maquillé, on lui répond que non. J’en déduis que je ne le verrai que sur le plateau. J’ai le trac.
François Busnel passe une tête dans la pièce, me salue, me dit quelques mots gentils sur mon livre. Je suis encombrée par ma position captive face au miroir, mais je le remercie pour l’invitation en tournant à peine la tête. « N’hésitez pas à intervenir », dit-il. Et il disparaît.
Quand je retourne dans ma loge, Betty m’attend, elle lance « Formidable ! » en voyant l’effet du maquillage sur mes traits tendus et, en précieuse éditrice atypique, dégaine son appareil photo pour immortaliser l’instant devant l’affichette fixée sur la porte « Murielle Magellan, LGL ». La photo est réussie, à mon avantage, je ne le saurai que plus tard quand je la verrai sur les réseaux sociaux et que je la relaierai à mon tour.
C’est seulement sur le plateau que je vois Andreï Makine. Au moment où l’on nous demande de nous asseoir pour les essais son et lumière. Joseph Ponthus est à ma gauche. On a déjà fait connaissance ; il est passé pour se présenter, il a aimé mon livre et moi le sien, beaucoup. Makine est installé en face de moi. À peine suis-je assise qu’il plante ses yeux bleus dans les miens. Il me regarde avec une insistance slave, dirais-je. J’ai lu son roman. J’ai lu les scènes crues. Son héroïne Gaïa aux hanches larges qui s’abandonne dans l’acte sexuel, qui s’envoie en l’air à la fois tristement et joyeusement, dans un mouvement d’humiliation choisie, ou presque. Je ne suis pas vraiment étonnée de ce regard. Il est cohérent. Pensée libre, ancrée dans un corps animal, provocation « littéraire ». Il a quelque chose de faussement dangereux et ça m’amuse. De ma place en vis-à-vis, je pourrai l’observer.
Le départ est imminent ; on nous demande de quitter le plateau. C’est du direct. L’appréhension monte. En régie, les cinq écrivains patientent. Andreï Makine se met en queue de peloton. Quand le régisseur lui demande d’entrer le premier, il est gêné. Son accent russe roucoule : il n’aime pas passer devant les femmes. Je lui souris. Je suis concentrée. Je lui dis « Ce n’est pas un problème pour moi, allez-y. » Il hésite vraiment. Il parvient tout juste à se tenir à ma hauteur. Apparemment, ce n’est pas de l’affectation ; il ne veut pas nous-me « passer devant ». Il semble sincère et timide. Je me dis que c’est un tombeur.
L’émission est lancée. Je sens par bribes son intérêt, sa curiosité, pour ce qui vient de moi. Je ne crois pas me tromper. Je ne me trompe pas. Rien de compromettant cependant. Je sens plutôt une reconnaissance qu’il oubliera bientôt. J’en joue d’ailleurs en me servant de lui lors de l’une de mes interventions. Il hausse un sourcil étonné. Me répond. Il est érudit et son expression d’une grande fluidité. Je parviens à attraper quelques secondes d’espièglerie dans cet exercice d’équilibriste.
Roman
Laura n’imaginait pas Kondo si petit. D’ailleurs, elle ne l’imaginait pas vraiment. Elle connaît son visage car il est presque systématiquement imprimé au dos de ses publications, en format photo d’identité. Au fur et à mesure des années, la tête a blanchi et embelli, mais ne révèle toujours rien de la silhouette. Certes, l’écrivain a été reçu récemment dans l’une des rares émissions de télévision consacrées aux livres, mais il était assis, souvent filmé en gros plan, et donc sans corps, d’une certaine façon. En lisant Mishima, obsédé par sa chair douloureuse, morcelée, cherchant à se façonner des « muscles d’acier, bronzés, luisants », Laura s’était demandé pourquoi on ne voyait pas davantage à la télévision les écrivains dépliés, tels des acteurs offerts à l’objectif.
Dans la coulisse, debout à son côté, elle constate que Takumi Kondo mesure à peine dix centimètres de plus qu’elle, ce qui, pour un garçon, est peu. Paul est haut de 1 m 75 et a avoué plusieurs fois à Laura qu’il aimait la petite taille de sa femme car elle lui donnait la sensation de pouvoir la protéger, ce à quoi elle a répondu qu’elle espérait bien, du haut de ses 1 m 58, pouvoir le protéger aussi si nécessaire. Tout près de l’écrivain, Sanae Garrand, sa traductrice, n’est pas beaucoup plus grande, et Laura se dit que pour une fois, c’est Lartigue et ses 1 m 85 qui semblent venir d’une autre humanité. Elle se demande si c’est pour cela qu’il se balance d’un pied sur l’autre, encombré par sa morphologie en surplomb ? Ou simplement parce qu’il est inquiet de cette interview improvisée ? Qu’importe. Le journaliste aux rides avantageuses dégage une solidité de bourlingueur. Il sait que le trac n’est qu’un passage obligé. Il en a vu d’autres.
Toutefois, la tension est perceptible. Quelques minutes plus tôt, Kondo a été informé par Nadja de l’absence de Depussé et il en a été irrité. Il connaît bien ce spécialiste, qui a d’ailleurs préfacé l’un de ses ouvrages, et c’était l’une des raisons pour lesquelles il avait accepté l’invitation. N’y a-t-il vraiment plus aucune chance qu’il arrive, même en retard ? Nadja l’a déploré mais non. Plus aucune. Il a fini par murmurer, en regardant Lartigue et Laura qui assistaient à l’échange « Nous nous débrouillerons… » et il a ajouté « enfin, je l’espère… », ce qui n’a pas manqué de faire blêmir la petite troupe marmandaise.
Désormais les quatre intervenants sont installés sur la scène. Laura remarque immédiatement qu’il n’y a que trois micros et cela crée en elle une sensation contradictoire. Un soulagement, car elle ne devra prendre la parole que lorsqu’on la lui donnera, et une contrariété, exactement pour la même raison. Alors que Lartigue décline la biographie de l’auteur, elle remarque Paul, au premier rang ; il paraît terrorisé pour elle.
Kondo réagit à l’énoncé de sa biographie. Il confirme qu’il a longtemps hésité entre le sport et la création. Le sport lui apparaissait plus sain, moins pollué par une rivalité qui ne dit pas son nom. L’art ne l’intéresse que hors compétition, et pourtant la compétition souterraine est l’une des composantes du monde de l’art. Les artistes se comparent de façon aussi stupide que les Japonais qui, quand il était jeune, se mesuraient sans cesse au modèle américain ! Or, écrire n’avait de valeur à ses yeux que s’il s’extrayait de ce jeu-là. Il ne voyait plus grand monde pour pratiquer la littérature ainsi. En rapprochement. En amitié. En correspondance. Cette vérité taboue l’a longtemps handicapé et il préférait aller sur un terrain de tennis où l’affrontement est nommé et où la recherche de la perfection et de la beauté ne sont pas moins actives. Mais il avait fini par se rendre à l’évidence : il ne pouvait se passer d’écrire.
Laura s’agite. Tout ce qu’il dit là fait surgir en elle mille extraits de ses livres. Mille personnages aussi. Aya dans L’Étrangère volontaire, qui renonce à toute forme de comparaison, Kenzo et Yuri dans Tokyo nocturne, qui veulent battre des records sans cesse, et le vieux Ryu dans Vigilances. Le narrateur aussi, dans son dernier roman, devenu ce que les Japonais nomment un hikikomori, un jeune homme retiré volontairement du monde à la suite d’un événement que l’écrivain ne révèle jamais, mais dont un long paragraphe décrit la violence. Laura regarde la table sans micro. Elle voudrait entrer dans la discussion. Mais Lartigue est plongé dans ses notes, Kondo est concentré sur sa réponse et sa traductrice entièrement dévouée à son office. Personne ne voit que Laura trépigne. Tant pis. Son tour est passé puisque le journaliste local est déjà à sa prochaine question « Comment un écrivain vit Fukushima ? » – peu à l’aise avec la culture japonaise, Lartigue pense ainsi qu’en évoquant l’accident nucléaire de 2011, il saura rebondir, car il avait élaboré un dossier spécial dans les pages du journal. Il se souvient notamment de l’écrivain d’anticipation Furukawa pour qui il y avait un avant et un après Fukushima, ou encore du sociologue travesti Yasutomi qui estimait que le Japon était dans le déni de ce désastre majeur – Lartigue ose même « D’ailleurs, peut-être avez-vous écrit sur cet événement ? » Kondo tressaille. « Certainement pas ! » Il n’écrit jamais sur l’exceptionnel pour tous. Il écrit toujours sur l’exceptionnel pour l’un. Un qui est un personnage qu’on ne regarde pas, en général, mais qui vit quelque chose de hors-norme. Il ne nie pas qu’un événement de cette gravité puisse imprégner inconsciemment sa littérature, mais il ne sera jamais son sujet. Qu’est-ce qu’un écrivain peut apporter de plus ? Et il demande « Avez-vous vécu un grand amour, monsieur ? » Lartigue est surpris par la trivialité de la question. « Et vous, madame ? » Laura ouvre de grands yeux. Kondo enchaîne. « Quand on vit un grand amour, il se passe quelque chose d’exceptionnel. Je le pense vraiment. Aimer, quand ça engage l’être tout entier, la perte de contrôle, le glissement vers le vide, le trou noir, c’est exceptionnel. Mais c’est exceptionnel pour Un. L’autre regarde, confronte, envie, se moque. L’autre, c’est le lecteur qui engloutit cet exceptionnel qui ne lui est pas arrivé, mais pourrait lui arriver. » Kondo ne s’intéresse pas au collectif, à l’évolution des sociétés, au destin de l’humanité. Rien ne l’ennuie davantage que ces prédictions prétentieuses qui consistent à s’approcher au plus près de ce qui sera. Ce qui sera ne l’intéresse pas. Il a trop à faire avec ce qui est. Ni cause ni mission. Raconter, scruter, s’amuser. C’est tout ce qui intéresse Kondo. Il ne saurait vraiment pas quoi faire de Fukushima. Ni de la guerre. Ni des attentats.
Le ton est si ferme et fidèlement retransmis par la traductrice que Lartigue a reculé sur son siège et s’est légèrement voûté. Il pensait prononcer « Fukushima » sans risque. Un nom propre fédérateur, générateur de grands sujets, tant pour l’économiste, le politique, l’artiste, le chanteur révolté. Il se retrouve face à un écrivain vexé de façon si épidermique qu’à la manière d’un passeur de relais qui a raté sa course, Lartigue tend le micro à Laura.
Elle l’attrape. Le regarde. S’étonne. C’est un peu long. Pourquoi ne comprend-elle pas tout de suite qu’il faut qu’elle s’empare de la parole, elle qui l’a pourtant si vivement souhaitée ? Les yeux de Kondo et de sa traductrice se posent sur elle comme des pointes de feu. Il s’agit simplement de calmer le battement tempétueux dans son ventre. La moiteur de ses doigts. Il s’agit simplement de se lancer.
Journal
C’est lors du pot qui suit l’émission que l’échange a eu lieu : les écrivains, les attachés de presse, les éditeurs et l’équipe de La Grande Librairie s’y croisent. On se félicite. On se dit « C’était bien ». Éventuellement on râle un peu. Je n’ai pas dit ci, j’aurais dû citer ça. On vérifie « Vraiment, c’était bien ? » C’est inavouable, mais notre envie de toucher le lecteur est forte. Sauf à avoir la chance d’une reconnaissance bien installée, cette émission peut influencer la vie d’un livre. Comme tous, j’espère que ce roman creusera avec moi le sillon d’une voix que je tente de préciser texte après texte. Betty et l’attachée de presse me rassurent. Andreï Makine se tient là, discret, près de son accompagnateur. Moins inquiet que moi, il me sourit. Je papillonne, j’hésite. Et quand je le vois seul, je ne sais pas vraiment pourquoi, j’y vais. Je lui dis que j’ai trouvé son livre douloureux, pessimiste, presque tragique, mais libre. J’y vois de la provocation. Aussi, surtout, de la liberté.
Je suis sincère. Même si elles me choquent parfois, j’aime ces voix qui ne rejoignent pas les refrains ambiants ; ces voix qui interrogent le monde et son évolution sans idéologie, ou presque, en prenant en compte les aberrations de la nature humaine. Au-delà des frontières laisse une trace de désespoir mais surprend par son issue utopique, mégalomane : les héros se retrouvent à la fin du roman au fin fond de la Sibérie et repartent à zéro, en quelque sorte, pour imaginer un nouveau monde, une nouvelle humanité, fondés sur de tout autres valeurs que les nôtres. Avant cela, l’écrivain s’est amusé avec notre société, les extrêmes – droite et gauche – sont moquées à traits satiriques. Il y a du Brecht réac dans l’exagération du tableau. Le texte n’émeut pas mais tourmente ; ce n’est pas rien.
L’œil bleu de Makine s’éclaire. Ses « r » roulent et notre langue qu’il parle si bien chante tellement qu’on dirait la ligne de basse d’une ballade pop. « Oui, vraiment, de la liberté, c’est le plus important. Je crois beaucoup à cette troisième voie dont je parle, le prochain texte est là-dessus. Il y a mon être de naissance, il y a mon être social, et le troisième… la liberté. Ou plutôt… » Quoi ? « L’amour. Oui, on peut le dire ainsi. L’amour. » L’amour ? Tout simplement ? Et alors que j’aimerais lui demander de préciser, car je suis un peu décontenancée par cette réponse toute chrétienne – ou à la Jan Patočka –, il enchaîne « On se connaît, nous, non ? » Je bredouille « Heu… Moi, je vous connais, oui » [c’est un mensonge de politesse, je le connais en réalité très peu] mais je ne pense pas que lui me connaisse. « Si, si, on se connaît, je suis sûr. On ne s’est pas vus à Strasbourg ? » et il ajoute « On n’oublie pas une femme comme vous. » Le compliment me trouble. Dans le mille. Je cherche. Je sonde. Je suis allée quelques fois à la librairie Kléber à Strasbourg, mais je ne me souviens pas l’avoir croisé, et je suis sûre de ne pas avoir participé à une rencontre littéraire avec lui. Je m’en souviendrais. On n’oublie pas un homme comme lui. Je lui dis « Peut-être à la librairie Kléber ? J’y ai signé deux fois. Est-ce que vous vous souvenez qu’on s’est parlé ? » « Non, on s’est croisés… Je suis sûr… »
Ça me flatte et confirme la sensation identifiée plus tôt : je suis le genre de cet homme, et il est mon genre aussi, ou plutôt il l’a été, à une époque déjà racontée dans un livre. « On n’oublie pas une femme comme vous. » Cela pourrait suffire. Mais l’animal est allé plus loin. Dans un registre différent.
Roman
On ne sait pas comment, mais le plus souvent on surmonte l’insurmontable. On ne sait pas d’où ça vient, mais ce premier baiser qu’il faut donner, cette parole engageante qu’il faut prononcer pour obtenir davantage, cet avis qu’on nous demande, cette réclamation qu’on doit faire, tout cela, souvent – au prix d’un effort considérable, certes –, finit par arriver. Le temps passe et on ne se souvient plus de l’effort. Ne reste que la satisfaction de la chose accomplie.
C’est de cet endroit mystérieux que part la première parole de Laura. Elle n’est ni plus ni moins pertinente qu’une autre. Elle est simplement le début d’une immense audace « Quand vous évoquiez ce grand amour tout à l’heure, cet amour exceptionnel, j’ai pensé à votre roman Suspensions qui m’a beaucoup plu. »
Extrait
« Nadja jubile et distribue les verres de Dansefou, vin d’un producteur local talentueux, à qui veut s’enivrer avec elle. Elle enlace Laura et Paul, les félicite et les remercie un nombre de fois incalculable, obligeant Paul à répéter à l’envi « Je n’y suis pour rien ». Il est vrai que Paul n’avait pas mesuré l’étendue de la culture nippone de son épouse. Discrète, elle y fait peu allusion, et les quelques fois où elle s’était aventurée à lui raconter le contenu perturbant ou enthousiasmant d’un roman, au point de n’en pas dormir la nuit, il l’avait taquinée : comment pouvait-elle se laisser affecter par une histoire qui n’avait pas eu lieu, une histoire « inventée » ? N’avait-on pas déjà assez de soucis et d’émotions avec le réel ? Elle avait tenté, un jour, de faire une analogie avec la fascination que Paul portait aux couleurs, mais son époux, espiègle, ne voyait pas d’équivalence. Il avait beau s’enflammer pour certaines teintes (il est intarissable sur les pastels), il n’avait jamais fait d’insomnie pour un bleu cendre ou un rose lilas! »
À propos de l’auteur
 Murielle Magellan © Photo DR – éditions Mialet Barrault
Murielle Magellan © Photo DR – éditions Mialet Barrault
Murielle Magellan est romancière et dramaturge. Depuis Le Lendemain, Gabrielle (2007), elle a publié Un refrain sur les murs (2011), N’oublie pas les oiseaux (2014), Les Indociles (2016) et Changer le sens des rivières (2019). Géantes est son sixième roman. (Source: Éditions Mialet Barrault)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Compte instagram de l’auteur
Compte Linkedin de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
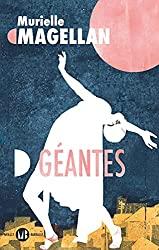


Tags
#geantes #MurielleMagellan #editionsMialetBarrault #hcdahlem #roman #RentréeLittéraire2021 #coupdecoeur #litteraturefrancaise #litteraturecontemporaine #VendrediLecture #motamot #rentreelitteraire #rentree2021 #RL2021 #livre #lecture #books #blog #littérature #bloglitteraire #lecture #jaimelire #lecturedumoment #lire #bouquin #bouquiner #livresaddict #lectrice #lecteurs #livresque #auteur #lectureaddict #litterature #instalivre #livrestagram #unLivreunePage #writer #reading #bookoftheday #instabook #Bookstagram #Book #Bookobsessed #bookshelf #Booklover #Bookaddict


