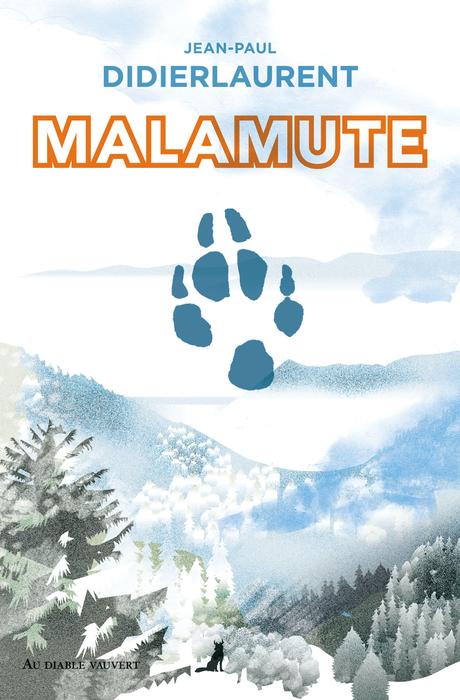
En deux mots
Le vieux Germain accepte d’accueillir son neveu Basile afin d’éviter l’EHPAD. Dans la ferme voisine une jeune fille vient d’emménager et va susciter leur intérêt pour des raisons très diverses. De fortes chutes de neige s’abattent sur leurs histoires…
Ma note
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique
Huis-clos noir dans un paysage blanc
Jean-Paul Didierlaurent, l’inoubliable auteur du Liseur de 6h 27, nous revient avec un récit très noir autour de trois solitudes qui vont remuer un lourd passé. Dans un massif montagneux pris par la neige, il va bouleverser leurs existences.
Est-ce parce qu’il a été écrit durant le confinement que ce nouveau roman nous plonge dans une atmosphère lourde, un huis-clos noir dans un massif couvert de neige? Toujours est-il que l’auteur du Liseur de 6h 27 décrit merveilleusement bien ce décor et cette ambiance oppressante.
Tout commence par l’extrait d’un journal intime rédigé en 1976 par une femme qui a émigré des Balkans pour commencer une nouvelle vie dans les Vosges. Le projet de Dragan, son mari est d’élever des Malamute, chiens de traineau originaires de l’Alaska, pour proposer des balades aux touristes. Mais on en saura pas davantage pour l’instant, car on bascule en 2015, au moment où Germain est confronté à un choix cornélien. Ce vieil homme vit seul dans sa ferme et ne demande rien à personne. Sauf qu’il avance en âge et commence à avoir quelques soucis. De petits accidents qui inquiètent sa fille Françoise, installée à Marly-le-Roi. Aussi décide-t-elle de laisser son père choisir s’il va en EHPAD ou s’il accepte la compagnie de Basile, son lointain neveu, qui a accepté de veiller sur lui. «Entre la peste et le choléra, il avait choisi la peste», même s’il n’entend rien céder de sa liberté. Au volant de son van aménagé, Basile vient pour sa part tenter d’oublier le drame qu’il a vécu deux ans auparavant, lorsqu’une fillette s’est fracassée avec sa luge sur sa dameuse, lui qui est chargé de préparer les pistes aux skieurs. Alors que les deux ours essaient de s’apprivoiser, Basile fait la connaissance d’Emmanuelle, leur voisine. Une autre solitaire qui exerce le même difficile métier que lui, au volant de son engin de damage sophistiqué, un Kässbohrer PistenBully 600 Polar SCR pour les spécialistes. On ne va pas tarder à comprendre qu’Emmanuelle Radot est en fait la fille de Pavlina Radovic et qu’elle est revenue vivre dans la ferme où ses parents s’étaient installés quarante ans plus tôt.
Si Germain se réfugie dans sa cave où il fait de la dendrochronologie, c’est-à-dire qu’il étudie des tranches d’arbres remarquables, les lisant «de la même manière que d’autres lisent les livres, passant d’un cerne à un autre comme on tourne des pages, sans autre prétention que celle d’interroger les géants sur la marche du temps, à la recherche d’une certaine logique dans ces successions concentriques», il se rappelle aussi qu’il a bien connu la mère d’Emmanuelle.
Après le départ de Françoise, venue passer le réveillon auprès de son père, le temps s’était adouci au point que les habitants ont organisé une procession pour faire venir la neige. «Que la neige soit avec nous, que son règne vienne! Que la neige soit avec nous, que son règne vienne!»
Leurs vœux seront exaucés bien au-delà de leurs attentes et c’est dans un enfer blanc que la part d’ombre de chacun va peu à peu se dévoiler.
En insérant les extraits du journal intime de Pavlina tout au long du roman, Jean-Paul Didierlaurent fait remonter le passé à la surface du présent et dévoile des blessures encore vives. Et quand viennent les ultimes révélations, on est passé du roman blanc au roman noir. La parenté avec son compatriote vosgien Pierre Pelot est alors une évidence. Mêmes décors, mêmes histoires d’hommes confrontés au poids du passé, chargés de lourds secrets. Qui a écrit que la géographie, le climat dans lequel on vit était consubstantiel à l’œuvre que l’on écrit? Ajoutons-y une puissance de narration qui vous emporte et vous comprendrez que Jean-Paul Didierlaurent est ici au meilleur de sa forme!
Malamute
Jean-Paul Didierlaurent
Éditions Au Diable Vauvert
Roman
360 p., 18 €
EAN 9791030704198
Paru le 11/03/2021
Où?
Le roman est situé en France, principalement dans un massif montagneux de l’Est. Sans être nommé, on reconnaîtra La Bresse et ses environs où vit l’auteur derrière «La Voljoux». On y évoque aussi Marly-le-Roi, Courchevel, les Deux Alpes, Tignes, Paris, Lyon ainsi que Basoko, Kinshasa et Brazzaville.
Quand?
L’action se déroule de avril 1976 à 2015.
Ce qu’en dit l’éditeur
« Un rêve avorté, des secrets bien gardés, un vieil homme bougon et de la neige, beaucoup de neige… les ingrédients qui participent à la réussite de Malamute. Qu’on se le dise : Jean-Paul Didierlaurent est définitivement un merveilleux conteur. » LIBRAIRIE COIFFARD
« L’auteur brosse merveilleusement l’atmosphère oppressante de ce huis-clos montagnard, composé de mystères, mais aussi de personnages truculents. Drame rural, intrigue, suspense, un zeste de fantastique, ce magnifique roman est tout à la fois ! » LIBRAIRIE DE PORT MARIA
« Quel beau roman ! Beaucoup d’émotion sous des mètres de neige ! » LIBRAIRIE POLINOISE
« Une écriture fluide qui nous emporte. » LIBRAIRIE RUC
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France Bleu Lorraine (Portrait lorrain – Sarah Polacci)
Bande-annonce de Malamute de Jean-Paul Didierlaurent © Production Librairie Mollat
Les premières pages du livre
« Journal de Pavlina Radovic (traduit du slovaque) Avril 1976
Deux jours, nous avons mis deux jours pour franchir les mille trois cents kilomètres qui nous séparaient de notre nouveau domicile. Dragan avait espéré boucler le parcours en moins de vingt-quatre heures, le temps qu’il lui avait fallu les fois précédentes pour atteindre sa destination. C’était sans compter la remorque et les chiens. Pendant ces deux jours de route, les bêtes n’ont pas cessé d’aboyer et de grogner d’excitation, les babines écumantes de rage, comme pressées d’en découdre avec un ennemi invisible. Nous avons traversé plusieurs pays, franchi des fleuves larges comme deux autoroutes, longé des villes immenses, des champs infinis, des collines couvertes de vignobles, des plaines verdoyantes parsemées de villages au nom imprononçable. À mi-parcours, l’un des pneus de la remorque a éclaté et nous avons failli verser dans le fossé. Je frissonne encore à l’idée que notre aventure aurait pu s’achever au milieu de nulle part dans un bas-côté rempli d’eau croupissante, coincés entre le rêve vers lequel nous roulions et la vie que nous venions de laisser dans notre dos. L’idée d’échouer si près du but, de devoir rebrousser chemin pour retourner au pays me faisait horreur. Retrouver cette vie étroite dans laquelle je me trouvais confinée, à barboter tel un poisson dans une mare devenue trop petite, m’aurait été insupportable. Avant de changer la roue, Dragan a dû calmer les chiens qui hurlaient à la mort. Plus loin, le voyant de surchauffe moteur nous a contraints à un nouvel arrêt sur la première aire venue pour remettre du liquide de refroidissement. Les passages en douane nous ont beaucoup ralentis. Un temps précieux perdu pour des douaniers méticuleux, qui ont épluché un à un les carnets de vaccination des quatre malamutes et contrôlé leurs tatouages. Et à chaque fois l’obligation pour moi d’apaiser Dragan, de le raisonner, de lui dire que tout cela n’était rien, que l’arrivée à la maison, notre maison, n’en serait que plus belle. De la ferme, je ne connaissais que les rares photos qu’il m’en avait montrées. Plus que les clichés, c’est son enthousiasme contagieux qui m’a convertie à son projet. Ça et le besoin irrépressible d’aller respirer un autre air, de partir avant de me retrouver définitivement prisonnière de l’usine qui emploie tout le village, à mouler à longueur de jour des pièces comme mon père et mes frères, à respirer dans la fournaise et le fracas des presses ces horribles émanations de caoutchouc et d’huile chaude qui empuantissent l’atmosphère et que la plupart d’entre nous finissent par ne même plus sentir. Le jour où tu ne les sens plus, m’a dit une fois une collègue à la pause déjeuner, c’est qu’il est trop tard, que ton corps et ton esprit appartiennent totalement à l’usine. Depuis plus de quinze ans que j’y bosse, l’opératrice de fabrication que je suis ne manque jamais de vérifier chaque matin à son arrivée que son nez parvient encore à percevoir la puanteur. Toutes ces années passées à attendre Dragan, je me suis raccrochée à cette puanteur comme on se raccroche à une douleur qui nous rappelle qu’on est toujours vivant, que la mort n’a pas gagné, pas encore. Le mariage, les papiers, tout est allé si vite. Pour l’argent, je n’ai jamais vraiment su d’où il venait et je préfère ne pas savoir. Je n’ai pas posé de questions. Trop peur des réponses. L’argent n’a jamais été un problème pour Dragan, ni avant ni après la légion. Parti à vingt-deux ans pour s’engager, il est revenu à trente-six comme s’il était parti la veille, avec, glissé dans son portefeuille, son Sésame pour la France, une carte de résident que les quatorze années passées sous le béret vert lui avaient accordée. Un beau matin, il était là, devant la maison, à piétiner sur le trottoir, fumant cigarette sur cigarette en attendant de trouver le courage d’aller demander ma main au vieux. Il a connu des guerres, je le sais. L’Algérie, le Tchad et bien d’autres encore, toutes plus sanglantes les unes que les autres. Comme pour l’argent, je n’ai pas posé de questions sur ce trou de quatorze ans dans lequel il lui arrive de se noyer parfois. Des absences pendant lesquelles son regard se fait lointain et son corps s’avachit sur lui-même, vidé de ses forces. Je n’aime pas ces absences. Toujours cette crainte au fond de moi qu’un jour il n’en revienne pas. Depuis notre départ, le sac de toile ne m’a pas quittée et pèse agréablement sur mes cuisses. De temps à autre, je sers contre mon ventre son contenu. Une trentaine de livres qui à eux seuls constituent toutes mes richesses. Je n’ai pas pu tous les emporter, il m’a fallu faire des choix, en abandonner certains pour en sauver d’autres. Des auteurs russes pour beaucoup. Là où mes amies passaient leurs maigres économies à s’étourdir d’alcool et de danses le week-end, jusqu’à l’abrutissement, j’ai toujours préféré trouver refuge dans les livres. Eux seuls possèdent ce pouvoir fantastique de m’arracher, le temps de la lecture, à la fange dans laquelle je me débats à longueur de jour. La forêt nous a engloutis à la tombée de la nuit. Un corridor d’immenses sapins noirs de part et d’autre du ruban d’asphalte. La route a serpenté sur plusieurs kilomètres à flanc de montagne. De temps à autre, une trouée dans la forêt nous laissait entrevoir en contrebas les lumières de la plaine que nous venions de quitter. Les virages en lacet ont fini par me donner la nausée. Le 4X4 a franchi le sommet du col avant de basculer vers la vallée qui scintillait comme si la main d’un géant avait semé au pied de la montagne une multitude de diamants. Lorsque le panneau d’entrée du village a surgi dans les phares, j’ai crié de joie malgré mon cœur au bord des lèvres et applaudi comme une gamine. La Voljoux. J’aime ce nom qui contient tous nos espoirs. Ça sonne comme bijou, caillou, chou, genou, hibou, mes premiers mots appris en français. Je les ai répétés dans la voiture en chantonnant, bijou, caillou, chou, genou, hibou, Voljoux, encore et encore, jusqu’à ce que Dragan me demande d’arrêter. Tu es encore plus excitée que les bêtes, il a dit en souriant. J’aime lorsqu’il sourit, son visage s’éclaire de l’intérieur. Après avoir traversé le village endormi, nous avons gravi le versant opposé et puis la ferme était là, posée au milieu du pré, à moins de vingt mètres de la route. Une masse sombre ramassée sur elle-même, comme écrasée par son propre toit et qui se découpait sur l’herbe éclaboussée par l’éclat laiteux de la lune. La clef serrée dans le creux de ma main avait pris la chaleur de ma paume. Comme si elle rechignait à s’ouvrir, la porte a gémi sur ses gonds lorsque Dragan l’a poussée. L’interrupteur a émis un claquement sec, sans résultat. Le courant n’avait pas été rétabli malgré la demande faite auprès de la compagnie d’électricité. Il a encore actionné le commutateur à deux reprises avant de cracher un juron. Kurva! Nous sommes entrés chez nous tels des voleurs. La ferme s’est révélée à moi par petites touches à travers le faisceau de la torche. Le cercle de lumière jaune a glissé sur le papier peint des murs, rampé sur le carrelage du couloir, s’est promené sur le formica des meubles de la cuisine. Ma nausée a redoublé d’intensité lorsque l’odeur de moisissure et d’humidité emprisonnée derrière les volets clos s’est engouffrée dans mes narines. J’ai vomi dans l’évier en pierre un long jet acide. Le robinet a hoqueté par deux fois avant de crachoter un filet d’eau glaciale. Je me suis aspergé le visage et ai bu à même le col de cygne pour éteindre l’incendie dans le fond de ma gorge. Dragan s’est occupé des chiens puis s’est effondré sur le matelas posé sur le sol de la chambre, ivre de fatigue. Il m’a fallu du temps pour trouver le sommeil. Il y avait ce mot qui tournoyait dans ma tête comme une mouche dans un bocal, ce premier mot prononcé par Dragan dans la maison, un juron qui avait résonné désagréablement à mes oreilles avant que la nuit ne l’avale : kurva. Un mot étranger qui n’avait pas sa place ici.
Avant même de quitter son lit, Germain sut qu’elle était là. Les sons feutrés disaient sa présence, tout comme la clarté intense du dehors que peinaient à contenir les volets. Une excitation toute enfantine s’emparait à chaque fois du vieil homme au moment de la retrouver et il dut refréner l’envie de se ruer vers la fenêtre. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, la phrase préférée que ce trou du cul de kiné d’à peine vingt ans lui rabâchait à chacune de ses visites hebdomadaires. « Les bœufs avant la charrue, je sais », grommela Germain pour lui-même. Attendre que le sang irrigue de nouveau l’extrémité de ses membres engourdis avant même de penser à chausser les pantoufles. Il grimaça. Constater à chacun de ses réveils que son organisme n’était plus que ruine constituait une souffrance plus terrible encore que les douleurs physiques. Il en arrivait à envier parmi ses congénères ceux partis vadrouiller au pays des absences sur le continent Alzheimer, l’esprit envolé avant le corps, en éclaireur. La tête, pensa le vieil homme, c’est ça le vrai problème. Trop claire la tête, trop consciente de la décrépitude de tout le reste. À quatre-vingt-quatre ans, ses sens se délitaient les uns après les autres, insidieusement. Un voile de cataracte devant les yeux, des bourdonnements dans les oreilles, autant de petites morts qui vous mettaient en retrait du monde. Il patina vers la fenêtre. Ses pas allaient gagner en assurance au fil de la journée mais les premiers mètres restaient délicats à négocier. Se concentrer, avancer un pied après l’autre. Un train de tortue pour ne pas finir avec le cul de la charrue par-dessus la tête des bœufs.
La lumière vive se rua dans ses rétines en une myriade d’aiguilles lorsqu’il ouvrit les volets. Son flair ne l’avait pas trompé. Elle était arrivée pendant la nuit, précédée la veille au soir par cette odeur propre à elle seule, indéfinissable, qui laissait ce drôle de goût de métal sur le palais. La neige. Près de vingt centimètres d’une neige lourde que venaient caresser les dernières écharpes de brume abandonnées par la nuit. L’hiver refermait ses mâchoires sur l’automne avant même la Saint-Albert, comme pressé d’en finir, mais ça ne durerait pas, le vieil homme le savait, les arbres lui avaient dit, c’était écrit dans leur chair, et les arbres ne mentaient jamais. Il ne fallait voir dans cette précocité qu’un caprice météorologique sans lendemain. En attendant Germain n’aimait pas ça, cette neige posée sur les dernières feuilles rescapées de l’automne. Yeux plissés, il attendit que ses pupilles domptent l’éblouissement avant de relever la tête. La carcasse mangée par la rouille de l’antique Renault 4 adossée au hangar de la ferme se parait ce matin d’une robe immaculée. Les marches de granit menant au jardin disparaissaient sous une cascade d’ondulations blanches. Couvert de neige collante, le grillage du vieux poulailler s’étirait en une dentelle délicate. Cette faculté d’embellir les choses même les plus laides, d’étouffer le fracas du monde, d’adoucir les angles, de combler les creux, d’aplanir les bosses fascinait l’octogénaire. Même les grands sapins n’étaient plus que rondeurs une fois dissimulés sous leur manteau. Les gens de la ville, tous ces gens de l’asphalte, c’est ainsi qu’il se plaisait à les nommer, ne voyaient en elle qu’un fléau froid et envahissant dont il fallait nettoyer les routes le plus rapidement possible, quand ils ne louaient pas au contraire sa venue à l’approche des vacances, ne comprenant pas qu’elle tarde à arriver. Germain lui n’avait jamais considéré la neige autrement que pour ce qu’elle était : une évidence qui revenait chaque hiver recouvrir le massif, une vieille connaissance que l’on devait accepter comme elle était et qui n’avait que faire qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas.
Une fois le challenge journalier de l’enfilage de vêtements relevé avec succès, Germain remonta à petits pas le couloir glacial et pénétra dans la cuisine où régnait une chaleur agréable. Mieux que les injonctions de sa fille, le poids des corbeilles de bois avait eu raison de ses ultimes réticences à faire installer le chauffage central. Il devait bien admettre aujourd’hui que cette concession au confort, un confort obéissant à la simple rotation d’un robinet thermostatique, facilitait la vie, même si le discret ronronnement de la chaudière ne remplacerait jamais le joyeux crépitement d’une bûche dans le foyer de la cuisinière. Le vieil homme réchauffa le café de la veille puis attrapa le stylo suspendu à la ficelle sous le calendrier punaisé sur le mur et encercla la date du jour. 14 novembre 2015. Il avait perpétué cette habitude de sa défunte femme de marquer ainsi l’arrivée de la neige. Clotilde aimait consigner les choses, des choses aussi insignifiantes que la chute des premiers flocons. De la même manière elle se plaisait à s’emprisonner l’existence dans un corset d’habitudes, le feuilleton télé du début d’après-midi, la séance de cinéma du lundi avec les amies, les cours de poterie du mardi soir, le marché du mercredi matin, la médiathèque le vendredi, la pâtisserie du dimanche, autant d’œillets où glisser le lacet pour bien enserrer les jours, et avancer d’un rendez-vous à un autre sans avoir à contempler l’abîme du temps qui passe. Sans parler de cette manie exaspérante de dresser la table du petit-déjeuner pour le lendemain avant l’heure du coucher, comme on dresse un pont entre deux rives. Le vieil homme déjeuna d’une demi-tranche de pain accompagnée d’un soupçon de confiture. Son appétit l’avait abandonné. En lieu et place des casse-croûtes gargantuesques de sa jeunesse, c’était le pilulier qui l’attendait à présent sur la toile cirée, avec ces gélules qu’il avalait mécaniquement sans même savoir à quoi elles pouvaient bien servir. Chaque matin, le pilulier était là, une évidence avec laquelle, comme pour la neige au-dehors, il lui fallait bien faire avec.
Debout sur le perron, il extirpa de la poche de son gilet le paquet de cigarettes, saisit une cibiche du bout de ses doigts calleux et en tapota le cul machinalement sur le dos de sa main. Au moment de l’allumer, la voix de Françoise sa fille résonna sous son crâne : « Cette cochonnerie va finir par te tuer. »« La vie finit toujours par nous tuer », lui rétorquait-il, réplique qui la mettait hors d’elle. Le capot du briquet à essence claqua dans le silence. La première bouffée de la journée, la meilleure, songea Germain en tirant d’aise une longue taffe. Il releva la tête en direction des piquets de déneigement rouge et blanc plantés sur le bord de la route. Avec l’âge, la distance entre la maison et la chaussée lui paraissait chaque hiver un peu plus grande, comme si une main divine se plaisait à distendre l’espace pour lui rendre la tâche plus rude encore. Il cracha un glaviot épais qui disparut dans la neige et tourna la tête en direction de la ferme voisine. La bâtisse reposait sur l’étendue blanche du pré tel un chicot sale. Une fumée grise montait paresseusement dans le ciel. L’octogénaire frissonna. Il n’avait plus vu cette cheminée fumer ainsi depuis la fin des années soixante-dix. Quelqu’un habitait à nouveau l’endroit. Une jeune femme, d’après ce que sa cataracte lui avait permis de deviner à travers le carreau la semaine précédente tandis qu’elle déchargeait du coffre de sa voiture des sacs de provisions. Sûrement une saisonnière qui n’avait rien trouvé de mieux pour se loger sur la station que cette bicoque délabrée. Il repensa à l’ancienne voisine, à sa présence éthérée emprisonnée toutes ces années entre Clotilde et lui, comprimée entre leurs deux silences. Depuis le décès de son épouse, le souvenir de la femme avait forci. Un poison toujours plus nocif. Elle survenait dans la mémoire de Germain en fulgurances aussi précises que douloureuses. La silhouette gracile, l’éclat du regard, la voix chantante, cette façon si particulière de prononcer les mots, autant de résurgences coupables tandis que l’image de Clotilde, elle, ne cessait de s’affadir au fil des ans. Il cracha un nouveau glaviot, empoigna le manche de la pelle rangée sous l’auvent de l’entrée et contempla d’un air las la boîte aux lettres plantée en bordure de propriété une vingtaine de mètres plus haut. Vingt mètres qui lui en paraissaient cent.
Le raclement de la pelle sur les dalles de la cour, fer contre pierre, rythmait la progression du vieil homme. Germain procédait en gestes mesurés. Pousser en fléchissant les genoux, basculer son buste vers l’arrière et verser la pelletée sur le côté. Ne pas emballer le cœur. Dans l’effort, ses poumons, deux soufflets de forge tapissés de goudron par des années de tabagisme, laissaient plus fuir d’air qu’ils en avalaient mais tant que ses mains posséderaient encore la force de serrer un manche de frêne, il continuerait de déneiger de la sorte. La turbine à neige offerte par sa fille pour son quatre-vingtième anniversaire prenait la poussière au fond du garage. Lors de son unique utilisation, la machine pétaradante avait goulûment avalé l’équivalent d’un demi-mètre cube d’or blanc avant de caler, la gueule obstruée de neige lourde. L’engin de malheur lui avait arraché le bâton des mains tandis qu’il tentait d’en désengorger la cheminée. Il avait repris la pelle. On n’avait jamais vu une pelle se retourner contre son maître. Un quart d’heure fut nécessaire à Germain pour atteindre le bourrelet du chasse-neige, un rempart de près d’un mètre de haut constitué de blocs compacts, mélange de neige et de potasse que le vieil homme piqueta du bout de la pelle sans conviction. »
Extrait
« Germain lisait les arbres de la même manière que d’autres lisent les livres, passant d’un cerne à un autre comme on tourne des pages, sans autre prétention que celle d’interroger les géants sur la marche du temps, à la recherche d’une certaine logique dans ces successions concentriques. L’arbre du jour présentait soixante-quatre cernes. Après un rapide calcul, l’octogénaire inscrivit sur le registre l’année où l’arbrisseau était sorti de terre: 1951. Une rapide consultation de l’encyclopédie chronologique lui apprit que le hêtre qu’il avait sous les veux avait pointé ses premières feuilles l’année de la mort de Pétain. » p. 73-74
À propos de l’auteur Jean-Paul Didierlaurent © Photo DR
Jean-Paul Didierlaurent © Photo DR
Jean-Paul Didierlaurent vit dans les Vosges. Nouvelliste lauréat de nombreux concours de nouvelles, deux fois lauréat du Prix Hemingway, son premier roman, Le Liseur du 6h27, connaît un immenses succès au Diable vauvert puis chez Folio (370.000 ex vendus), reçoit les prix du Roman d’Entreprise et du Travail, Michel Tournier, du Festival du Premier Roman de Chambéry, du CEZAM Inter CE, du Livre Pourpre, Complètement livres et de nombreux prix de lecteurs en médiathèques, et est traduit dans 31 pays. Il est en cours d’adaptation au cinéma. Jean-Paul Didierlaurent a depuis publié au Diable vauvert un premier recueil de ses nouvelles, Macadam, Le Reste de leur vie, roman réédité chez Folio, et La Fissure. (Source: Éditions au Diable vauvert)
Page Wikipédia de l’auteur
Page Facebook de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)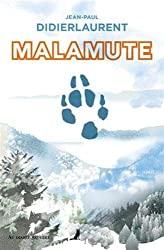



Tags:

