Sélection Prix Renaudot 2020
Sélection prix Le Temps retrouvé 2020
En deux mots:
Envoyé en Bretagne par son rédacteur, David Bourricot va essayer de noyer son spleen dans une enquête qui va tout à la fois réveiller ses souvenirs d’enfance et le mettre sur la piste d’un trafic, aidé en cela par quelques personnages hauts en couleur.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
L’enquête qui devient une quête
Le troisième roman d’Anthony Palou, La faucille d’or, met en scène un journaliste revenant dans son Finistère natal pour enquêter sur un marin-pêcheur disparu. Un voyage qui est aussi l’occasion d’un bilan.
Pour le journaliste David Bourricot, les ficelles du métier sont déjà bien usées. Le vieux baroudeur de l’information est bien désabusé et n’accepte que du bout des lèvres la proposition de son rédacteur en chef de partir en Bretagne pour enquêter sur la disparition, somme toute banale, d’un marin en pleine mer.
Arrivé dans sa région natale, ses premières impressions n’ont pas vraiment de quoi l’enthousiasmer: «Hôtel du Port. De la chambre de tribord. Temps gris et frais. Très frais. Vue sur la mer peu agitée. Petites vagues. Moutons nombreux. L’ennui des dimanches, toutes mes vacances d’enfant au Cap Coz. Pourquoi faut-il que je revienne là où mon entrepreneur de père ma vacciné contre les méfaits de la mer? Là où ne sachant trop quoi faire, je me prenais pour Marco Polo, pour Magellan, Tabarly.» Il faut dire qu’il trimballe avec lui un lourd passé. En décembre 1994 sa femme avait perdu leur fille Cécile en accouchant et jusqu’à la naissance de leur fils César, elle ne s’était jamais vraiment remise de ce drame. «Elle resterait toujours froide, froide et frigide. Une pierre tombale.»
Mais est-ce l’air du large qui lui vivifie les neurones? Toujours est-il qu’il retrouve peu à peu l’envie d’en savoir davantage sur ce fait divers, aussi titillé par l’immense défi qu’il lui faut relever: tenter de faire parler des taiseux qui n’aiment pas trop voir débarquer les «fouille-merde», fussent-ils enfants du pays.
Mais il va finir par trouver son fil d’Ariane en la personne de Clarisse, la veuve du défunt, qui va lui lâcher quelques confidences sur l’oreiller. Il va alors pourra remonter à la source et mettre à jour la seconde activité – lucrative – de certains marins-pêcheurs. Il apprend que leurs bateaux sont mis à disposition des trafiquants de drogue pour acheminer discrètement la marchandise.
Un peintre nain, Henri-Jean de la Varende, va aussi le prendre sous son aile sans pour autant qu’il puisse définir s’il le guide ou le perd dans sa quête. La patronne du bistrot, qui recueille toutes les histoires et ragots, lui sera plus précieuse.
Anthony Palou, en mêlant les souvenirs d’enfance à l’enquête journalistique, va réussir à donner à son roman une couleur très particulière, plus poétique au fil des pages, à l’image du reflet d’un croissant de lune sur la mer qui a inspiré Victor Hugo pour son poème Booz endormi et qui donne son titre au livre:
Immobile, ouvrant l’œil à moitié sous ses voiles,
Quel dieu, quel moissonneur de l’éternel été,
Avait, en s’en allant, négligemment jeté
Cette faucille d’or dans le champ des étoiles.
Sous des faux airs de polar finistérien, ce roman cache un drame qui va chercher au plus profond les ressorts d’une existence sans pour autant oublier l’humour. Autrement dit, une belle réussite!
La faucille d’or
Anthony Palou
Éditions du Rocher
Roman
152 p., 16 €
EAN 9782268104201
Paru le 2/09/2020
Où?
Le roman se déroule en France, principalement en Bretagne, sur les Côtes du Finistère, en particulier à Penmarc’h ainsi qu’à Paris.
Quand?
L’action se situe de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
En reportage dans le Finistère, cette « fin de la terre » de son enfance, un journaliste quelque peu désabusé, s’intéresse à la disparition en mer d’un marin-pêcheur. Une manière d’oublier sa femme et son fils, qui lui manquent. Préférant la flânerie à l’enquête, David Bourricot peine à chasser ses fantômes et boucler son papier, malgré les liens noués avec des figures du pays : la patronne du bistrot où il a ses habitudes, un peintre nain, double de Toulouse-Lautrec, ou encore Clarisse, la jolie veuve du marin-pêcheur. Retrouvera-t-il, grâce à eux, le goût de la vie?
Roman envoûtant, porté par des personnages fantasques et poétiques, La Faucille d’or allie humour et mélancolie, dans une atmosphère qui évoque à la fois l’univers onirique de Fellini et les ombres chères à Modiano.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Revue des Deux-Mondes (Pierre Cormary)
L’Officiel (Jean-François Guggenheim)
Le Courrier + (Philippe Lacoche)
Le Télégramme (Jean Bothorel)
INCIPIT (Les premières pages du livre)
1 Un drôle de Noël
Ce soir-là, David Bourricot quitta son deux-pièces de la rue Bougainville, traversa l’avenue de la Motte-Piquet et battit la semelle rue Clerc tout illuminée. Elle grouillait de retardataires ainsi qu’il sied la veille de Noël. Tous ces gens lui semblaient vieux et rabougris, spectres ployant sous le poids de leurs achats, huîtres creuses ou plates, chapons, dindes et foie gras, boudins blancs, noirs, violets et bûches. Il devait être dix-neuf heures trente lorsqu’il s’arrêta à la boucherie. Il hésita entre une bonne tranche de gigot et ce bout de cuissot de sanglier. Va pour le cuissot. Puis il fit un crochet chez l’admirable pharmacienne. David avait toujours préféré aux actrices et aux chanteuses la boulangère, la poissonnière ou la fleuriste, n’importe quelle présence anonyme, n’importe quel fond d’œil, à la seule condition qu’il puisse apprécier une présence dans l’iris. À la pharmacienne rêvée, il demanda une boîte de Maalox goût citron sans sucre, du Vogalib et du citrate de bétaïne. Le réveillon s’annonçait sous les meilleurs auspices.
Trois semaines que David traînait ces aigreurs d’estomac. Son organe digestif était sans doute dans un sale état. Il avait pourtant arrêté l’ail, les oignons et les jus d’orange sanguine. Il n’avait pas arrêté le vin blanc. Un de ses amis médecin mettait ces remontées acides sur le dos du stress, il lui avait dit aussi qu’il devait arrêter de fumer, qu’il devait se sentir coupable de quelque chose. Ces relents le rendaient parfois irascible et ce n’étaient pas ces fêtes de fin d’année qui allaient arranger ses affaires. Bourricot flirtait avec les quarante-cinq ans et il avait le funeste pressentiment qu’il allait débarrasser le plancher d’ici peu. Son temps lui semblait sérieusement compté.
Nous étions donc le 24 décembre et il allait dîner. Seul. Il n’était pas spécialement déprimé, il était tout simplement là. Là, là, là. Comme déposé sur terre à ne plus rien faire. Puis, traînant ses godasses, il rentra chez lui, s’offrit un gin tonic devant BFMTV et, peu avant minuit, réchauffa au four son cuissot. Une vraie carne. Tellement pas mastiquable qu’il eût bien aimé qu’un chien surgisse de dessous de la table, histoire de faire un heureux. C’était la première fois qu’il se retrouvait face à lui-même lors d’un réveillon de Noël. Sa femme avait pris, ce matin, le train pour La Rochelle avec leur fils si chahuteur, César. Comme on dit dans les émissions de téléréalité, il y avait de « l’eau dans le gaz » entre David et Marie-Hélène. Les ports sont assez commodes pour ceux ou celles qui veulent prendre le large. Mais ils partent rarement. Contrairement aux bagnards qui n’avaient pas, à l’époque, trop le choix. « Après tout, pensait David, Marie-Hélène ne me quittera jamais. » Toujours, elle resterait à quai. Pour lui ? À cette heure-ci, ils auraient dû, tous les trois, papa, maman et ce si cher fiston, en être à la bûche, peut-être à la distribution des cadeaux. Sur le sofa, David posa à côté de lui le présent que César lui avait si gentiment offert, une petite boîte dans laquelle il y avait deux coquillages peints et ce mot, tout tremblotant, ce mot gribouillé : Je t’aime, papa. Alors, David se souvint de ce poème en prose de Coventry Patmore, Les Joujoux, et il se le récita d’une manière un peu bancale : Mon petit garçon dont les yeux ont un regard pensif et qui dans ses mouvements et ses paroles aux manières tranquilles d’une grande personne, ayant désobéi pour la septième fois à ma loi, je le battis et le renvoyai durement sans l’embrasser, sa mère qui était patiente étant morte. Puis, craignant que son chagrin ne l’empêchât de dormir, j’allai le voir dans son lit, où je le trouvai profondément assoupi avec les paupières battues et les cils encore humides de son dernier sanglot. Et je l’embrassai, à la place de ses larmes laissant les miennes. Car sur une table tirée près de sa tête il avait rangé à portée de sa main une boîte de jetons et un galet à veines rouges, un morceau de verre arrondi trouvé sur la plage, une bouteille avec des campanules et deux sous français, disposés bien soigneusement, pour consoler son triste cœur ! Et cette nuit-là quand je fis à Dieu ma prière je pleurai et je lui dis : « Ah, quand à la fin nous serons là couchés et le souffle suspendu, ne vous causant plus de fâcherie dans la mort, et que vous vous souviendrez de quels joujoux nous avons fait nos joies, et combien faiblement nous avons pris votre grand commandement de bonté. »
Et il versa quelques larmes, lui qui n’en avait franchement pas versé beaucoup. David n’avait pas le cœur sec, contrairement à son gosier. À l’enterrement de sa mère – quatre ans déjà ? –, il n’avait eu bizarrement aucune émotion et toute la famille l’avait regardé d’un œil torve. Pas un signe d’émotion. Aucune vague, aucune ride sur son visage. Devant le cercueil de cette femme si aimée, l’esprit de David s’était envolé, il pensait à autre chose, pas à ces roses tristement blanches déposées ici et là, pas à la crémation, à venir, non, il pensait aux oiseaux, il pensait à ce merle moqueur qui chaque matin le réveillait comme sa mère le réveillait, le caressait d’un si doux baiser alors qu’il devait prendre le chemin de l’école.
Notre ami David s’était, adolescent, pincé d’ornithologie, mais il n’avait pas vraiment de violon d’Ingres. Il s’était vu pigeon voyageur à Venise, il s’était plané mouette à Ouessant, il s’était niché cigogne sur une flèche de cathédrale alsacienne, enfin il s’était rêvé bouvreuil pivoine du côté de la forêt de Fontainebleau à l’heure où le soleil se tait, à l’heure où la demi-lune, toujours royale et fière, montre sa nouvelle coiffure, sa raie de côté. Il avait appris dans un manuel que le bouvreuil pivoine, si on lui siffle une mélodie alors qu’il est encore dans son nid, la retiendra, oubliant les leçons, le concerto de ses parents.
Le couple Bourricot ne se caressait plus beaucoup depuis deux ans. David s’y était habitué. Se consolait de peu de chose. Sa mère aussi avait cessé de l’embrasser lorsqu’il avait commencé ses poussées de psoriasis qui le taquinèrent dès l’âge de cinq ans, atroces démangeaisons qui lui dévoraient les mains et l’arrière-train. Lorsqu’à douze ans, il fit des crises d’épilepsie, c’était le bouquet. Bave, œil révulsé, corps contracté, muscles à la limite de la rupture, hôpital à répétition. Maman était là, ordonnant aux infirmières des linges humides sur son front, des serviettes entre les dents afin qu’il ne se morde plus la langue.
Il reçut un appel de son père, atteint d’Alzheimer, qui lui souhaita de bonnes Pâques. Un visionnaire. Il lui dit, très gai, qu’il avait vu maman ce matin, mais maman était décédée de la maladie de Waldenström depuis presque quatre ans. Morte à l’aube d’un 22 novembre, lorsque le jour espérait encore un rayon inconnu, après une nuit où la lune ressemblait à un sourire de clown que l’on nomme joliment croissant. Dès lors, David avait pris conscience que les vivants, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas encore partis, ne faisaient que traverser le monde des morts. Son pauvre papa.
Puis il reconnut le 06 de son frère Paul, avocat pénaliste, qui lui déclara, ce sacré farceur : « Eh, David ! Pas encore derrière les barreaux ? » Et ce coup de fil de son rédacteur en chef, Romain Beaurevoir, qui savait que son vieux et cher Bourricot, ce journaliste admirable, était le genre de type à qui il faut sévèrement botter le train, que l’on a plaisir à taquiner :
— Eh, mon vieux David, ça te dirait de passer quelques jours au fin fond de la Bretagne ? J’ai un petit reportage pour toi…
— Un reportage sur les galettes au blé noir complètes, sur les algues vertes, les artichauts ou les choux-fleurs ?
— Mieux, mon vieux Milou, un trafic de cocaïne sur des chalutiers. Tu te débrouilles pour enquêter sur l’affaire Pierre Kermadec. Ça cache quelque chose. C’était il y a six mois. Le type a dû être jeté à l’eau : un règlement de comptes, sans doute. Les flics n’ont rien trouvé mais, dans le milieu, il y a pas mal de consommation de coke ou d’héroïne. Écoute-moi, la Bourrique, je viens de lire un article, l’article d’un addicto- logue dans un magazine plutôt sérieux, un truc réservé aux toubibs dans lequel on apprend que la dépendance à la dope a toujours existé chez les marins-pêcheurs. Au siècle dernier, ils étaient accros à l’alcool et au tabac, souvent les deux. Aujourd’hui, ils sont passés du pastis aux opiacés.
— Et alors ?
— Et alors, mon vieux Milou, c’est un super sujet, un sujet qui peut te remettre d’aplomb. Tu sais, lorsque je te parle, j’ai l’impression que tu as consommé des substances psychoactives.
— Si j’avais consommé ce genre de produits, j’aurais grimpé aux rideaux de ton appartement et j’aurais violé ta femme.
— Eh bien, nous y sommes, mon vieux Milou. Tu commences à comprendre. Les marins-pêcheurs seraient tellement chargés qu’ils abuseraient de…
— C’est une plaisanterie, cette enquête.
— Tu sais, David, n’aie pas peur, la terre est plate. Même lorsque tu as trop bu, le trottoir va plutôt plus droit que toi…
—Très drôle. Sauf que ce matin, j’ai vu une vieille glisser sévèrement sur une plaque de verglas…
— Mon cadeau de Noël est le suivant. Tu pars demain pour Quimper. Ensuite tu loues une bagnole et tu glisses direction Penmarc’h et Le Guilvinec.
— J’veux bien, mais j’ai rendez-vous avec mon psychiatre le 4 janvier.
— Réfléchis un peu, Bourricot, qui paye ton psychiatre ? C’est toi ou c’est moi ? Je te signale que sans moi, plus de tickets-restaurants, plus de psychiatre, plus rien… Moi, ce que je veux, c’est que tu retrouves une certaine dignité. Tu sais, tout le monde t’aime bien au journal et se désole de ta déconfiture, de ta paresse. T’as eu ton heure de gloire lorsque tu as publié ton enquête sur les magouilles de ce producteur de cinéma, tu te souviens ? On te voyait partout sur les plateaux télé.
— Ah, je ne m’en souviens pas. J’ai dû passer dans des émissions merdiques, mais lesquelles ? Bon, je vais réfléchir. Ta proposition est tentante, mais j’ai…
— Tu as quoi ? Tu prends le train demain et tu fais pas chier. Je me souviens que tu m’en parlais de la Bretagne, que tu y avais passé toutes tes vacances, t’allais y voir ta maman. La première fois que tu as mis les pieds dans mon bureau, tu m’avais dit – à l’époque, tes yeux n’étaient pas encore trop embués –, tu m’avais dit… Qu’importe, d’ailleurs.
Et il poursuivit ainsi :
— Écoute-moi bien, Bourricot, soit tu te remues, tu revêts ton caban Armor Lux, soit je te vire. Kenavo !
Et c’est ainsi que trois jours plus tard, David Bourricot partit, valise à roulettes à la main, tac-tac-tac, sur le parvis de la gare Montparnasse où un SDF lui demanda une cigarette. Bon prince, il lui en fit don, mais lorsque le clodo lui demanda du feu, il rechigna un peu :
— Et puis quoi encore ?
— Trois euros, pour un kebab !
David s’exécuta. Il n’était plus à ça près. Quoique. Il descendit, après huit heures de voyage – une vache s’étant suicidée sur la voie entre Vannes et Lorient et pire, une grève du mini-bar à la voiture 14, horreur, malheur ! –, il descendit non pas à Quimper mais, quel idiot !, à Quimperlé où il loua une voiture chez Avis. Cette 206 Peugeot lui semblait assez facile à dompter quand bien même elle n’avait pas de boîte automatique.
— La route pour Penmarc’h, s’iou plaît ? demanda-t-il au loueur.
Le journaliste n’avait jamais eu un grand sens de l’orientation. Dans les années 1970, début juillet, la famille Bourricot enfournait dans la R16 TS cirés Cotten, bottes Aigle, épuisettes et hop, elle filait droit sur l’A6 vers l’ouest. Vers Le Mans, le tout petit David piquait un somme après avoir épuisé son recueil de mots croisés, son petit livre, version courte illustrée de Tom Sawyer ou de Huckleberry Finn. Sa mère, alors, lui calait sa tête dodelinante dans le creux d’un merveilleux et duveteux oreiller bleu pâle et il s’endormait, se réveillant, émerveillé, à la pointe du Cap Coz.
Il déambulait devant le comptoir Avis lorsque l’employé lui dit :
— Monsieur ? Monsieur ? Vous vous sentez bien ?
— Oui, oui, ça va… Excusez-moi. Je rêvais, je me revoyais déjà…
— Écoutez, monsieur, pour aller à Penmarc’h, prendre la sortie Quimper-centre, glisser sur la rocade, traverser la zone de l’hippodrome, longer la gare puis la rivière Odet, compter ses ponts et passerelles, unan, daou, tri, pevar, pemp, c’hwec’h. Laisser sur votre gauche le mont Frugy feuillu où les jours de tempête s’arc-boutent les marronniers et les hêtres, tourner à droite juste après le jardin de l’Évêché pour décrocher sur le vieux centre. Vous voilà face à la cathédrale du haut de laquelle, entre ses deux flèches, vous contemple Gradlon sur son cheval de granit, roi de la ville d’Ys engloutie en des siècles médiévaux par le diable. Ensuite, prendre la direction Pont-l’Abbé. Là vous entrez dans l’étrange, dans le curieux, vous êtes dans le pays bigouden. Vous savez, ce pays où les femmes ont des flèches de cathédrale en guise de bitos.
« Cultivé, ce loueur de bagnoles », pensa David qui se sentit en terre conquise. Il nota, inspiré, sur son cahier, avant d’enclencher la première :
L’hiver dure ici plus longtemps. Quimper s’éteint dès six heures du soir. Les rues, les places, les avenues se vident. La ville se noie dans le silence. Quimper est une impasse, un cul-de-sac. L’Odet couleur de thé quand il rencontre le Steïr à l’angle de la rue René-Madec et de la rue du Parc. C’est à Quimper, ville confluente, que la Bretagne se concentre. Entre mer et campagne, le soleil se transforme en pluie en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Les rues, tout à l’heure pleines de lumière, luisent maintenant sous l’averse. Les pavés de la place Saint-Corentin brillent comme les yeux bleu de mer de cette jeune Bigoudène au teint pâle qui traverse la place, regarde la statue en bronze – blanchie par le guano des mouettes et des cormorans – de René Théophile Laënnec, illustre Quimpérois inventeur du stéthoscope. Ici, les printemps et les étés passent et se ressemblent. D’une année à l’autre, ces deux saisons changent de tons, de couleurs, d’odeurs. Quant à l’automne, Quimper aurait pu s’appeler ainsi. On ne croise plus, rue Kéréon, du Chapeau rouge ou Saint-François, des femmes portant la coiffe en broderie Venise. Il faut attendre le Festival de Cornouailles pour que la ville prenne le sang de sa tradition ; autant dire que tout ici semble bien fini.
Il était dix-sept heures et ce n’était pas la joie. Bourricot, arpentant le quartier Saint-Corentin, choisit une crêperie dans la vieille ville. Place au Beurre, il commanda une andouille œuf-miroir qu’il attendit vingt minutes. Cela dit, s’il eût été critique gastronomique, il aurait bien remis à la crêpière trois coiffes. Après cinq bolées de cidre brut fouesnantais, David paya l’addition. En sortant de La Belle complète, il agita ses guiboles, reprit ses esprits, pensa au poète américain Ezra Pound qui croyait que l’on pouvait comprendre l’histoire de son pays en arrachant « les pattes des annales » de sa famille, cette mygale. La compréhension de la Bretagne allait-elle se gagner par la crêpe blé noir et la crêpe froment, la complète et la beurre citron ?
Puis, il prit sa Peugeot, garée place Toul-al-Laër. La pédale de frein lui semblait un peu molle. Après avoir fait paisiblement trente, trente-cinq kilomètres, David se gara juste devant une auberge, La Toupie. Il s’était échoué à Kérity Penmarc’h. Devant lui, la marée basse sentait bon le varech. Les mouettes rieuses étaient au rendez-vous, toutes là, attendant le lendemain, le retour de la pêche. Lorsqu’il claqua la portière, heureux d’être arrivé à bon port, il entendit leurs cris, sorte de présage. Alors qu’il s’apprêtait à franchir le pas de porte de La Toupie, son téléphone vibra : Romain.
— Bien arrivé ? Tu vois, vieille pine, j’ai toujours voulu ton confort. Tu vas prendre l’air du large, te refaire une petite santé. Tu étais tout confiné, et d’ailleurs, tout le monde me le disait, tu avais le teint pas frais ces derniers temps… Je te cherche un nouveau début.
— Je te remercie. Effectivement, ça secoue sec dans ce bled. Il y a un vent à décorner un cocu. J’ai eu du mal à fermer la portière de ma voiture. Ne quitte pas… — On se rappelle plus tard, je ne capte plus…
David caressa ses poches. Ses Dunhill blue ? Sans doute restées dans la boîte à gants. Oui. Il n’avait pas l’air bien frais, les traits tirés, les calots vaseux, le teint brumeux. Et c’est ainsi, assis derrière son volant, qu’il pensa au Cap Coz, à cet hôtel de la Pointe, à cette chambre 10, cette chambre qui lui donnait, enfant, l’impression d’être ailleurs. Une vue sur la mer, une autre sur l’anse de Penfoulic, dunes de vase traversées par la rivière Pen-al-Len, une terrasse avec ses tables blanches, ses balancelles, une vue bouleversante sur la baie de Concarneau : paysage enveloppé dans le brouillard. Il se souvint de ces mots de Nietzsche dans Humain, trop humain : « Nous ne revoyons jamais ces choses que l’âme en deuil. » Quelque chose clochait en lui, mais il ne voulait pas soigner cette chose-là, il voulait persévérer dans son être, voguer sur des vaguelettes. Il se sentait loin des hommes. Se tenir à distance. Dix centimètres, c’est bien, cent mètres, c’est mieux, cent kilomètres, là c’est le pied, se disait-il souvent.
Il revoyait cette ria, ouverture fermée qui le rassurait, pauvre Bourricot, lui qui tout petit avait si peur de l’océan. Et sa mère qui lui avait bien dit : « Mon chéri, tu veux la chambre sur la mer ou la chambre sur la baie ? » David n’avait pas hésité, il avait choisi direct la chambre 10 avec vue sur la ria, celle qu’il avait appelée la cellule des anges. Là, dès le matin, dès six heures, la marée lui revenait au nez et il observait les ostréiculteurs, sentait coques, palourdes, pétoncles… Il chaussait alors ses bottes et son père lui disait : « David, c’est marée basse, nous allons pêcher des couteaux ou peut-être des pousse-pieds, selon la volonté de Dieu… » Armés d’un tournevis et d’une cuiller, ils allaient alors entre les rochers et les flaques pour dénicher par grappes ces derniers.
David se souvenait aussi de la voix métallique de son père, entrepreneur en bâtiment. Ce matin-là, il pleuvinait. Pas beaucoup de couteaux dans le panier. Il devait être treize heures ou treize heures quinze, qu’importe, lorsque le père de David s’effondra dans le goémon. Il pensa qu’il était mort. On le plaça dans un Ehpad. Tout bien pesé, ce n’est pas la mort qui est curieuse, c’est cette longue et fatigante marche vers elle. Elle a ce son, celui du craquement assez vaseux lorsque, enfant, nos pieds nus foulaient le goémon. Cette salade à l’odeur si désagréable qui, inlassablement, lui revenait au nez. Elle est comme cette algue sèche qui expire lorsqu’elle claque sous vos doigts et gicle son jus de mer sous vos espadrilles. La mort n’est pas grand-chose, elle ne demande qu’à être là. Entre David et l’au-delà, il n’y avait qu’une semelle en corde de chanvre tressée.
La chambre 10, longtemps, fut sa carte postale.
Extrait
« Hôtel du Port. De la chambre de tribord. Temps gris et frais. Très frais. Vue sur la mer peu agitée. Petites vagues. Moutons nombreux. L’ennui des dimanches, toutes mes vacances d’enfant au Cap Coz. Pourquoi faut-il que je revienne là où mon entrepreneur de père ma vacciné contre les méfaits de la mer? Là où ne sachant trop quoi faire, je me prenais pour Marco Polo, pour Magellan, Tabarly. »
À propos de l’auteur
 Anthony Palou © Photo Ginies SIPA
Anthony Palou © Photo Ginies SIPA
Anthony Palou est chroniqueur au Figaro. Auteur de Camille (Prix Décembre 2000) et de Fruits et légumes paru en 2010 (Prix Des Deux Magots, Prix Bretagne, Prix La Montagne Terre de France). La Faucille d’or est son troisième roman. (Source: Éditions du Rocher)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
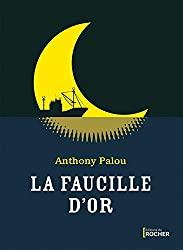








Tags:

