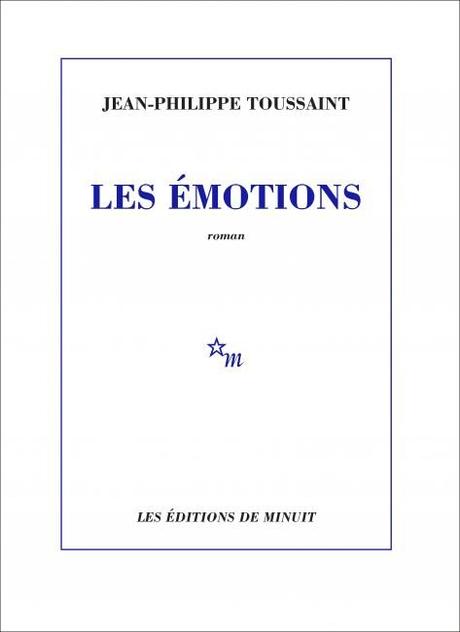
La clé USB et nous offre quelques superbes variations sur le sentiment amoureux en détaillant les rencontres qui l’ont marqué.
Ceux qui ont lu La clé USB seront très vite ici en terrain connu, car même si ce roman peut très bien se lire sans avoir connaissance de l’œuvre ou du précédent roman de l’auteur, il pourrait fort bien composer un dyptique, puisque l’on reprend l’action au moment où Jean Detrez, le personnage principal, de retour du Japon apprend que son père est décédé, mettant en quelque sorte un point d’orgue a une année qui aura vu sa femme le quitter (juin 2016), le Brexit être voté (23 juin 2016), et Donald Trump accéder à la présidence des États-Unis (8 novembre 2016).
Nous voici donc en décembre, au moment des obsèques de son père, événement chargé d’émotion, mais aussi propice à l’introspection. Les souvenirs affluent, ceux qui ont marqué la vie de son père, fonctionnaire européen comme lui, mais aussi tous ces moments qui ont provoqué chez lui ces émotions qui donnent le titre du roman et dont l’intensité va déterminer le souvenir bien davantage que la chronologie. Les femmes, ou plus précisément les émois amoureux formant alors la matière première d’un récit qui, bien que très factuel, fait précisément partager au lecteur les battements de cœur et l’exaltation de ces moments où la vie s’illumine, où on sent que quelque chose se passe…
Comme lors de ce colloque international de prospective qui tente de tracer l’avenir de l’Europe sans le Royaume-Uni et qui se tient précisément à Hartwell House, dans le sud de l’Angleterre. Alors que les intervenants s’écharpent sur la pertinence de leur méthode de prospective stratégique en quatre phases – scoping, ordering, implications, integrating futures – l’attention de Jean va être détournée par Enid Eelmäe. Pour faire connaissance, les participants ont été invités à un exercice, baptisé Tell the story of your names. C’est ainsi qu’après avoir expliqué que les Detrez étaient originaires du Nord de la France et que le grand-père paternel avait disparu durant la Première Guerre mondiale, il apprit que Eelmäe voulait dire
«première montagne» ou «avant-montagne» en estonien, mais aussi que ce patronyme, avant l’estonisation des noms, était Eiffel, comme le constructeur de la Tour Eiffel. Ajoutons que la seule personne appelée Enid de leur connaissance les renvoyait tous deux à leur enfance et à la lecture du Club des cinq et du Clan des sept d’Enid Blyton. Il n’en fallait guère davantage pour tomber sous le charme de belle venue de Baltique. Au fil des heures, ils vont devenir très complices. Jusqu’à ce tête-à-tête dans la bibliothèque: «J’avais envie de déposer ma main sur son bras, mais je n’osais entreprendre le moindre geste. Il y a toujours un moment, dans les relations amoureuses, où, même si on sait que nos corps vont finir par se rapprocher, qu’une étreinte va survenir, qu’un baiser ne va pas tarder à être échangé, on demeure dans l’attente, et rien ne se passe si on ne prend pas la décision d’agir. Même si on sait l’un et l’autre que quelque chose de tendre est susceptible de survenir à tout instant, il y a un dernier cap à franchir, qui peut sembler minuscule, et dont on peut même se rendre compte, a posteriori, en se retournant pour revoir la scène dans son souvenir, que ce n’était en réalité qu’un tout petit gué tellement aisé à traverser, mais qui, tant qu’il n’est pas franchi, tant qu’on ne l’a pas passé, demeure un obstacle insurmontable.»
Bien entendu, ce sont les détails de ces moments qui donnent toute sa saveur à ce roman, comme si Jean-Philippe Toussaint à la manière d’un cinéaste, décidait de passer d’un plan général à un gros-plan, de se focaliser sur ces moments de grâce.
On passe ainsi des couloirs du Berlaymont, bâtiment emblématique de l’Union européenne où se retrouve tous les thèmes du livre, l’Europe aujourd’hui à la croisée des chemins, mais aussi le fils et son père, tous deux fonctionnaires européens, mais aussi l’architecture puisque la rénovation du bâtiment est confiée à son frère qui a suivi les pas de son arrière-grand-père, Pierre De Groef, qui a construit beaucoup d’immeubles à Bruxelles au début du XXe siècle. Et, comment pourrait-il en être autrement, les femmes. D’abord Diane, sa seconde épouse dont il se sépare, mais dont il nous raconte avec tendresse et sans doute nostalgie la rencontre dans ce temple de la technocratie. Puis sa course effrénée avec Pilar Alcantara lors de l’éruption du volcan Eyjafjöll en 2010. L’occasion aussi de nous faire découvrir un mystérieux souterrain.
Remontant dans le temps, nous irons aussi en Toscane au moment où Jean rencontre Elisabetta, sa première épouse. Contrairement à Diane, elle sera présente aux obsèques avec son fils Alessandro. Encore une occasion de constater combien restent vivaces les émotions. Et d’exprimer des regrets que l’on peut aussi prendre comme un conseil d’ami: «J’aurais peut-être dû faire davantage d’efforts pour essayer de sauver notre amour et prendre le risque d’entamer avec Elisabetta une longue relation suivie, la relation d’une vie, un amour au long cours, quitte à ce qu’il y eût des hauts et des bas, des orages et des disputes (et, sur ce point, je pouvais faire confiance à Elisabetta), mais j’aurais pu ou j’aurais dû avoir cette ambition pour nous, plutôt que, au premier accroc, à la première infidélité, céder à la facilité de nous séparer, abdiquer sans combattre.»
Les émotions
Jean-Philippe Toussaint
Éditions de Minuit
Roman
240 p., 18,50 €
EAN 9782707346438
Paru le 20/08/2020
Où?
Le roman se déroule en Belgique, principalement à Bruxelles et environs. On y évoque aussi des voyages en Grande-Bretagne, au Japon, aux États-Unis, à Los Angeles
Quand?
L’action se situe principalement en 2016 et les mois suivants, mais l’auteur évoque aussi des souvenirs de 2004 et 2010.
Ce qu’en dit l’éditeur
Lorsque Jean Detrez, qui travaille à la Commission européenne, a commencé à s’intéresser de manière professionnelle à l’avenir, il s’est rendu compte qu’il y avait une différence abyssale entre l’avenir public et l’avenir privé. La connaissance, ou l’exploration, de l’avenir public, relève de la prospective, qui constitue une discipline scientifique à part entière, alors que la volonté, ou le fantasme, de connaître son propre avenir relève du spiritisme ou de la voyance. Mais a–t-on toujours envie de savoir ce que nous réservent les prochains jours ou les prochaines semaines, a-t-on toujours envie de savoir ce que nous deviendrons dans un futur plus ou moins éloigné, quand on sait que ce qui peut nous arriver de plus stupéfiant, le matin, quand on se lève, c’est d’apprendre qu’on va mourir dans la journée ou qu’on va vivre une nouvelle aventure amoureuse ou sexuelle dans les heures qui viennent ? Le sexe et la mort, rien ne peut nous émouvoir davantage, quand il s’agit de nous-même.
Le moment est donc venu de dire un mot de la vie privée de Jean Detrez.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Diacritik (Jacques Dubois)
Le Carnet et les instants (Alain Delaunois)
Philosophie Magazine (Alexandre Lacroix)
Blog Shangols
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« À Bruxelles, la journée avait été caniculaire. Nous vivions avec Diane les dernières heures de notre vie commune. Depuis quelques semaines, nous ne nous parlions plus. Notre mariage, qui avait duré dix ans, s’achevait dans la froideur et le ressentiment. C’était le 23 juin 2016, le jour du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. Dans la soirée, un orage très violent a éclaté à Bruxelles, accompagné de pluies diluviennes. Je me revois dans le salon de l’appartement de la rue de Belle-Vue en train de regarder une pluie torrentielle tomber derrière la baie vitrée. Les branches des saules se tordaient sous le vent. Un éclair, parfois, zébrait le ciel, et on entendait les grondements du tonnerre au loin par-delà les étangs d’Ixelles. Diane était assise derrière moi dans le salon assombri par l’orage, elle feuilletait en silence une revue dans le canapé. Elle ne tarda pas à quitter la pièce, et je l’entendis s’éloigner dans le couloir jusqu’à la chambre à coucher. Ce fut notre dernière soirée ensemble dans l’appartement de la rue de Belle-Vue (ma décision, à cette heure, était déjà prise de quitter l’appartement et de trouver un nouveau logement à la rentrée).
Je n’ai appris le résultat du référendum britannique que le lendemain en écoutant la radio. J’avais un rendez-vous à la Commission européenne en début de matinée. À la fin de ma réunion, en sortant du Berlaymont, j’ai traversé la rue de la Loi avec quelques collègues pour rejoindre le bâtiment Juste Lipse, qui se trouve de l’autre côté de la rue. Le Juste Lipse était encore l’unique siège du Conseil de l’Europe à l’époque, le nouveau bâtiment « Europa » construit par Philippe Samyn — le fameux cube de verre évidé qui luit pendant la nuit au cœur du quartier européen — n’est entré en service qu’au début de l’année suivante. Il y avait beaucoup plus d’animation que d’habitude dans le hall du Juste Lipse. On croisait des équipes de télévision, des dizaines de journalistes se pressaient vers la salle de presse. J’ai encore présent à l’esprit l’entrée en scène du président du Conseil européen ce jour-là. Précédé d’un bouillonnement de conseillers et de membres des services de sécurité, je revois sa silhouette décidée s’avancer sur le tapis rouge en longeant la rangée de drapeaux européens. Son visage était grave, l’attitude solennelle. Il monta à la tribune et commença son discours avec une émotion inhabituelle. Je suis pleinement conscient de la gravité, et même de l’ampleur dramatique de l’heure que nous vivons. C’est un moment historique, mais ce n’est sûrement pas le moment d’avoir des réactions hystériques. Les dernières années ont été les plus difficiles de notre histoire, mais je tiens à rassurer chacun, nous sommes prêts à affronter ce scénario négatif, et je pense toujours à ce que me disait mon père : « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. » Je regardais le président du Conseil européen s’exprimer à la tribune. Au moment où il avait évoqué son père, ses yeux furent parcourus d’un fugitif voile de timidité, qui ne dura qu’un instant. Il esquissa un sourire, le sourire d’un homme adulte qui évoque son père en public, avec ce que cela peut avoir de pudeur, de respect et de piété filiale, et je ne pus m’empêcher de songer à mon père, à mon propre père, Jean-Yves Detrez, qui avait été commissaire européen dans le passé. Depuis que j’avais appris la victoire du « Leave » au référendum britannique, je ne cessais de penser à ce qu’il devait ressentir. Son monde, le monde qu’il avait toujours connu, était en train de vaciller. Les crises s’accumulaient en Europe, les populismes montaient partout inexorablement. L’humanisme, que mon père avait toujours défendu avec zèle, semblait plus mal en point que jamais. Le Brexit n’était que la dernière manifestation, la plus spectaculaire, la plus désagréablement inattendue, de ce dépérissement délétère.
Jusqu’à quel point peut-on oublier quelque chose qui nous est arrivé ? Je ne me serais peut-être jamais posé la question, si, quelques mois plus tard, je n’avais retrouvé une photo compromettante dans mon téléphone. C’était dans un Thalys, j’avais assisté à une réunion de prospective à Paris dans la matinée, et je revenais à Bruxelles le soir même. J’avais fait l’aller-retour dans la journée. J’étais fatigué, la journée avait été longue. Je me laissais bercer par le train. Calé au fond de mon siège, je faisais défiler distraitement du doigt les images de mon téléphone, quand je suis tombé par hasard sur la photo d’une jeune femme à moitié dénudée. La photo, presque floue, avait été prise l’été précédent dans une chambre d’hôtel pendant que je participais à une retraite de prospective à Hartwell House, près de Londres. Je ne me souvenais plus des circonstances exactes dans lesquelles la photo avait été prise. Je me souvenais seulement d’avoir passé la fin de la soirée avec cette jeune femme et d’avoir emprunté les escaliers majestueux d’Hartwell House avec elle très tard dans la nuit, mais je ne me souvenais plus ensuite de ce qui s’était passé, ou plutôt, à partir d’un certain point, mes souvenirs se dissipaient dans les brumes d’une fin de soirée trop arrosée. Nul doute pourtant que c’était bien dans une chambre d’hôtel de la résidence d’Hartwell House que la photo avait été prise, et par qui d’autre que moi puisque c’était dans mon propre téléphone que je venais d’en retrouver la trace, à ma grande surprise et à ma grande gêne. Je ne gardais pourtant aucun souvenir qu’il s’était passé quelque chose d’intime avec cette jeune femme cette nuit-là, même si la photo semblait apporter un démenti visuel au témoignage défaillant de ma mémoire. Il y avait, à l’évidence, une contradiction entre ce que me disaient mes souvenirs et ce que montrait la photo.
Depuis plusieurs années, mon ami et collègue Peter Atkins organisait les Rencontres d’Hartwell House, des retraites de prospective, où les participants, responsables politiques, analystes et experts internationaux, se réunissent pendant une semaine dans le cadre somptueux du château d’Hartwell pour imaginer l’avenir ensemble. L’avenir, pour moi, qui le côtoyais au quotidien dans le cadre de mes activités à la Commission européenne, était une notion parfaitement abstraite, que j’étais capable de modéliser et de faire parler avec des chiffres. Mais si, dans ma vie professionnelle, j’avais une maîtrise incontestable de l’avenir, je me rendais compte que, depuis quelque temps, je ne maîtrisais plus rien dans ma vie privée. Mon mariage avec Diane était en train de sombrer, nous étions entrés dans une crise conjugale dont je ne voyais plus l’issue. L’avenir, pour moi, était devenu irrémédiablement opaque. Je ne disposais pas des outils appropriés pour imaginer ce que nous allions devenir. Moi qui me pensais si performant dans l’exercice de mes fonctions, j’étais complètement démuni dans la conduite de mon histoire d’amour avec Diane. À croire que la prospective ne nous est d’aucun secours dans les affaires de cœur — ou qu’en amour, il n’y a pas de méthode.
Lorsque, dans les années 1990, j’ai commencé à m’intéresser de manière professionnelle à l’avenir, j’ai très vite compris qu’il y avait une différence abyssale entre deux notions qui peuvent paraître voisines, voire similaires, mais qui ne sont pas de même nature, l’avenir public et l’avenir privé. La connaissance, ou l’exploration, de l’avenir public, qui est au cœur de mon activité professionnelle, relève d’une discipline à part entière, au même titre que les statistiques ou la démographie, avec son ensemble de techniques et d’outils méthodologiques spécifiques. Lorsqu’elle est pratiquée dans les règles de l’art, la prospective permet de repérer les principales métamorphoses qui couvent à bas bruit dans la société avant qu’elles ne s’expriment au grand jour, ce qui nous permet d’anticiper les grandes évolutions à venir. Alors que la volonté, ou le fantasme, de connaître son propre avenir relève du spiritisme ou de la voyance. C’est alors à une boule de cristal ou aux cartes du tarot qu’il faut avoir recours pour lire l’avenir. Mais a-t-on toujours envie de savoir ce que nous réservent les prochains jours ou les prochaines semaines, a-t-on toujours envie de savoir ce que nous deviendrons dans un futur plus ou moins éloigné, quand on sait que ce qui peut nous arriver de plus stupéfiant, le matin, quand on se lève, c’est d’apprendre qu’on va mourir dans la journée ou qu’on va vivre une nouvelle aventure amoureuse ou sexuelle dans les heures qui viennent. Le sexe et la mort, rien ne peut nous émouvoir davantage, quand il s’agit de nous-même.
À l’été 2016, j’ai assisté à la retraite de prospective organisée par mon ami Peter Atkins à Hartwell House. L’avenir, durant ces quelques jours, fut au centre de toutes nos attentions. Nous l’entourions de nos sollicitudes expertes. Nous le sondions, par petits groupes, autour de tables de réunion recouvertes de feutrine verte. Nous l’auscultions, avec d’infinies précautions, pour construire, sous forme de scénarios exploratoires, des représentations de différents futurs possibles. Je connaissais Peter Atkins depuis toujours, cela faisait près de vingt ans que nous hantions ensemble les terras incognitas de la prospective stratégique et que nous explorions ses dernières steppes indéfrichées. Au début des années 2000, Peter avait rejoint à Londres l’équipe du Government Chief Scientific Adviser, qui conseille le Premier ministre britannique sur les questions de technologie. Il avait été chargé de créer la première cellule de prospective stratégique au sein de cette agence gouvernementale. C’est ainsi, sur le tas, que Peter s’était formé aux techniques les plus sophistiquées de la discipline et qu’il avait fait la connaissance de la plupart des hommes politiques, responsables militaires et hauts fonctionnaires qui travaillent dans le domaine en Angleterre. Ensuite, des experts étrangers, qui envisageaient de créer leur propre cellule de prospective dans leur pays, étaient venus faire des voyages d’études à Londres pour voir comment ils procédaient, et c’est ainsi que Peter était devenu une personnalité incontournable dans le petit monde très fermé de la prospective stratégique. En 2011, Peter avait quitté son poste dans la haute administration britannique pour s’établir à son propre compte, et il avait fondé l’association des Rencontres d’Hartwell House. L’événement phare de l’association était la retraite stratégique estivale. Dès la première session, Peter avait instauré l’idée originale du live challenge. Le principe était d’avoir chaque année un défi à relever en temps réel, un sujet d’intérêt général sur lequel tous les participants pourraient travailler pendant les cinq jours de la retraite. En 2016, les Rencontres d’Hartwell House s’étaient tenues début juillet, soit seulement une dizaine de jours après le référendum sur le Brexit.
Le lundi 4 juillet 2016, j’ai pris le train à Bruxelles aux premières heures pour rejoindre Londres. J’avais rendez-vous à la gare du Midi avec mon ami Viswanathan Ajit Pai, qui travaille avec moi à la Commission européenne. Viswanathan était lui aussi de la partie pour Hartwell House et nous avions décidé de faire le voyage ensemble. Dans l’Eurostar, nous nous étions installés dans un carré de sièges vides et nous avions pris nos aises, déployant nos journaux et posant nos ordinateurs sur les tablettes. Viswanathan, confortablement installé au fond de son siège, avait ouvert le Financial Times, dont il tournait précautionneusement les pages saumonées dans un froissement feutré de papier journal, délicat murmure matinal bientôt voué à disparaître avec le déclin annoncé des journaux papier. Peu après le départ, un très bon petit déjeuner nous avait été servi à la place. Viswanathan était contrarié comme moi par le résultat du référendum britannique, mais il ne semblait pas disposé à se laisser abattre. Au contraire, appréciant le petit déjeuner, se régalant des viennoiseries et des yaourts aux fruits (le sien et le mien, que je lui avais cédé bien volontiers), il se lança plutôt dans un vibrant hommage rétrospectif de l’Angleterre qu’il avait connue pendant ses années d’études à Cambridge au début des années 1990. Tu sais, à l’époque, c’était vraiment un environnement très stimulant, disait-il, une ambiance de libre pensée, de curiosité intellectuelle, on parlait de new internationalism. À ce moment-là, la Grande-Bretagne était ouverte sur les autres cultures. C’était le moment où on commençait à bien manger en Angleterre, avec de bons vins, des fromages affinés, de superbes huiles d’olive. La société anglaise respirait différemment, il y avait une ouverture extraordinaire sur le monde. Selon Viswanathan, cela avait commencé à se dégrader à partir du début des années 2000, et la crise financière de 2008 n’avait rien arrangé. À ce début de récession s’étaient greffés une rhétorique anti-migrants et le déchaînement de la presse populaire contre l’Europe. Si on ajoute à cela beaucoup de cynisme et deux ou trois apprentis sorciers, il ne fallait pas chercher beaucoup plus loin les raisons du Brexit, selon Viswanathan (et il finit pensivement mon yaourt à la cerise en jetant un coup d’œil par la vitre du train). »
Extraits
« Mais, une fois dans la place, Scott Adams, avec son esprit pervers, n’avait pu s’empêcher de rendre public le différend avec Peter et de laisser entendre à l’assistance qu’il se désolidarisait de la méthode qu’il était obligé de présenter. C’est donc avec une ironie grinçante qu’il nous passa en revue les quatre étapes de la méthode d’Hartwell House, qu’il énuméra avec dédain, scoping, ordering, implications, integrating futures , comme s’il s’agissait de quatre vieux tracteurs antédiluviens, avec lesquels nous serions bien avancés pour explorer les champs si fertiles de la prospective stratégique, telle que lui la concevait. » p. 50
« Parfois, j’ai l’impression que si quelqu’un nous observait de l’extérieur et nous entendait émettre nos hypothèses, il pourrait vraiment se demander : « Mais qu’est-ce qu’ils ont fumé, ces gars-là ? » L’exemple le plus célèbre, ajouta-t-il, tandis que nous pénétrions dans l’hôtel, c’est la scène de Richard III , tu sais, la scène où Richard se tourne vers Lady Anne, la femme de son frère, pour lui dire qu’il est amoureux d’elle, alors qu’il vient de tuer son frère. Il s’arrêta dans le hall pour me mimer la scène (il s’était donné le rôle de Richard et s’adressait à moi comme si j’étais Lady Anne). Non seulement, il lui avoue que c’est lui qui a tué son frère, mais en plus il lui dit qu’il veut l’épouser ! s’écria-t-il. Nous étions debout l’un en face de l’autre dans le hall de l’hôtel. Ce n’est pas du tout vraisemblable évidemment, et pourtant le spectateur adhère, la scène a suffisamment de puissance et de force dramatique pour que le spectateur suspende son jugement critique à propos de l’invraisemblance de la situation. » p. 61
« J’avais envie de déposer ma main sur son bras, mais je n’osais entreprendre le moindre geste. Il y a toujours un moment, dans les relations amoureuses, où, même si on sait que nos corps vont finir par se rapprocher, qu’une étreinte va survenir, qu’un baiser ne va pas tarder à être échangé, on demeure dans l’attente, et rien ne se passe si on ne prend pas la décision d’agir. Même si on sait l’un et l’autre que quelque chose de tendre est susceptible de survenir à tout instant, il y a un dernier cap à franchir, qui peut sembler minuscule, et dont on peut même se rendre compte, a posteriori, en se retournant pour revoir la scène dans son souvenir, que ce n’était en réalité qu’un tout petit gué tellement aisé à traverser, mais qui, tant qu’il n’est pas franchi, tant qu’on ne l’a pas passé, demeure un obstacle insurmontable. Il y a toujours ce dernier seuil symbolique à franchir, qui nous fait passer d’un état d’attente heureuse au dénouement attendu, quand les mains se rejoignent et que les lèvres s’unissent. Et c’est d’ailleurs peut-être le fait que cette attente soit si souvent heureuse qui explique que, tant de fois, pour ma part, je n’aie jamais été plus loin. Comme si c’était dans la félicité de la promesse que j’avais vécu mes plus belles heures d’amour. » p. 76-77
« En moins de vingt ans, Pierre De Groef, qui était issu d’un milieu modeste (son père était menuisier du côté de la rue Borrens à Ixelles), était devenu un architecte à la mode, un citoyen cossu, un bourgeois installé: moustache, costume en flanelle, gilet et montre à gousset, large cravate à pois, tel qu’il apparaît sur une photo qui a longtemps orné la cuisine de mes parents avenue Émile Duray. À l’époque, le quartier des étangs d’Ixelles, sur lequel il avait jeté son dévolu, se trouvait encore largement à la campagne. Il a eu le flair d’acheter tous les terrains qui voisinaient l’abbaye de la Cambre en pleine restauration après la première guerre mondiale. » p. 95
« La mort d’un homme, parfois, correspond à la fin d’une époque. Stefan Zweig est mort à un des pires moments de l’histoire, quand le ciel était noir en Europe et l’horizon bouché aussi loin que le regard pouvait porter. Témoin direct du plus sauvage triomphe de la brutalité qu’ait connu le monde, Zweig a vécu l’intrusion violente de la réalité du monde extérieur dans son univers intime comme peu d’intellectuels l’avaient expérimenté avant lui. Il a vu son monde, le monde dont il était familier, un monde de raison, d’art, de raffinement et de culture, disparaître littéralement sous ses yeux, tandis que l’humanisme
sur lequel étaient fondées toutes ses valeurs était balayé par le nazisme. Même si c’est à des événements moins tragiques que mon père a été confronté dans les dernières années de sa vie, je voyais un parallèle entre sa mort et la mort de Zweig. Les dates de leurs morts respectives coïncidaient l’une et l’autre avec l’exact creux d’une vague de l’histoire, quand l’aube espérée après la longue nuit dont parle Zweig dans sa dernière lettre, n’est pas encore venue. En un sens, on pourrait dire que Zweig et mon père sont morts à temps, dans la mesure où ils ont cessé de voir la catastrophe qui les entourait et n’ont pas assisté au désastre qui leur a survécu. » p. 170
« Il y a, dans la vie, des instants décisifs, certaines journées ou certaines heures qu’on ne pourra jamais oublier. Stefan Zweig, dans son livre Sternstunden der Menschheit, parle de certains alignements d’étoiles qui font qu’à des instants précis de l’histoire s’accomplissent des moments d’une grande concentration dramatique qui sont porteurs de destin, où il arrive qu’une décision capitale se condense « en un seul jour, une seule heure et souvent une seule minute ». p. 189
« La pression des compagnies aériennes sur la Commission devenait à chaque heure plus grande pour nous faire rouvrir des routes aériennes dès lundi matin. Les compagnies aériennes accumulaient chaque jour des pertes abyssales, de l’ordre de 150 millions d’euros par jour, et des voix dans le secteur aérien commençaient à s’élever pour dénoncer la pagaille que nous, l’Europe — l’Europe, toujours l’Europe — aurions semée, en appliquant à l’excès le principe de précaution. Était-ce raisonnable de rouvrir des
espaces aériens dès le lendemain matin? Manfred Hübner dit qu’il n’en savait rien, et que de toute manière, ce n’était pas de notre ressort, c’était les directions générales de l’aviation civile des différents pays qui étaient compétentes. À chacun ses dossiers brûlants, à chacun sa cendre volcanique. » p. 198
« Je la regardais, et je pensais que quelque chose arrivait, quelque chose m’arrive, me disais-je. C’est là une singulière vertu de l’amour ou du sentiment amoureux de se rendre compte que ce qui arrive nous arrive à nous-même et à personne d’autre — c’est à moi, à moi que cette chose arrive —, que le regard adressé, le geste esquissé, l’est pour nous et pour nous seul, et le fort sentiment d’élection que cette vérité nous procure nous apporte un intense bien-être qui fait disparaître instantanément tout le reste, la fatigue et les soucis professionnels, les mauvais pressentiments et la hantise. p. 227
À propos de l’auteur
 Jean-Philippe Toussaint © Photo Mathieu Zasso
Jean-Philippe Toussaint © Photo Mathieu Zasso
Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. Prix Médicis 2005 pour Fuir. Prix Décembre 2009 pour La Vérité sur Marie. Il a publié plus de dix romans aux éditions de Minuit, parmi lesquels La Salle de bain (Minuit, 1985), L’Appareil-photo (1989), Fuir (2005), Football (2015), M.M.M.M. (2017) et La clé USB (2019). Il est également essayiste et cinéaste. (Source: Éditions de Minuit). (Source: Éditions de Minuit)
Site internet de l’auteur
Page Wikipédia de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)



Tags:


