Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
Parti combattre Daech en Syrie
Dans un premier roman habilement construit, Éric L’Helgoualc’h met en scène un jeune romancier qui tente de comprendre ce qui a poussé son ami à tout quitter pour aller combattre Daech en Syrie.
Au terme d’un exil de vingt ans qui lui a permis de goûter à la gloire médiatique, le narrateur quitte Paris pour retourner vivre à Saugé-le-Château, «petite ville au croisement de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de l’Ille-et-Vilaine», où il essaie d’oublier «une série de catastrophes intimes». Finies les soirées mondaines où son aura de jeune romancier prometteur, couronné du Prix de Flore, lui offrait des conquêtes faciles, finies ses chroniques corrosives dans la matinale de France-Inter. Il aspire désormais au calme afin de pouvoir se remettre à l’écriture.
Mais sa retraite sera de courte durée. Au bar du Roncevaux, le bistrot du coin, les commentaires vont bon train après l’annonce sur la chaîne info que «l’homme d’affaires Elias Naccache était porté disparu en Syrie. Car à Saugé, on a croisé le personnage qui «a toujours été un peu spécial. Déjà quand il habitait dans le coin, c’était un type étrange, solitaire, limite autiste». Mais c’était surtout l’ami d’enfance du narrateur. Ce dont la rédactrice en chef du magazine Vanity Fair se souvient fort bien lorsqu’elle le contacte pour lui proposer de faire le portrait du disparu.
Commence alors une plongée dans l’adolescence, depuis ce jour où, après le cours d’anglais, Elias et le narrateur font connaissance sur les banquettes du bistrot en face de l’école. Dès lors, ils ne se quittent plus, ou presque. Car Elias va très vite se passionner pour l’informatique et consacrer la quasi-totalité de son temps libre à aligner des lignes de code, au grand désespoir de sa mère, la belle bibliothécaire que reluquent avec envie tous les habitants du village.
À l’heure où l’internet de développe à grande vitesse, Elias ne tarde pas à aligner les millions, revendant sa première start-up pour développer de nouveaux projets tout aussi lucratifs. Une réussite insolente couronnée en 2003 par un mariage largement commenté dans la presse people. Le petit-fils de bergers du Chouf devenu multimillionnaire en euros épouse Laure Brétigny de Tourneville. Mais comme souvent le glamour ne dure qu’un temps. Elias délaisse son épouse et le divorce vient clôturer leur brève idylle, sans toutefois que Laure ne cède ses parts au sein du Conseil d’administration. Quand Elias se retrouve à nouveau seul, il reprend contact avec son ami d’enfance et l’invite à découvrir son nouveau refuge, un prieuré dans le Morvan. C’est là qu’il choisit sa nouvelle voie. «La majeure partie de son temps, il la consacrait désormais à défendre ses convictions. Il avait voulu retrouver l’impression de peser sur le cours du monde. Le sentiment d’être utile. À l’âge où le commun des mortels songe à épargner pour la retraite, il s’était demandé comment dépenser au mieux son argent. Alors il avait saisi cette occasion offerte aux millionnaires de sentir à nouveau leur cœur qui bat sous leur portefeuille: il était devenu philanthrope.»
Une évolution que les témoins de l’époque racontent et détaillent, mettant au jour de nouvelles facettes de la personnalité de cet homme décidément bien mystérieux.
En croisant les points de vue, en faisant s’exprimer les proches d’Elias, en n’hésitant pas à chercher jusqu’au Liban la clé du mystère Naccache Éric L’Helgoualc’h réussit un roman où se mêle actualité brûlante et quête universelle, petits arrangements entre amis et grands sentiments, jalousie et envie, analyse et psychanalyse. Le tout sur un rythme de thriller qui rend «La déconnexion» très agréable à lire. Une belle réussite!
La déconnexion
Éric L’Helgoualc’h
Éditions du Faubourg
Premier roman
304 p., 18,90 €
EAN 9782491241148
Paru le 27/08/2020
Où?
Le roman se déroule en France, à Paris, mais surtout à Saugé-le-Château, petite ville au croisement de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de l’Ille-et-Vilaine. On y évoque aussi Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, la Normandie et le Morvan, en passant par Chalon-sur-Saône et Autun. Le Liban et la Syrie.
Quand?
L’action se situe du début des années 200 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Né au Liban pendant la guerre, Elias Naccache a fait fortune en revendant sa première start-up à la faveur de la bulle internet du début des années 2000. L’histoire commence lorsqu’il disparaît en Syrie où il a rejoint des volontaires chrétiens engagés contre Daech.
Qu’est-ce qui a pu conduire ce petit génie du web à se déconnecter au point de prendre les armes? Un magazine people confie à son ami d’enfance le soin de mener l’enquête. La biographie du disparu prend forme sous nos yeux, avec sa cohérence et ses zones d’ombre, dans un palpitant puzzle psychologique.
Qui est vraiment Elias Naccache? Un immigré avide de revanche? Un fasciste en puissance? Un amant trompé? À travers son histoire, c’est le portrait de notre époque qui se dessine, entre mirages technologiques, mise en scène de soi et crispations identitaires.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Toute la culture (Chloé Hubert)
Sophie Caillat, son éditrice, présente le premier roman de Éric L’Helgoualc’h La déconnexion © Production éditions du Faubourg
INCIPIT (Le premier chapitre du livre)
« Quand on perdit la trace d’Elias Naccache dans le chaos du conflit syrien, quelque part dans les ruines de Raqqa, sa disparition eut suffisamment d’écho pour qu’un magazine versé dans le glamour et les destins brisés me confie le soin d’écrire son portrait. Le public voulait comprendre comment un homme tel que lui, devenu millionnaire après la vente de sa première start-up, avait pu disparaître dans des circonstances aussi extravagantes. On s’était aperçu dans les rédactions qu’il existait peu d’informations fiables à son sujet. On disait qu’il s’était fait évincer de la direction de son fonds d’investissement par ses propres associés. Qu’il vivait reclus dans un monastère transformé en bunker sophistiqué. Qu’il avait développé une passion pour les armes à feu. Qu’il se préparait en secret à la guerre civile attisée par ses amis d’extrême droite. Jamais il n’avait pris la peine d’opposer le moindre démenti. Pour avoir œuvré à la plus formidable explosion d’ego de l’histoire, il avait compris que dans cette ère nouvelle, l’ultime luxe serait le silence.
Je me suis donc lancé dans l’exercice périlleux consistant à retracer sa vie sur la foi de quelques témoignages. J’avais pour m’aider le soutien ambigu du souvenir. Elias et moi avions noué à l’adolescence des liens d’amitié qui avaient survécu aux aléas de l’âge adulte. Comme tant d’autres avant nous, nous avions pris à vingt ans la route de Paris. Sa réussite avait été fulgurante. La mienne, toute relative, plus longue à se dessiner. Nous avions continué à nous voir par intermittence, jusqu’à ce que ses choix politiques nous éloignent pour de bon.
Je me suis mis au travail quelques semaines après sa disparition. Mon portrait est paru deux mois plus tard, en décembre 2017, huit pages sur papier glacé entrecoupées de publicités pour des montres de luxe. Je n’en avais pas terminé avec lui pour autant. Au début de l’année suivante, dans des circonstances évoquées plus loin, j’ai fini par accéder à un pan méconnu de cette histoire.
Ce livre est le fruit de cet éclairage nouveau. J’y décris le déroulement de mon enquête initiale, tout en explorant certains aspects de la vie d’Elias qui m’avaient largement échappé. Ce récit peut être vu comme la version optimisée d’un programme défaillant. Je m’y suis autorisé un ton plus personnel. Les détracteurs habituels de mes romans, ceux qui m’ont reproché mes excès dans la mise en scène de soi, ne manqueront pas d’y voir une nouvelle preuve de narcissisme. Après la parution d’un de mes livres, un commentaire m’a beaucoup amusé, d’autant qu’il visait juste : « Écrirait-il une biographie de Vercingétorix qu’il ne pourrait s’empêcher de se peindre en combattant d’Alésia, se demandant s’il tient correctement son épée pour la photo, si le grand moustachu hirsute qui agite sa hache à côté de lui a compris qu’il baisait sa femme ou s’il a bien fait de reprendre du sanglier. »
Bien vu, camarade critique ! Quel autre motif vous pousse à noircir des centaines de pages sur la vie d’un autre, sinon l’envie de vivre par procuration des choses qui vous seront à jamais interdites ? Dans chaque biographe, il y a un contemplatif saisi de vertige devant l’existence d’hommes et de femmes voués à la démesure. Plutarque devait s’ennuyer ferme dans son magistère de prêtre d’Apollon pour consacrer tant d’années à la vie des gloires de son temps, un ramassis de démagogues et de conquérants sanguinaires. Stefan Zweig était un Austro-Hongrois raffiné, baignant dans la poésie et l’opéra, attiré par des figures louches de prophètes, d’aventuriers et d’explorateurs. Je ne suis pas de la trempe d’un Zweig, et le personnage principal de cette histoire n’a sans doute rien d’un héros selon ses goûts, mais je n’ai pas peur, au moment d’entamer ce récit, d’assumer pleinement cette part de fascination.
Une flèche perforant la brume comme un rêve vaporeux. Le dialogue des cloches dans le lointain. Un vol d’étourneaux. L’automne qui glisse sur le bocage. Un concentré de campagne française. Cette France de publicité pour des produits gastronomiques où des gens continuent de vivre. Certains matins, on n’y voit rien à cinquante mètres, si ce n’est le clignotement d’une barre d’éoliennes alignées au bord du lac. Pour les paysans du coin, derniers témoins d’un merveilleux païen condamné à l’oubli, un monde de lunes rousses, de floraisons miraculeuses et de chats-huants traversant les nuits d’équinoxe, c’est la promesse d’un hiver glacial qui s’étalera jusqu’au premier redoux de mars.
Ainsi parlent les vieux du café d’en face, englués dans une éternelle partie de belote. Il arrive, c’est inévitable mais de plus en plus fréquent, qu’un d’entre eux en vienne à « casser sa pipe ». Depuis la fenêtre de mon bureau, je vois passer au ralenti le convoi funéraire, suivi d’une grappe de silhouettes voûtées qui luttent avec la dernière énergie contre le champ d’attraction du cimetière. Le soir, je les retrouve au Roncevaux, attablés devant un tas de cartes et une tournée de kirs, seigneurs imperturbables dans leurs costumes sombres. La mort d’un homme qu’ils ont dû croiser tous les jours pendant plus de soixante ans n’a pas l’air de les affecter plus que ça. J’entrevois des abîmes de haines recuites, querelles de murs mitoyens, passions dévorantes nées d’un bal de la Saint-Jean et tenues sous silence pendant un demi-siècle, paternités coupables enfouies dans la mémoire de vieilles nourrices. Les ferments habituels du drame paysan qui font le sel des sagas familiales tant prisées par ma mère. Si j’avais encore mes entrées à la Maison de la Radio, je rédigerais illico une chronique au vitriol pour écorner le mythe de la solidarité rurale, antidote supposé à l’anonymat des villes.
Vingt ans passés loin de ceux qui m’ont vu grandir et voilà que j’en parle comme Ovide en exil évoquant les mœurs des tribus locales du haut de sa supériorité romaine. Moi aussi, j’ai vécu comme une punition la série de catastrophes intimes qui m’a poussé à quitter Paris pour retourner vivre là où j’ai grandi, à Saugé-le-Château, petite ville au croisement de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de l’Ille-et-Vilaine. De mon enfance à Saugé, j’ai gardé une certaine aversion pour la vie de province. Après m’être cru installé dans la capitale, copropriétaire d’un trois pièces et d’une carte de membre du Silencio, j’ai le sentiment d’avoir été rejeté sur les rives du bassin parisien. D’être aussi inutile qu’un gadget en plastique charrié par la marée comme il en flotte au large des côtes chiliennes, un amas de la superficie d’un pays, presque un continent – j’ai vu pendant ma cure un documentaire sur le dispositif de ramassage dérivant inventé par un jeune ingénieur pour sauver les milliers de goélands qui meurent chaque jour d’avoir avalé des capsules de bouteilles usagées.
Suis-je moi aussi devenu un déchet toxique ? Pour peu qu’on jouisse d’une mince parcelle d’exposition médiatique, on voit passer sur Twitter un tel flot d’insultes qu’on finit par penser qu’elles contiennent une part de vérité. Ma courte expérience de la célébrité a culminé au milieu des années 2010, quand j’animais une pastille radiophonique sur France Inter. Cinq minutes durant lesquelles j’épinglais les travers de mes contemporains à coups d’aphorismes roublards, en affectant l’air détaché du majordome stoïcien qui réajuste sa cravate en plein naufrage du Titanic. Un producteur m’avait repéré au cours d’une émission où j’étais venu défendre mon dernier roman, tout juste auréolé du prix de Flore. J’avais, comme on dit, crevé l’écran, improvisant avec un artiste de stand-up ce qu’un site spécialisé dans l’actualité des médias devait décrire comme « un numéro de duettistes désopilant » au détriment d’un candidat à la présidentielle. À l’issue de cette prestation, un ponte de Radio France avait eu l’idée, pour pimenter la matinale en perte de vitesse, de me confier une chronique « poil à gratter ». Il avait fait le pari qu’un romancier à la cote frémissante, auquel on prêtait « un regard acerbe et décalé sur la société », secouerait un auditoire lassé des attaques à sens unique des humoristes en place.
Je me suis acquitté de ma tâche avec sérieux et abnégation, tapant fort et large, affichant une prédilection pour mes semblables, ces affreux bobos caricaturés en cœur de cible de la station, même si mon spectre était plus généreux, embrassant aussi bien les ayatollahs du marché libre que les adorateurs transis du peuple-roi. Bref, une chronique bien dans le ton d’une époque qui réserve un sort privilégié à ceux qui attisent les flammes, vestales modernes incarnant l’esprit de la cité, libre de sa parole et égalitaire dans ses détestations successives. J’avais ce talent, on m’a payé pour l’exercer, et plutôt bien d’ailleurs.
À présent, ce potentiel de toxicité, illimité à en croire l’intéressée, j’en use essentiellement aux dépens d’Adèle, mon ex-femme, celle que j’appelle désormais « la mère de mes enfants ». La jeune étudiante en lettres avec laquelle j’ai parcouru les cimetières en déclamant des poèmes devant les tombes de mes chers auteurs morts. Celle dont j’ai adoré chaque parcelle de peau dans la ferveur des premières nuits. Celle qui a guidé mes débuts d’écrivain en supportant d’une humeur égale mes bouffées d’enthousiasme et mes crises d’inspiration. Celle qui m’a laissé seul sur la piste lorsque j’entamai ma glissade sur les neiges artificielles d’une célébrité de saison, glissade pathétique d’où surnage le souvenir de coucheries fugitives et de matins honteux. Pas le premier ni le dernier des gentilshommes de province à Paris qui finisse essoré par la machine à la première occasion de briller.
C’est fou le nombre de sollicitations dont vous pouvez faire l’objet quand votre voix touche subitement plusieurs millions d’auditeurs. Après mes débuts à la radio, chaque fois que je me rendais à une soirée, les invités murmuraient sur mon passage. Les femmes riaient de ma conversation, ce qui était de plus en plus rare pour la mienne. J’étais devenu un support à selfies convoité. Au début, j’ai tenté de résister. Je me contentais d’un badinage agréable et sans conséquences, retrouvant des automatismes enfouis sous douze années de vie conjugale. Imaginer des combinaisons masturbatoires impliquant certaines filles croisées la veille suffisait à mon bonheur. Jusqu’à ce que je me réveille un matin dans un lit aux draps roses, le nez dans un tigre en peluche, avec la sensation de m’être fait greffer une barre de métal au milieu de la tête. Dans la salle de bains, une blonde entièrement nue aux fesses insolemment fermes se débarbouillait en maugréant, inquiète à l’idée d’être en retard à son cours. Inutile de préciser qu’elle avait vingt ans de moins que moi. Inventer un mensonge pour justifier ma défection nocturne fut étonnamment simple. La facilité avec laquelle je me tirai de ce mauvais pas m’encouragea à persévérer dans ma nouvelle vie de libertin.
Comme en toute bonne leçon de sagesse antique, je dois ma chute à l’instrument de mon méfait. La première erreur fut d’oublier mon smartphone sur la table basse du salon. La deuxième, d’avoir omis d’effacer certains fichiers compromettants. J’avais conservé mes échanges les plus piquants, parfois accompagnés de selfies dénudés, dans un dossier que j’avais eu la naïveté de croire inaccessible. Adèle n’eut aucun mal à ouvrir la boîte de Pandore après en avoir deviné le code d’accès : le même que pour verrouiller tous nos appareils électroniques. Troisième erreur. Je fus mis à la porte de l’appartement le lendemain à l’issue d’une nuit déchirante que ne remplacera dans mon souvenir aucune de celles passées avec mes maîtresses d’un soir. Un mois plus tard, elle demandait le divorce.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés, Adèle et moi, dans le bureau du tribunal de grande instance, à faire solder par l’institution les comptes de notre mariage. Son avocat l’avait poussée à réclamer une pension substantielle. C’était parfaitement justifié : de nous deux, j’étais encore le plus bankable. Ce qui me faisait vraiment mal, c’est l’énergie qu’elle mettait à torpiller toute forme d’arrangement raisonnable concernant la garde de nos enfants. Mes chances de faire bonne figure furent anéanties d’entrée de jeu lorsqu’elle produisit devant le juge des lettres signées de futurs ex-amis témoignant de mes petites addictions. Plus tard, mon avocat me reprocha de lui avoir caché « certaines choses » sur mon mode de vie, des choses que la justice considère avec la plus grande sévérité dès lors qu’il s’agit de confier la garde d’enfants mineurs à un homme aux revenus aléatoires, écrivain de surcroît, porté par nature aux excès en tout genre. L’adultère, passe encore ; l’alcool et la drogue, c’était une autre affaire.
Il ne me restait plus qu’une carte à jouer pour obtenir un arrangement : entrer en cure de désintoxication. Pour moi, il n’y avait jamais eu de problème. Je trouvais même que je m’étais plutôt assagi ces derniers temps. Un ou deux verres avant le dîner, le joint occasionnel, quelques lignes en soirée. La vérité, c’est que j’étais devenu totalement accro. Pour autant, l’idée de cure me terrifiait. Le mot renvoyait l’image de grands bourgeois en peignoir flottant dans les couloirs d’un hôtel suisse comme des fantômes de cartoon, avec pour seule distraction, entre deux promenades, l’attente toujours déçue d’une épiphanie gastronomique qui viendrait rompre le cycle éternel des légumes vapeur. Je me pliai néanmoins aux conseils de mon avocat. Ce fut une longue plage d’ennui entrecoupée de violentes crises d’angoisse dans une clinique de la côte normande.
L’écho de mes déboires ne tarda pas à se répandre. Mon éditrice eut beau maquiller les faits du mieux qu’elle pouvait, évoquant une simple cure de repos, j’étais rattrapé par des années de comportement borderline. Dans la débâcle, les langues se délièrent. Chaque stagiaire que j’avais gratifiée d’un bon mot y alla de sa petite révélation. Ces anecdotes déformées par la rumeur firent gonfler le chœur des indignés. Le bruit finit par arriver aux oreilles de la direction de Radio France. On trancha rapidement en faveur de mon éviction. L’explication donnée à l’antenne valait bien toutes les autres : «La rédaction a voulu laisser au trublion, en proie à des problèmes personnels, le temps de se reconstruire.»
En sortant de la clinique, je n’avais nulle part où aller, aucun engagement à honorer. L’idée de devoir chercher un appartement me déprimait. La perspective de m’installer à l’hôtel, pire, de squatter une chambre d’amis, n’était guère plus réjouissante. J’avais peur en restant à Paris de fondre en larmes devant la première connaissance croisée au coin de la rue. Mes journées se résumaient à imaginer celles de mes enfants, qu’il m’était devenu difficile d’approcher en dehors des vacances et des week-ends de garde. Je ne pouvais pas continuer comme ça très longtemps. Il fallait me fixer, me concentrer sur quelque chose. Me remettre à écrire. Pour cela j’avais besoin de calme, à défaut de sérénité.
Alors j’ai pris la première option qui s’offrait: retourner vivre chez mes parents. »
Extraits
« Au bout d’une semaine d’un tel traitement, je commençais à saturer. Et pourtant, j’avais pris l’habitude de vivre avec le personnage médiatique d’Elias Naccache. Vingt ans que ça durait. Vingt ans que ses tribulations venaient se rappeler au bon souvenir de mon moi adolescent pour lui demander: et toi, qu’as-tu fait de tes rêves? Vingt ans que j’étais «jaloux de lui», comme le prétendait Adèle. Jaloux de sa renommée et de ses millions, mais surtout de ses incarnations successives. Il y avait d’abord eu le petit prince de l’internet, puis le reclus aux tentations mystiques, avant le retour en grâce ou plutôt en disgrâce, vu les ennuis que lui avait valus son engagement comme pourvoyeur d’opinions radicales. J’avais beau trouver ces idées détestables, elles avaient beau être à l’origine de notre brouille, il y avait dans son combat un mépris pour l’adversité et un côté punk qui chatouillaient en moi une attirance ancienne pour les postures de maudit. » p.30
« À la même époque, je lui ai demandé s’il n’avait jamais eu envie de monter une nouvelle start-up comme son copain Ambrosini. Il m’avoua qu’en tant qu’entrepreneur, il avait brûlé tout son kérosène. La majeure partie de son temps, il la consacrait désormais à défendre ses convictions. Il avait voulu retrouver l’impression de peser sur le cours du monde. Le sentiment d’être utile. À l’âge où le commun des mortels songe à épargner pour la retraite, il s’était demandé comment dépenser au mieux son argent. Alors il avait saisi cette occasion offerte aux millionnaires de sentir à nouveau leur cœur qui bat sous leur portefeuille: il était devenu philanthrope. » p. 160
« Cherche du côté de la mère: je n’avais pas oublié les conseils de ma chère commanditaire. De ce point de vue-là, le résultat de mon entrevue avec Georges Lahoud dépassait ses espérances. Cette tension latente entre Elias et Leïla, ces frottements entre deux êtres au tempérament abrasif, il suffisait d’en récupérer la limaille et de la plonger dans l’élixir de la psychanalyse pour en obtenir de l’or. Le gamin épris de science quand sa mère ne jure que par la littérature. L’étudiant surdoué à qui elle interdit de faire Polytechnique pour ne pas le voir défiler en uniforme et qui finit en treillis, les armes à la main. L’enfant d’un couple de révolutionnaires arabes qui épouse une héritière de l’aristocratie française. Le fils d’une militante marxiste devenu multimillionnaire à vingt-cinq ans, philanthrope conservateur à quarante. » p. 188
À propos de l’auteur

Éric L’Helgoualc’h © Photo DR
Éric L’Helgoualc’h est né en 1980. Il a longtemps travaillé dans le web et la communication avant de se consacrer à l’écriture. (Source: Éditions du Faubourg)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
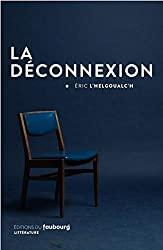


Tags:


