



Prix Envoyé par La Poste 2020
En deux mots:
De 1983 à aujourd’hui, la vie d’une famille libanaise va basculer. À travers les yeux d’une narratrice, ce sont les années de guerre civile qui défilent, puis celles de l’exil en France, lorsqu’il faut prendre congé d’un père qui décide de rester à Beyrouth.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
Chant d’amour pour un père, pour un pays
Dans un premier roman qui résonne fort aujourd’hui, Dima Abdallah raconte le Liban qu’elle a dû quitter au moment de la Guerre civile. Une chronique émouvante qui est aussi un chant d’amour pour son père.
Beyrouth, 1983. C’est la guerre qui déchire le Liban et rend la vie si difficile. Mais pour la narratrice de six ans, le bruit des tirs et les déflagrations qui secouent la ville, c’est aussi le moyen de gagner un peu de temps de liberté. Elle en vient à souhaiter que les tirs redoublent d’intensité pour qu’ils soient tous renvoyés chez eux. Que son géant de père vienne prendre son petit doigt dans sa grande paume et qu’ils rentrent chez eux. Car le géant a un super-pouvoir: «Le géant est une gigantesque étoile qui illumine tout et un trou noir qui avale tout ce qui se trouve à proximité. Ce n’est pas que les autres personnes autour de lui sont moins importantes, c’est seulement que le trou noir a un tel poids, une telle force gravitationnelle, qu’il engloutit tout.»
Chez eux, c’était jusqu’il y a peu dans le sud de la ville, mais maintenant que le mur a laissé la place à un trou, il a bien fallu partir. Des amis qui ont choisi de fuir le pays leur ont laissé leur appartement sur le front de mer, au 9e étage d’un bel immeuble. S’il n’y avait pas sans cesse des coupures de courant qui empêchent de prendre l’ascenseur, la vie serait belle.
Dima Abdallah a choisi de donner successivement la parole aux deux principaux protagonistes, à la fille et au père, à ce géant qui fait semblant de maîtriser la situation, mais qui doute et s’angoisse. «Je vais continuer à lui dire que rien de tout cela n’est grave, qu’elle a bien raison de ne pas pleurer, qu’on ne risque rien et que ça ne nous regarde pas, ce vaste bordel. Je me dis qu’il n’y a pas besoin d’en parler, demain on ira acheter un pot de marjolaine pour remplacer celui qui a fané et on mangera une glace. Chaque soir, on trouvera la force d’oublier ce qui s’est passé pendant la journée et chaque matin on trouvera une parade pour oublier la nuit passée. Je crois que l’oubli est la meilleure des solutions…»
Au fil des semaines, avec son frère et sa mère, journaliste et prof de français, ils tentent de s’adapter au mieux, espérant un répit. Qui ne viendra pas. En lieu et place de la paix, ce sont les crises d’angoisse, la peur qui paralyse et qui rend malade. Après douze ans, il n’est plus possible de faire semblant. La sécurité n’est plus garantie et le moral s’est effondré. La confession du chef de famille – qui résonne tout particulièrement à la lumière des événements récents – est bouleversante: «Ma chute était synchronisée avec celle du pays. Des morceaux de moi se détachaient sur le rythme où les immeubles s’écroulaient. Je devenais aussi toxique que cette ville. Je sentais le soufre et le sang coagulé. De moi coulait la même pollution que celle qui se déversait dans la mer, chaque jour. Je me désagrégeais sur le même tempo que cette ville».
Pour la jeune fille et pour son père, une nouvelle vie commence de part et d’autre de la Méditerranée. Une séparation, une douleur, un déchirement. Car cette nouvelle vie n’est pas une vie. Tout juste une survie. L’exil est d’abord intérieur: «Partir n’est pas une histoire de géographie. Tous étaient déjà partis avant même de prendre la route».
Et si, durant les premiers temps, la famille va conserver l’illusion que cet éloignement n’est que provisoire, elle devra vite déchanter. Partager l’odeur du café du matin et même celle du jasmin qui pousse sur leurs terrasses respectives ne met plus de baume au cœur. Il creuse la distance, donne à la nostalgie le poids de la tristesse. Et rend si difficile le choix des mots pour dire tout leur amour. Il ne faut pas blesser, il ne faut pas ajouter de la tristesse à la tristesse, il ne faut pas remuer les plaies toujours vives.
Mais le mal est profond et les mots deviennent vite dérisoires lorsqu’on a l’impression d’avoir tout perdu: «Ils ont pris ma ville. Ma ville est tombée. Elle s’est effondrée et des étrangers sont venus en rebâtir une nouvelle, une réplique de mauvais goût, un artifice, une ville factice. Dans les égouts, le sang de leurs victimes doit encore couler. La Méditerranée ne devrait plus être bleue mais rouge.»
Mauvaises herbes
Dima Abdallah
Sabine Wespieser éditeur
Premier roman
240 p., 20 €
EAN 9782848053608
Paru le 27/08/2020
Où?
Le roman se déroule au Liban, à Beyrouth principalement, puis en France, à Paris, avec des voyages d’un pays à l’autre.
Quand?
L’action se situe de 1983 à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Dehors, le bruit des tirs s’intensifie. Rassemblés dans la cour de l’école, les élèves attendent en larmes l’arrivée de leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier chapitre ne pleure pas, elle se réjouit de retrouver avant l’heure « son géant ». La main accrochée à l’un de ses grands doigts, elle est certaine de traverser sans crainte le chaos.
Ne pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte un appartement pour un autre tout aussi provisoire, l’enfant née à Beyrouth pendant la guerre civile s’y est tôt habituée.
Son père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, dans cette ville détruite, son pouvoir n’a rien de démesuré. Même s’il essaie de donner le change avec ses blagues et des paradis de verdure tant bien que mal réinventés à chaque déménagement, cet intellectuel – qui a le tort de n’être d’aucune faction ni d’aucun parti – n’a à offrir que son angoisse, sa lucidité et son silence.
L’année des douze ans de sa fille, la famille s’exile sans lui à Paris. Collégienne brillante, jeune femme en rupture de ban, mère à son tour, elle non plus ne se sentira jamais d’aucun groupe, et continuera de se réfugier auprès des arbres, des fleurs et de ses chères adventices, ces mauvaises herbes qu’elle se garde bien d’arracher.
De sa bataille permanente avec la mémoire d’une enfance en ruine, l’auteure de ce beau premier roman rend un compte précis et bouleversant. Ici, la tendresse dit son nom dans une main que l’on serre ou dans un effluve de jasmin, comme autant de petites victoires quotidiennes sur un corps colonisé par le passé.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Livres Hebdo (Alexiane Guchereau)
A voir A lire (Oriane Schneider)
L’Orient – Le jour (entretien avec Georgia Makhlouf)
Dima Abdallah présente son premier roman, Mauvaises herbes © Production Librairie Mollat
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« BEYROUTH, 1983
LA MAIN DU GÉANT est tellement immense qu’un seul doigt me suffit. Il me tend toujours le doigt au lieu de me prendre par la main. Je sens l’épaisseur de chaque phalange sous ma paume qui serre fort. Quand l’auriculaire m’échappe, il me tend l’index. Je marche en titubant un peu parce que c’est souvent difficile pour moi d’avancer au bon rythme. Je sais qu’il sait parfaitement où aller. Alors je le suis péniblement, m’accrochant comme je peux au doigt, à un rythme bien trop rapide pour mes petites jambes et dans un espace bien trop grand et chaotique pour que mes petits yeux l’apprivoisent. À ma hauteur, il n’y a que mes camarades qui s’agitent et s’agglutinent autour de nous. Je n’aime pas beaucoup mes camarades, surtout quand ils pleurent. Et je n’aime pas quand il y a autant de gens et autant de bruit. Moi, je n’ai pas trop peur, vu que je suis avec mon géant. J’ai décidé que, dans ce genre de situations, il fallait lui faire confiance. Il est fort et il est très intelligent. Quand le doigt m’échappe, je m’agrippe à un bout de tissu du pantalon qui couvre l’énorme cuisse. Il s’arrête alors et me tend de nouveau la main. L’auriculaire, ou l’index. Il me dit parfois des choses que j’entends mal, alors je ne lui réponds pas, mais ce n’est pas trop grave, on se parlera plus tard. Je me contente de m’accrocher à la main et je reste bien concentrée pour ne surtout pas la lâcher. Je serre fort ce doigt, je sais que c’est important. Je lève parfois la tête pour regarder son visage et je me dis à chaque fois qu’il est drôlement grand.
Il est venu me chercher dans une cour qui n’est pas la mienne. C’est là qu’on nous rassemble dans ces cas-là, quand ils appellent les parents pour qu’ils viennent. C’est dans cette petite cour que les enfants se mettent à pleurer et à sangloter en chœur. Il y a le premier et, comme un effet domino, ils se mettent tous à pleurer les uns après les autres. Moi, j’ai toujours regardé ces scènes avec incompréhension. Je les envie d’être aussi similaires, aussi coordonnés. J’avais beau essayer de penser à des choses tristes pour pouvoir pleurer avec eux, je n’y arrivais pas. Non, moi, comme d’habitude, dès que les tirs se sont intensifiés, j’ai prié pour que ça dure assez longtemps pour inquiéter les professeurs. Je savais que, plus le bruit était fort, plus les explosions étaient régulières et rapprochées, plus on avait une chance de rentrer chez nous. Je ne suis pas bête, je sais qu’il se passe quelque chose, quelque chose de sérieux. Les adultes emploient un ton très solennel quand ils en parlent. Ils sont souvent très nerveux. Par exemple, ils n’aiment pas quand on achète des pétards et des feux d’artifice et, quand ils en entendent un éclater, ils insultent parfois les gamins dans la rue. Moi, je crois que ce n’est pas si grave que ça, ces histoires de guerre, et je n’aime pas trop parler de ces choses-là. Ça ne me regarde pas et puis je ne suis pas très douée pour parler des choses sérieuses.
Aux premières détonations, personne n’a réagi dans la classe, c’est à peine si la maîtresse a arrêté de parler quelques secondes. Le bruit semblait encore lointain et irrégulier. Moi, je n’écoutais plus rien de ce qu’elle disait et je priais ciel et terre pour que les tirs s’intensifient et que le bruit se rapproche. J’ai inventé une petite prière que je fais dans ma tête quand j’ai quelque chose à demander à Dieu. Mon Dieu à moi, pas celui des autres. Celui des autres, je ne l’aime pas trop. Quand le visage de la maîtresse s’est crispé, j’ai tranquillement commencé à ranger mes affaires dans mon cartable avant même qu’elle nous le demande. Avant de donner l’ordre de sortir de la classe, elle prend toujours la peine de dire aux enfants, « ce n’est pas grave », « il ne faut pas paniquer », sans en perdre son français, ce à quoi la classe entière répond toujours par des cris d’effroi en chœur et en arabe.
Une fois dans la petite cour où on attend les parents, c’est un concerto, un psychodrame que je regarde comme un film. C’est les caïds qui me fascinent le plus. J’observe à chaque fois avec émerveillement ces petits durs sangloter dans les jupons de la maîtresse. Je les dévisage, subjuguée par les larmes, la sueur et la morve qui coulent à flots. C’est peut-être parce que je suis la seule à ne pas pleurer que la maîtresse ne m’aime pas. Moi, je n’arrive pas à me forcer à pleurer, ce n’est pas de ma faute. J’ai vraiment essayé, pourtant. J’essaye à chaque fois. À côté de mes camarades en panique, je jubile en essayant que ça ne se remarque pas trop et je guette l’arrivée de mon géant à travers un petit trou dans le mur de la cour. Un trou si petit qu’on ne distingue presque rien à travers. Ça ne m’empêche pas d’essayer de guetter sa venue. Puis, le visage écrasé sur le mur, on me voit moins. On voit moins qu’aucune larme ne veut bien couler de mes yeux.
En plus, juste à côté de mon mur, il y a un grand bac de terre où poussent différentes fleurs dont je ne connais pas le nom. J’aime bien observer les pétales de près et caresser les feuilles. Ça m’occupe et c’est comme si toucher les fleurs rendait les cris de mes camarades moins stridents. Je suis bien contente que mon petit frère soit resté à la maison aujourd’hui. À chaque fois que je regarde mes camarades pleurer, je pense à lui et aux imbéciles de sa classe qui doivent paniquer encore plus, vu qu’ils sont tout petits, et lui faire peur avec leurs cris. Je ne veux pas qu’il ait peur.
J’essaye toujours de refaire ma queue de cheval bien comme il faut pour que le géant me trouve jolie en arrivant. C’est aussi pour ça que je suis bien contente de ne pas pleurer. Je ne voudrais pas qu’il me voie pleurer. Je veux être jolie et souriante. Je mouille la paume de ma main avec un peu de salive et j’essaye de lisser tous les petits cheveux qui font des frisottis au-dessus du front. Les filles qui pleurent le plus sont celles qui sont le mieux coiffées, elles n’ont jamais des petits frisottis sur le devant. La plupart ont les cheveux lisses et bien coiffés, même en fin de journée. Moi, je ressemble à un petit mouton avec mes boucles qui essayent de se faire la malle à longueur de journée.
Il m’a souri en arrivant et m’a tendu vite le doigt pour que je comprenne qu’il n’y avait pas le temps pour les accolades et les bisous et qu’il fallait rentrer tout de suite. Il m’a dit qu’on irait manger une glace, mais moi, je sais que ce n’est pas vrai. J’ai six ans, je ne suis pas bête. On a échangé deux ou trois mots pour se dire qu’on était bien contents de se retrouver et que ce n’était pas bien grave, tout ce remue-ménage, puis il a pris mon cartable. Le géant et moi quittons la cour des petits pour en traverser une autre, celle des plus grands. Un grand portail en fer peint en gris clair sépare les deux. Dans la mienne, il y a un grand bac à sable, alors que celle-ci est juste un immense rectangle bétonné. Le grand rectangle donne encore sur une autre cour, celle des vrais grands, celle du collège. Nous traversons une toute petite partie de cette dernière, à peine quelques mètres, pour rejoindre la grande descente menant au portail principal de l’établissement.
Quand je le regarde, je trouve que le géant est très beau, bien plus beau que tous les autres parents qui sont venus. Je sais qu’il ne faut pas que je lâche son doigt, alors je reste concentrée sur la main. La pente est l’autoroute qu’ils empruntent tous vers la sortie. Des plus petits aux plus grands, le passage impératif vers la sortie est celui-ci, il n’y en a pas d’autres. L’organisation si pensée, la séparation si organisée entre les petits, les un peu moins petits, les moyens, les grands moyens, les grands, les adolescents et les adultes vole complètement en éclats dans la pente qui mène à la sortie. Il porte mon cartable, mes pas n’en sont pas plus sûrs, parce qu’il y a trop de gens. Je pourrais lui dire de marcher moins vite, mais je n’ai pas envie de le déranger, il a l’air très concentré. Mon géant m’escorte vers la sortie et plus nous nous rapprochons du grand portail, plus je sens son doigt se crisper dans ma paume. Parfois, marcher en ligne droite n’est pas possible et nous devons contourner les obstacles, mon corps se met alors au rythme qu’il me dicte. L’auriculaire m’indique par où il faut passer. Mon cerveau fait écran noir et ordonne à mon être entier de ne prendre pour repère que le géant. Voire que la main. Voire que le doigt.
Je connais les mains de mon géant comme si je les avais moi-même façonnées. Et plus encore. Je connais encore mieux la main droite, c’est celle que je tiens. Je la reconnaîtrais parmi des millions d’autres. J’en connais chaque doigt, chaque phalange, chaque ongle, chaque poil. J’en connais l’odeur, j’en connais le taux d’humidité à la surface et la mesure exacte de la moiteur de la paume. J’en connais la consistance, les différentes consistances. J’en connais les différentes épaisseurs et les différentes rugosités, celles de chaque phalange. Je connais l’ongle le plus lisse et l’ongle le moins lisse. Je connais le nombre de millimètres taillés à chaque fois qu’il se coupe les ongles, toujours très court. Je sais lequel des cinq doigts est le plus poilu et celui qui l’est le moins. Je sais les moindres petits détails de la paume et la manière dont le sang y circule, rendant la peau plus rouge à certains endroits qu’à d’autres. Je sais le petit défaut de l’ongle de l’index. Un demi-millimètre d’ongle manquant entre la cuticule et le reste de l’ongle, à gauche.
Les regards et les mots sont furtifs. Il a beau tendre son doigt et vérifier de temps en temps que je m’y accroche bien, tout son être scrute droit devant la sortie principale. Je sens l’urgence qui agite le géant. Son corps a beau essayer de faire l’effort de se mouvoir à mon rythme, sa précipitation n’en est que plus criante. Il prend sa mission avec un sérieux palpable jusque dans la moiteur de sa main. Les derniers mètres qui nous séparent de la porte ressemblent au dernier rebondissement, quand le chevalier mobilise tout son courage et toute sa force avant de porter le coup de grâce au dragon et de sortir en courant du donjon qui s’effondre deux secondes après qu’il en a franchi le seuil dans une acrobatie extraordinaire. Mais non. La scène finale n’est pas celle-ci, car, après la grande porte de sortie, il y a le dehors, il y a la rue et les détonations qui se rapprochent. Il y a les autres, la foule agglutinée devant la porte, chacun essayant, comme il le peut, de s’extraire de cette fourmilière dans le bruit assourdissant du trafic, des klaxons, du ronronnement permanent de la ville. Le géant prend sa mission plus que jamais au sérieux. Pendant la traversée chevaleresque de la cour, il n’était qu’en préparation, il s’entraînait pour la vraie mission du dehors. Il n’y a plus de cours, plus de limites, plus de chemin balisé vers la sortie, plus de remparts au château, plus de donjon, plus de dragon. Il n’y a que lui, moi et l’infini chaos qui nous sépare de la maison.
C’est à ce moment-là, quand on franchit le grand portail de fer, que sa main entière attrape mon poignet. Il n’y a plus de doigt, ma main ne tient plus rien, je n’ai plus d’accroche, je ne peux plus regarder encore et encore tous les détails de ses phalanges. Sa main délaisse parfois mon poignet pour agripper mon épaule, pour me rapprocher encore plus de son corps, pour que nos corps fassent encore plus corps. De temps en temps, sa main moite exerce une pression sur mon poignet, mon bras ou mon épaule et me fait un peu mal, mais je ne dis rien. Je ne veux pas le perturber, déranger son extrême concentration. Quand je lève la tête, je vois perler sur son visage des grosses gouttes de sueur. Il y en a qui coulent le long des tempes et de la mâchoire, et d’autres qui dégoulinent le long du nez. Parfois il ordonne fermement quelques « allez » ou « attention » et j’obéis. Je comprends bien qu’il faut rentrer vite. »
Extraits
« Pour engager la conversation, il me montre souvent telle ou telle plante en pot sur le balcon et m’apprend le nom de chacune d’elles. Il frotte sa main sur l’origan ou la marjolaine et me fait sentir ses doigts. »
« Je ne sais plus ni quand ni comment c’est arrivé. Je ne sais plus ni quand ni comment l’oxygène a réussi à se frayer un chemin jusqu’au fond de mes poumons. »
« Je vais continuer à lui dire que rien de tout cela n’est grave, qu’elle a bien raison de ne pas pleurer, qu’on ne risque rien et que ça ne nous regarde pas, ce vaste bordel. Je me dis qu’il n’y a pas besoin d’en parler, demain on ira acheter un pot de marjolaine pour remplacer celui qui a fané et on mangera une glace.
Chaque soir, on trouvera la force d’oublier ce qui s’est passé pendant la journée et chaque matin on trouvera une parade pour oublier la nuit passée. Je crois que l’oubli est la meilleure des solutions, je suis en train de développer une sorte de superpouvoir pour ce qui est de l’oubli. je travaille à effacer de ma mémoire toutes les images qui dérangent, que je ne supporte plus de voir. Je ne garde que les souvenirs d’avant, avant que tout cela n’arrive. Je travaille ma mémoire au corps. »
« Pendant douze ans, je les ai vus tous deux naître et pousser dans cette ruine, l’un après l’autre. Pendant toutes ces années, je les ai regardés faire semblant de ne pas avoir peur. Pendant douze ans, je les ai vus s’acharner à vouloir respirer ce qui restait d’oxygène. Au diable la patrie. Au diable les racines. Douze ans de cages d’escalier. Douze ans d’eau salée, douze ans de baissez vos têtes. Douze ans à me regarder, moi, m’écrouler comme une tour, une pierre après l’autre, m’effondrer lentement et inexorablement. M’effondrer sur eux. Douze ans à me regarder me morceler, me défragmenter. Ma chute était synchronisée avec celle du pays. Des morceaux de moi se détachaient sur le rythme où les immeubles s’écroulaient. Je devenais aussi toxique que cette ville. Je sentais le soufre et le sang coagulé. De moi coulait la même pollution que celle qui se déversait dans la mer, chaque jour. Je me désagrégeais sur le même tempo que cette ville. Les cris de ceux qu’on torturait jaillissaient de ma bouche et transpiraient de tous les pores de ma peau.
Douze ans à assister à la ruine de tout. Douze ans à regarder tout chanceler et puis tomber. C’est bien qu’ils soient partis. Peut-être qu’avec le temps ils pourront se reconstruire, se construire, ils sont encore si jeunes. Douze ans dans mille maisons sans jamais être à la maison. Douze ans de maison dans le coffre de la voiture. Douze ans à se demander la salle de bains, la cage d’escalier ou l’abri? Douze ans d’aucun parti, d’aucun bord, d’aucune milice, d’aucun groupe, d’aucune appartenance, d’aucune confession. Douze ans d’errance. »
« Ces rues n’étaient plus les miennes, cette ville n’était que le spectre de ma ville, de celle que j’ai connue. je marchais parmi les gens et je me disais que ce ne sont ni mes semblables, ni mes concitoyens, ni même les vrais habitants de cette ville. Ils sont une espèce mutante qui a attaqué la ville, l’a colonisée et s’est emparée de toutes ses rues, de tous ses magasins et de tous ses cafés. Ils ont pris ma ville. Ma ville est tombée. Elle s’est effondrée et des étrangers sont venus en rebâtir une nouvelle, une réplique de mauvais goût, un artifice, une ville factice. Dans les égouts, le sang de leurs victimes doit encore couler. La Méditerranée ne devrait plus être bleue mais rouge. »
À propos de l’auteur

Dima Abdallah © Photo David Poirier
Née au Liban en 1977, Dima Abdallah vit à Paris depuis 1989. Après des études d’archéologie, elle s’est spécialisée dans l’antiquité tardive. Fille des écrivains Mohammed Abdallah, dont un de ses poèmes traduit de l’arabe clôt le roman, et Hoda Barakat, elle a écrit des nouvelles et des poèmes jamais publiés. Mauvaises Herbes est son premier roman. (Source: Éditions Sabine Wespieser / Livres Hebdo)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
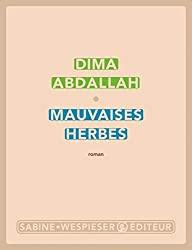


Tags:


