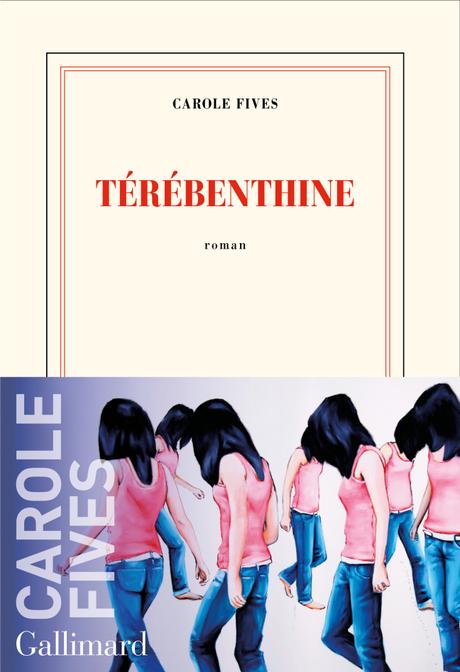

En deux mots:
Admis à l’école des Beaux-Arts, Luc, Lucie et la narratrice vont choisir de s’exprimer à travers la peinture. Une technique qui leur vaudra les railleries de leurs professeurs et congénères, mais soudera «les térébenthine» tout au long d’une formation aux multiples facettes.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
Les beaux-arts mènent à tout
En retraçant ses années d’études aux Beaux-Arts, Carole Fives fait bien plus que nous livrer une part de son autobiographie et la naissance de sa vocation. Térébenthine est aussi un traité sur l’art et un réquisitoire – féministe – contre son enseignement.
Carole Fives a choisi de faire les Beaux-Arts. Une période de sa vie qui sert de terreau – très fertile – à ce roman bien éloigné de son précédent opus Tenir jusqu’à l’aube, si on considère son combat féministe comme un invariant à toute son œuvre.
Bravant les mises en garde à l’égard d’une filière qui n’offre guère de débouchés, sauf pour une petite poignée d’artistes, la narratrice réussit son concours d’entrée et se retrouve très vite confrontée à un univers étrange où des concepts sont assénés de façon définitive par des enseignants qui semblent avoir compris que l’art avait désormais atteint ses limites, que la technologie allait transformer cet univers comme tant d’autres et que le spectacle, la «performance» allait prendre le pas sur l’œuvre elle-même.
Dans ce contexte, le trio qu’elle forme avec Luc et Lucie va très vite être marginalisé, non seulement parce qu’il se retrouve au sous-sol de l’école – le seul endroit où il est encore possible de peindre – mais parce qu’il est le seul à se confronter à cette «vieille» technique que plus personne n’enseigne: «À l’école, le professeur de peinture est en dépression depuis deux ans et, pour d’obscures raisons, il n’a pas été remplacé. C’est donc entre étudiants que vous allez vous former le plus efficacement, les autres enseignants ne se risquant que rarement jusqu’aux sous-sols, préférant éviter d’attraper la tuberculose et autres infections propres aux miséreux et aux artistes maudits.»
Le trio, reconnaissable à l’odeur qu’il traîne avec lui et qui lui vaudra le surnom de «Térébenthine», est victime de railleries, mais cet ostracisme aura aussi pour conséquence de les souder davantage. Ils sont pourtant loin de partager les mêmes idées sur l’art et sur la manière d’exprimer leurs idées. Mais ces débats font tout l’intérêt du livre. À chaque affirmation d’un professeur, à chaque confrontation aux œuvres des grands artistes, les questions sur le rôle de l’art, sur la façon de juger les œuvres, sur la définition du beau sont âprement discutées. Et très vite, au-delà des théories et de l’histoire de l’art, il est question d’émotions. Comme quand, à l’occasion d’un voyage à New York, la narratrice est saisie par la puissance d’un Rothko, par cette part inexplicable qui vous happe et vous transforme. Ou quand, devant l’œuvre que l’on imagine, «les pinceaux tombent, la distance s’abolit, et c’est le corps-à-corps, le peau-à-peau: la toile a tant à offrir.»
Carole Fives nous livre tous les aspects de ces années de formation qui, au-delà des études, s’étendent à la politique et aux questions de société, à l’amour et à la prise de conscience de la place de la femme dans un milieu très machiste. Elle s’imagine qu’en couchant avec Dimitri, elle pourra peut-être capter un peu de son savoir-faire, mais se rend vite compte que ce professeur accumule les aventures pour comble l’absence de sa femme Olga restée au Tatarstan. Elle va alors se détourner de lui et de ses enseignements. Et si durant une sorte de grand happening, elle pourra célébrer les artistes femmes, il faudra subir le machisme ambiant jusque dans sa chair. On notera du reste que la solidarité féminine est tout autant un leurre. Quand, par exemple, pour tout encouragement Véra Mornay lui explique qu’«un bon peintre est un peintre mort». Un tel «enseignement» conduisant à des drames.
Mais au-delà des obstacles et des attaques vécus dans cet «asile de fous» – pour reprendre la qualification utilisée par son père venu voir les travaux de fin d’année – viendra la révélation de l’écriture. Oui, les mots peuvent aussi transmettre les émotions.
En utilisant la seconde personne du singulier pour raconter cet épisode de sa vie, Carole Fives prend ses distances avec cette jeune artiste. Et si elle pose un regard attendri sur ce passé enfui, c’est d’abord pour souligner que c’est à ce moment-là, du côté de Lille, qu’est née une romancière. Pour notre plus grand plaisir !
Térébenthine
Carole Fives
Éditions Gallimard
Roman
176 p., 16,50 €
EAN 9782072869808
Paru le 20/08/2020
Où?
Le roman se déroule en France, principalement à Lille. On y évoque aussi New York et Paris.
Quand?
L’action se situe il y a une vingtaine d’années.
Ce qu’en dit l’éditeur
«Certains, ou plutôt devrais-je dire certaines, se sont étonnés du peu d’artistes femmes citées dans notre programme d’histoire de l’art. Je leur ai donné carte blanche aujourd’hui. Mesdemoiselles, c’est à vous!»
Quand la narratrice s’inscrit aux Beaux-Arts, au début des années 2000, la peinture est considérée comme morte. Les professeurs découragent les vocations, les galeries n’exposent plus de toiles.
Devenir peintre est pourtant son rêve. Celui aussi de Luc et Lucie, avec qui elle forme un groupe quasi clandestin dans les sous-sols de l’école. Un lieu de création en marge, en rupture.
Pendant ces années d’apprentissage, leur petit groupe affronte les humiliations et le mépris. L’avenir semble bouché. Mais quelque chose résiste, intensément.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Le littéraire (Jean-Paul Gavard-Perret)
INCIPIT (Les premières pages du livre)
Février 2004
Luc est debout devant sa toile, brosse à la main. Il prend du recul, s’avance, recule à nouveau… C’est un grand format, un lac immense dans une lumière froide. Une bande verticale à droite présente un motif plus abstrait, des cercles fluo, à intervalles réguliers.
Lucie et toi êtes assises à côté, sur un canapé de récup.
— T’en as pas marre, Luc, ça fait trois mois que tu bloques sur cette toile…
— Je n’arrive pas à terminer, il ne manque pas grand-chose mais ça ne tient pas… si seulement je savais ce que c’est…
— Et tu comptes y passer toute l’année ?
Luc s’assied sur son tabouret pivotant, ne lâche pas sa toile des yeux.
— C’est sûrement la partie gauche, c’est encore déséquilibré, je cherche, je cherche, c’est rageant, si près du but…
Lucie le coupe :
— T’as juste besoin de te changer les idées ! De sortir de cette cave !
— Laissez-moi encore quelques minutes…
Luc se relève, saisit un pot de pigment vermillon sur une étagère. Il verse un peu de son contenu dans l’assiette en plastique qui lui sert de palette.
Tu te caches les yeux derrière les mains : « Au secours, il va tout gâcher ! Je ne veux pas assister à ce massacre ! »
Lucie hausse les épaules : « Je ne vous comprends pas tous les deux, comment pouvez-vous continuer à peindre de façon si épidermique ! Comme si Duchamp n’était pas passé par là ! Plus personne ne peint depuis des siècles et vous vous obstinez ! C’est fini la peinture, mes potes, c’est mort ! »
— Ça va, j’ai beau être peintre, je pense à Duchamp, se défend Luc.
— Et ma chère Lucie, aux dernières nouvelles, ce n’est pas Duchamp qui a eu l’idée de faire entrer une pissotière dans un musée, c’est une blague de sa bonne copine Elsa…
— Elsa ?
— Elsa von Freytag-Loringhoven, pour vous servir !
— Pas facile à retenir, son nom.
— C’est pourtant elle qui a envoyé le bidet dans un salon de peinture, sous pseudo, comme le faisaient les femmes artistes à l’époque…
— C’était un urinoir, précise Lucie. Et puis il en a eu bien d’autres, des idées, Duchamp, le porte-bouteilles, la roue de vélo…
— Une roue de vélo sur un socle, ça fait toute la différence ! dit Luc.
Tu tentes de t’extraire du canapé :
— Quelle différence ?
— Elle devient sculpture…, marmonne Luc, à nouveau concentré sur sa toile.
Tu te lèves et t’approches de Luc :
— Eh bien moi je décide, mon petit Luc, qu’assis avec ton cul sur ton tabouret pivotant, tu es une œuvre d’art. Ça va, c’est pas trop inconfortable pour tes fesses, comme socle ? Je vais t’exposer pour mon diplôme ! Je te signe où ? Fesse gauche, fesse droite ?
— Très important, la signature, concède Lucie.
Luc grommelle :
— C’est idiot ces oppositions, nous sommes tous des conceptuels, des enfants de Cézanne. Peindre n’a jamais empêché personne de penser !
— De toute façon, la France c’est le pays de la littérature, pas de la peinture…
— Ici, on a peur des images…
— Waouh, on est des terroristes…
— Vous n’oubliez pas les impressionnistes quand même ?
— Les impressionnistes, c’est l’exception ! Ici, c’est le pays des Lumières, pas des impressions…
Luc lance un long « Putainnn… ».
Sur sa toile, le lac aux tonalités froides s’est transformé en bain de sang. Paniqué, Luc s’empare du premier chiffon qui lui tombe sous la main et tente d’absorber un maximum de pigment vermillon.
— C’est la cata !
— Mais non, Luc, ça donne la profondeur qui manquait à ta toile…
Lucie demande si elle peut prendre une bière dans le frigo.
— Quelle heure il est ?
— Déjà vingt heures…
— Dans ces caves, nuit/jour, jour/nuit, ça ne fait aucune différence…
— La bière, on la prendra dehors, allez ouste, on bouge avant que le gardien ne vienne nous virer d’ici…
— Un soir, on va se faire enfermer, avec les cafards et les rats crevés…
Pendant que chacun récupère sacs et vêtements, tu lances :
— Il paraît que l’école organise un voyage, vous étiez au courant ? Un voyage à New York !
— Oh putain, New York, the place to be ! dit Lucie.
— C’est Berlin, the place to be ! Enfin, New York, c’est un bon début…
Luc hausse les épaules :
— C’est 800 balles, leur voyage, moi, je les ai pas…
— Tu n’as pas encore touché la bourse ?
Luc nous montre les rouleaux de toiles et les châssis adossés au mur.
— Si, mais la bourse, j’en ai besoin pour vivre, tu vois, pas pour aller à New York! »
Extraits
« Six mois plus tôt
«PEINTURE ET RIPOLIN INTERDITS.» C’est ce qui est inscrit à la bombe, en lettres fluo, sur la façade du bâtiment.
Début des années 2000, à l’École des beaux-arts, on ne touche plus aux pinceaux ni aux pigments. Les étages ont été rénovés pour accueillir les ateliers vidéo, son et multimédia. Les éclaboussures de couleur et les odeurs de térébenthine ne sont plus tolérées, les ateliers de peinture, pour les derniers résistants, ont été déplacés aux sous-sols, dans les caves.
Mais tout ça, tu ne le sais pas encore. Toi, tu as dix-sept ans et tu rêves d’apprendre à dessiner, à peindre, à créer. En cette froide matinée d’avril, tu es venue passer le concours d’entrée des Beaux-Arts.
Autour de toi, des filles s’étreignent, s’embrassent, leurs sacs en jean débordent de tubes d’acrylique et de rouleaux de kraft.
— « Les Beaux-Arts ? Tu veux finir sous les ponts ? Ou sur le trottoir ? »
Un groupe de filles s’esclaffe, tandis qu’une autre leur rejoue la scène familiale.
— Bref, mon père m’a coupé les vivres, j’ai dû prendre un job de serveuse… sinon j’allais m’y retrouver plus vite que prévu, sous les ponts…
Un peu plus loin, des garçons vêtus de bombers sombres tirent sur des roulées, les yeux mi-clos.
Tu te sens ridicule avec tes Kickers mauves et ton immense carton à dessin Canson vert, moucheté de noir. Jusqu’ici, lorsque tu te rendais à la seule boutique spécialisée beaux-arts de la ville, tu ne croisais que des retraités. Tu comparais longuement le prix et le grammage des papiers tandis que dans le rayon d’à côté, une sexagénaire devisait gaiement aquarelle et pastel avec le vendeur.
Enfin, on vous fait entrer dans l’école et on vérifie vos cartes d’identité. L’épreuve pratique du concours consiste à « Produire une réalisation plastique à partir d’une œuvre ». On vous distribue un document imprimé en couleurs, un portrait d’enfant déguisé. Le titre est précisé en bas de la feuille, Paul en Arlequin, ainsi que le nom de Picasso, pour ceux qui, comme toi, n’auraient pas reconnu le génie du cubisme dans sa période dite classique.
Le tableau semble loin d’être terminé. Certains éléments sont juste esquissés, le fond est resté brut, laissant la toile apparente. Tu restes indécise devant cette image, Picasso a-t-il choisi de la laisser inachevée ou n’a-t-il simplement pas eu le temps de la finir, se désintéressant soudainement de son modèle pour une passionnante séance de tauromachie ? À moins que la guerre n’ait éclaté alors qu’il s’apprêtait à peindre le reste et qu’il ait préféré se lancer dans Guernica ? Mais n’y a-t-il pas là une question que tout artiste se pose, comment décide-t-on qu’une œuvre est enfin terminée ? Quand sait-on qu’on a posé l’ultime touche ?
Autour de toi, ça s’agite, ça rougit, ça transpire. Les candidats ont extrait moult matériaux de leurs cabas, du polystyrène et du carton, des morceaux de bois ou des pelotes de laine, des bouteilles vides ou du coton hydrophile… Il s’agit maintenant d’assembler ce beau bordel et de produire quelque chose qui ressemble à une sculpture.
À côté de toi, une fille en salopette bleue a crayonné sur un lé de papier peint une silhouette humaine éventrée. Elle s’applique maintenant à scotcher des bandes stériles dégoulinant d’encre rouge.
Tu n’as misé que sur tes fusains et tes couleurs pour t’exprimer. Tu observes une dernière fois la reproduction du Picasso et tu te lances dans une composition plus qu’aléatoire à partir du chapeau d’Arlequin. Il vous reste deux heures, pensez à mettre vos noms afin que le jury puisse identifier votre travail.
Tu souris à la fille en salopette, peut-être vous retrouverez-vous en septembre?»
« Comment peindre après la mort de l’art, après la barbarie, comment créer à l’ère du soupçon? Dans le sous-sol des Beaux-Arts, vous vous questionnez, vous vous disputez, vous vous influencez parfois mais vous savez qu’une seule chose compte: la nécessité de continuer, quoi qu’en pensent les enseignants de l’école.
Vous partez d’images de récupération, des revues, des journaux. Luc choisit des paysages qu’il trouve dans les catalogues de voyages et en fait disparaître les figures humaines, les textes, les prix. Il les vide de leur contenu, les épuise, jusqu’à leur réinsuffler une vision plus personnelle. Quant à toi, tu t’inspires de journaux dont tu reproduis aléatoirement les compositions. Tu mélanges des visages de stars à des portraits d’inconnus, des top-models et des photos des rubriques nécrologiques, des enfants du tiers-monde et des bébés grassouillets.
Les images extraites de la pub, de la télé ou d’ailleurs sont surtout un prétexte à peindre, encore et toujours, à chercher à digérer le monde, à le comprendre.
Loin d’être un espace de liberté absolue, la toile est ce lieu où un geste en impose un autre, puis un autre, et où enfin le chaos s’ordonne. C’est un dialogue silencieux, tu te confies et la toile te répond, les échanges s‘intensifient, jusqu’à ce que tu la gifles de tes coups de pinceau, de tes coups de raclette. La toile résiste et t’apprend que seule tu ne peux rien, qu’entre elle et toi il va falloir trouver un accord, même précaire, même fragile.
Parfois les pinceaux tombent, la distance s’abolit, et c’est le corps-à-corps, le peau-à-peau: la toile a tant à offrir. » p. 33-34
« Tu découvres d’autres artistes femmes. Les critiques ont beau dire que l’art n’a pas de sexe, tu sens qu’ils manquent d’objectivité et que le but est bien plutôt de faire passer pour neutre une histoire de l’art toute empreinte de virilité. Après une absolue domination du regard masculin pendant des siècles, les femmes artistes peinent à s’exprimer, à simplement oser prendre le pinceau, la caméra, le stylo, mais quand elles le font, c’est l’explosion. Cindy Sherman. Martha Rosler. Laurie Anderson. Louise Bourgeois. Jenny Saville. Barbara Kruger. Marlene Dumas. Annette Messager. Joan Mitchell. Kiki Smith. Yoko Ono. Geneviève Asse. Sarah Moon. Adrian Piper. Katharina Grosse. Vanessa Beecroft. Mona Hatoum. Ghada Amer. Judy Chicago. Elaine de Kooning. Frida Kahlo. Valérie Belin. Dorothea Lange. Tamara de Lempicka. Rachel Whiteread. Tatiana Trouvé. Suzanne Valadon. Chantal Akerman. Françoise Vergieli. Agnès Varda. Gina Pane. Eva Hesse. Marie Laurencin. Maria Helena Vieira da Silva. Wanda Gág. Sarah Lucas. Elizabeth Peyton. Agnès Martin. Mary Ellen Mark. Seton Smith. Nancy Spero. Valérie Jouve. Louise Lawler. Lisette Model. Martine Aballéa. Jana Sterbak. Rebecca Horn. Shirley jaffe. Claude Cahun. Carole Benzaken. Sally Mann. Elizabeth Lee Miller. Sylvie Blocher. Diane Arbus. Laura Owens. Rosa Bonheur. Françoise Huguier. Annie Leibovitz. Eija-Liisa Ahtila. Martine Franck. Helen Levin. Susan Rothenberg. Jane Atwood. Aurélie Nemours. Agnès Thurnauer. Alice Neel. Rosemarie Trockel. Magdalena Abakanowicz. Francesca Woodman. Barbara Morgan. Gertrud Arndt. Judith Rothchild. Anne-Marie Schneider. Berenice Abbott. Eva Aeppli. Mariko Mori. Camille Claudel. Yayoi Kusama. Sophie Ristelhueber. Bettina Rheims. Carla Accardi. Emily Carr. Sarah Morris. Germaine Richier. Claudine Doury. Dora Maar. Suzanne Lafont. Narie-ange Guilleminot. Sylvie Fleury. Julie Mehretu. Orlan. Sophie Calle. Meret Oppenheim. Guerrilla Girls. Dora Maurer. Niki de Saint Phalle. Charlotte Perriand. Tania Mouraud. Susan Hiller. Valérie Favre. Pipilotti Rist. Rineke Dijkstra. Jenny Holzer. Helen Frankenthaler. Gloria Friedmann. » p. 46-47
« Avec Dimitri, tu apprendras à dessiner des bouquets de fleurs, des vases, des pommes, des poires blettes, des carafons, des grappes de raisin, des mains ouvertes, des poings fermés, des raccourcis, des drapés, des plongées, des contre-plongées, des trompe-l’œil, des anamorphoses…
Avec Dimitri, tu apprendras à donner du plaisir sans jamais en recevoir. Dimitri fait l’amour comme s’il faisait des pompes à la salle de sport, il se tient au-dessus de toi, le buste détaché, les yeux fermés, à jamais inaccessible. Il est loin, très loin, au Tatarstan, avec Olga peut-être? Très vite tu comprends qu’il comble l’absence d’Olga avec de nombreuses autres femmes, modèles ou élèves. Et très vite tu te détournes de lui et de ses enseignements. De ses portraits de femme si idéalisés, si esthétisants, de son rapport au sexe si désincarné.
En comparaison avec les œuvres que tu vois à Beaubourg, peintes cinquante ans plus tôt, les sujets des toiles de Dimitri t’apparaissent totalement datés. Des nus féminins, toujours des nus, mais qui peut encore voir ça en peinture? Des madones, des Vierges à l’enfant, des déesses, des saintes, il y en a déjà plein les musées, au Louvre, au Musée d’art moderne, au British Museum, l’histoire de l’art en est remplie, jusqu’à saturation… » p. 51
« Dix jours plus tard, ton installation est prête. Il s’agit de poupées gonflables chaussées de lunettes, lisant Emmanuel Kant. Critique de la faculté de juger, plus précisément, ce texte qui parle du jugement de goût et d’esthétique. Tu as récupéré une table bistrot chez ton père et confortablement installé les poupées sur des chaises hautes. Elles sont rhabillées pour l’occasion, et sous les pulls et les jeans dont tu les as revêtues on ne distingue plus trop leur handicap.
Les enseignants n’en reviennent pas. Quelle bonne surprise! En voilà une force de proposition! Qui questionne la sculpture, le masculin/féminin, c’est vraiment passionnant. Et quel en est le titre? Poupées regonflées, tout simplement! Tu rassures les enseignants, non, non, ce n’est pas une œuvre féministe, il ne s’agit pas de libérer la femme mais simplement de rhabiller les poupées gonflables. Tout le monde se réjouit de voir que tu es enfin passée à des pratiques plus réfléchies que la peinture, on t’encourage à te documenter sur le mouvement Dada, on te promet un cours à venir sur cette vieille avant-garde, car oui, c’est la bonne nouvelle, malgré ton année au sous-sol, à fréquenter les rats et les damnés de la terre, tu es admise en deuxième année. » p. 57-58
« Quelques mètres plus loin, ton père s’arrête à nouveau devant une accumulation de préservatifs masculins suspendus sur des fils à linge. «Qu’est-ce que c’est que cette horreur?» Vous vous approchez, les capotes sont remplies d’encres colorées. Tu lis le cartel à voix haute, «Séropositif/Éros Positif».
Vous arrivez devant ton installation:
– Voilà, c’est mon travail… enfin, ce que j’ai fait pour l’examen, mais je préférerais qu’on descende voir mes peintures, elles sont dans mon atelier et…
Le gobelet de jus de pomme a glissé des mains de ton père, qui balbutie:
– Mais c’est pas croyable, ce genre de poupées, ce sont, ce sont… ! Ce n’est pas une école ici, c’est un asile de fous! » p. 59
« Tout en écrasant un mégot dans son cendrier de poche, Véra Mornay fait mine de regarder tes toiles. Véra n’est pas ta tutrice mais elle reste la prof de pratique artistique, c’est toujours elle qui sévit dans les ateliers. Elle te demande de t’expliquer. Quel est le sens de ces portraits, de ces figures? Pourquoi dansent-ils? Pourquoi sont-ils vêtus, pourquoi avoir utilisé du vermillon, du bleu, du blanc de Meudon? Pourquoi une série, pourquoi la peinture plutôt que la sculpture, pourquoi quelque chose plutôt que rien?
Tu alignes les phrases, tu te justifies, tu tentes une argumentation.
Elle te coupe.
«Vous n’êtes pas totalement bête.»
Elle insiste: «Je vous crois même plutôt intelligente.»
Tu l’attends au tournant. Tu sais qui elle est. Véra Mornay et sa réputation qui la précède, sa réputation qui est arrivée jusque dans les caves. Elle n’est sûrement pas venue là pour te complimenter. Elle a déjà détruit des centaines de vocations, poussé des étudiants au suicide. Tu inspires, te concentres sur tes baskets, la pointe blanche de tes baskets, comme une collégienne prise en faute.
Tu sais que le coup va porter, tu ne sais pas quand mais Véra Mornay est devant toi et son rôle dans l’école est clair: te briser.
Faire place nette.
Que tout un chacun ne se croie pas artiste.
Il n’y aura pas de place pour tout le monde.
Il y en a déjà peu pour les artistes femmes, comme elle.
Véra Mornay peine à exister sur la scène artistique française.
La preuve, elle se voit obligée de parcourir plus de 500 kilomètres aller-retour en train de Paris chaque semaine pour venir faire la prof.
Paris-province.
De la confiture aux cochons. 500 kilomètres aller-retour pour voir vos croûtes.
Qu‘elle fixe avec une mine dégoûtée.
Tu te prépares à esquiver les coups.
«Bon, vous n‘êtes pas bête. vous ne voulez pas faire autre chose que de la peinture?»
Ça y est, c‘était ça! C‘était juste ça!
Tu te détends.
Elle reprend
«Vous savez, un bon peintre est un peintre mort,»
Elle rit de son bon mot.
«Et ce mémoire, il avance, il en est où?»
Tu bredouilles, tu as du mal avec ça, c’est compliqué pour toi d’être à la fois actrice et spectatrice de ton travail, tu préfères laisser ça aux critiques. » p. 112-113
À propos de l’auteur

Carole Fives © Photo Francesca Mantovani
Carole Fives est l’autrice de sept livres, parmi lesquels Une femme au téléphone et Tenir jusqu’à l’aube dans la collection «L’Arbalète». (Source: Éditions Gallimard)
Site internet de l’auteur
Page Wikipédia de l’auteur
Compte Twitter de l’auteur
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
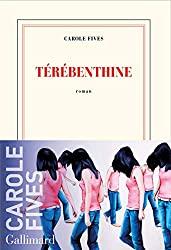



Tags:

