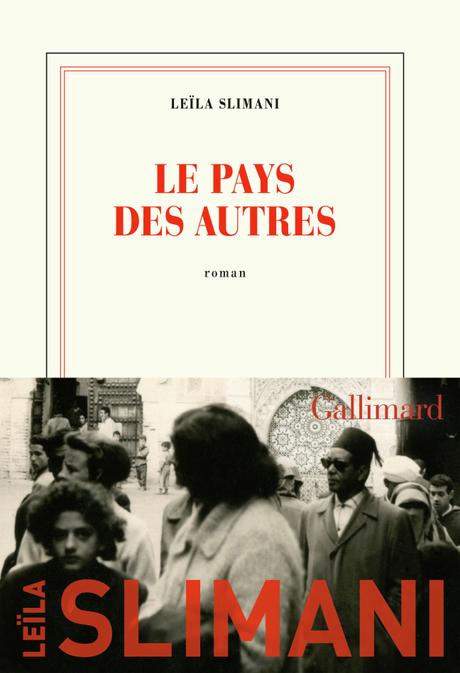

En deux mots:
Durant la Seconde guerre mondiale, Amine rencontre Mathilde du côté de Mulhouse. Le Marocain et l’Alsacienne vont s’aimer et se marier avant de s’installer du côté de Meknès. Dans «le pays des autres», Mathilde va devoir s’adapter, même si sa soif de liberté reste entière.
Ma note:
★★★ (bien aimé)
Ma chronique:
Mathilde, de Mulhouse à Meknès
Dans ce premier volet d’une trilogie explorant ses racines familiales, Leïla Slimani retrace la rencontre de ses grands-parents et leur installation au Maroc. Cette chronique douce-amère va nous conduite jusqu’en 1955.
Une image symbolise ce beau roman, celui du citrange, de cet oranger sur lequel on a greffé une branche de citronnier, qui donne des fruits immangeables. «Leur pulpe était sèche et leur goût si amer que cela faisait monter les larmes aux yeux». Car dans ce livre il en va des hommes comme de la botanique: «A la fin, une espèce prenait le pas sur l’autre et un jour l’orange aurait raison du citron ou l’inverse et l’arbre redonnerait enfin des fruits comestibles.» Dans «Le pays des autres», dans cette France qui n’est pas le pays d’Amine, dans ce Maroc qui n’est pas le pays de Mathilde toute la question est de savoir qui prendra le pas sur l’autre.
Tout commence avec la Seconde Guerre mondiale quand Amine, qui défend la patrie du pays qui exerce son protectorat sur son Maroc natal, rencontre Mathilde du côté de Mulhouse. Elle n’avait pas vingt ans, mais de «grands yeux ravis et surpris de tout, sa voix encore fragile, sa langue tiède et douce comme celle d’une petite fille». Il avait vingt-huit ans, il était «tellement beau qu’elle avait peur qu’on le lui prenne». Très vite, ils se marient et très vite elle décide de suivre son mari au Maroc, sorte de pays de cocagne où la fortune sourit aux audacieux. Du moins, c’est ce que le jeune couple veut croire. Mais dès le pays posé de l’autre côté de la Méditerranée, il leur faut déchanter. Quand Amine lui explique qu’en attendant d’avoir construit son domaine, il leur faudrait vivre chez sa mère, elle veut croire à une plaisanterie, avant de comprendre qu’au Maroc, c’est comme ça. «Cette phrase, elle l’entendrait souvent. À cet instant précis, elle comprit qu’elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. Amine était sur son territoire à présent, c’était lui qui expliquait les règles, qui disait la marche à suivre, qui traçait les frontières de la pudeur, de la honte et de la bienséance.»
Aux premières difficultés viennent se joindre les déconvenues économiques. Si Amine est un bourreau de travail, son domaine est loin d’être fructueux. Il tâtonne, il cherche quelles cultures s’adaptent le mieux au climat et à la rocaille. «Pendant les quatre premières années à la ferme, ils allaient connaître toutes les déconvenues, et leur vie prendre des accents de récit biblique». Leurs beaux rêves se dissolvent dans les difficultés, le poids de la famille et notamment les regards méprisants du beau-frère, gardien des traditions. La place de Mathilde est auprès des femmes et auprès de ses enfants Aïcha et Selim.
L’Alsacienne a beau assurer à sa sœur Irène qu’elle vit un rêve, ses lettres cachent de plus en plus mal son mal-être. Pourtant, elle se bat, décide de suivre son mari quand il sort. «C’est ainsi, je viens avec.» Ce qui ne fait qu’augmenter la méfiance des marocains et renforcer la méfiance vis-à-vis de ce couple très particulier. Fort heureusement, Mathilde trouve quelques alliés, à commencer par sa belle-sœur Selma, dont elle va faire sa meilleure amie. Dragan, le médecin, la secondera aussi dans son ambition de soulager les maux des malades dans son «dispensaire», lui apportant des rudiments de médecine.
Dans ce premier volume de ce qui est annoncé comme une trilogie, Leïla Slimani n’occulte rien non des troubles qui agitent le pays et qui vont déchirer la famille Belhaj. Omar, le frère d’Amine prenant fait et cause pour les nationalistes: «Il n’y a plus que les armes qui permettront de libérer ce pays».
C’est dans ce climat insurrectionnel que Mathilde va perdre son père et ses illusions. Mais aussi vouloir transmettre à ses enfants des valeurs et des idées qui leur permettront de marcher la tête haute. Gageons que le prochain épisode sera celui de l’indépendance, et pas uniquement d’un pays. En attendant ne boudons pas notre plaisir à découvrir une autre facette du talent de Leïla Slimani avec cette plongée dans sa généalogie.
Le pays des autres
Leïla Slimani
Éditions Gallimard
Roman
368 p., 21,90 €
EAN 9782072887994
Paru le 5/03/2020
Où?
Le roman se déroule principalement au Maroc, à Meknès mais aussi à Fès ou encore Rabat ainsi qu’en France, à Mulhouse et environs.
Quand?
L’action se situe de la Seconde Guerre mondiale à1955.
Ce qu’en dit l’éditeur
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire en tant qu’étrangère et du manque d’argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits? Les dix années que couvre le roman sont aussi celles d’une montée inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront en 1956 à l’indépendance de l’ancien protectorat.
Tous les personnages de ce roman vivent dans «le pays des autres» : les colons comme les indigènes, les soldats comme les paysans ou les exilés. Les femmes, surtout, vivent dans le pays des hommes et doivent sans cesse lutter pour leur émancipation. Après deux romans au style clinique et acéré, Leïla Slimani, dans cette grande fresque, fait revivre une époque et ses acteurs avec humanité, justesse, et un sens très subtil de la narration.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
France TV info (Laurence Houot)
La Presse (Nathalie Collard)
La Montagne (Rémi Bonnet)
Le Temps (Lisbeth Koutchoumoff Arman)
Culture-Tops (Anne-Marie Joire-Noulens)
We culte (Serge Bressan)
Jeune Afrique (Mabrouck Rachedi)
Blog Carobookine
Blog Mes petites chroniques littéraires
Leïla Slimani présente Le pays des autres à La Grande Librairie © Production France Télévisions
INCIPIT (Le premier chapitre du livre)
La première fois que Mathilde visita la ferme, elle pensa : « C’est trop loin. » Un tel isolement l’inquiétait. À l’époque, en 1947, ils ne possédaient pas de voiture et ils avaient parcouru les vingt-cinq kilomètres qui les séparaient de Meknès sur une vieille trotteuse, conduite par un Gitan. Amine ne prêtait pas attention à l’inconfort du banc en bois ni à la poussière qui faisait tousser sa femme. Il n’avait d’yeux que pour le paysage et il se montrait impatient d’arriver sur les terres que son père lui avait confiées.
En 1935, après des années de labeur comme traducteur dans l’armée coloniale, Kadour Belhaj avait acheté ces hectares de terres couvertes de rocaille. Il avait raconté à son fils son espoir d’en faire une exploitation florissante qui pourrait nourrir des générations d’enfants Belhaj. Amine se souvenait du regard de son père, de sa voix qui ne tremblait pas quand il exposait ses projets pour la ferme. Des arpents de vignes, lui avait-il expliqué, et des hectares entiers dévolus aux céréales. Sur la partie la plus ensoleillée de la colline, il faudrait construire une maison, entourée d’arbres fruitiers et de quelques allées d’amandiers. Kadour était fier soit à lui. « Notre terre ! » Il prononçait ces mots non pas à la manière des nationalistes ou des colons, au nom de principes moraux ou d’un idéal, mais comme un propriétaire heureux de son bon droit. Le vieux Belhaj voulait être enterré ici et qu’y soient enterrés ses enfants, que cette terre le nourrisse et qu’elle abrite sa dernière demeure. Mais il mourut en 1939, alors que son fils s’était engagé dans le régiment des spahis et portait fièrement le burnous et le sarouel. Avant de partir sur le front, Amine, fils aîné et désormais chef de famille, loua le domaine à un Français originaire d’Algérie.
Quand Mathilde demanda de quoi était mort ce beau-père qu’elle n’avait pas connu, Amine toucha son estomac et il hocha la tête en silence. Plus tard, Mathilde apprit ce qui était arrivé. Kadour Belhaj souffrait, depuis son retour de Verdun, de maux de ventre chroniques, et aucun guérisseur marocain ou européen n’était parvenu à le soulager. Lui qui se vantait d’être un homme de raison, fier de son éducation et de son talent pour les langues étrangères, s’était traîné, honteux et désespéré, dans le sous-sol qu’occupait une chouafa. La sorcière avait tenté de le convaincre qu’il était envoûté, qu’on lui en voulait et que cette douleur était le fait d’un ennemi redoutable. Elle lui avait tendu une feuille de papier pliée en quatre qui contenait une poudre jaune safran. Le soir même, il avait bu le remède dilué dans de l’eau et il était mort en quelques heures, dans des souffrances atroces. La famille n’aimait pas en parler. On avait honte de la naïveté du père et des circonstances de son décès car le vénérable officier s’était vidé dans le patio de la maison, sa djellaba blanche trempée de merde.
En ce jour d’avril 1947, Amine sourit à Mathilde et il pressa le cocher, qui frottait ses pieds sales et nus l’un contre l’autre. Le paysan fouetta la mule avec plus de vigueur et Mathilde sursauta. La violence du Gitan la révoltait. Il faisait claquer sa langue, « Ra », et il abattait son fouet contre la croupe squelettique de la bête. C’était le printemps et Mathilde était enceinte de deux mois. Les champs étaient couverts de soucis, de mauves et de bourrache. Un vent frais agitait les tiges des tournesols. De chaque côté de la route se trouvaient les propriétés de colons français, installés ici depuis vingt ou trente ans et dont les plantations s’étendaient en pente douce, jusqu’à l’horizon. La plupart venaient d’Algérie et les autorités leur avaient octroyé les meilleures terres et les plus grandes superficies. Amine tendit un bras et il mit son autre main en visière au-dessus de ses yeux pour se protéger du soleil de midi et contempler la vaste étendue qui s’offrait à lui. De l’index, il montra à sa femme une allée de cyprès qui ceignait la propriété de Roger Mariani qui avait fait fortune dans le vin et l’élevage de porcs. Depuis la route, on ne pouvait pas voir la maison de maître ni même les arpents de vignes. Mais Mathilde n’avait aucun mal à imaginer la richesse de ce paysan, richesse qui la remplissait d’espoir sur son propre sort. Le paysage, d’une beauté sereine, lui rappelait une gravure accrochée au-dessus du piano, chez son professeur de musique à Mulhouse. Elle se souvint des explications de celui-ci : « C’est en Toscane, mademoiselle. Un jour peut-être irez-vous en Italie. »
La mule s’arrêta et se mit à brouter l’herbe qui poussait sur le bord du chemin. Elle n’avait aucune intention de gravir la pente qui leur faisait face et qui était couverte de grosses pierres blanches. Furieux, le cocher se redressa et il agonit la bête d’insultes et de coups. Mathilde sentit les larmes monter à ses paupières. Elle essaya de se retenir, elle se colla contre son mari qui trouva sa tendresse déplacée.
« Qu’est-ce que tu as ? demanda Amine.
— Dis-lui d’arrêter de frapper cette pauvre mule. »
Mathilde posa sa main sur l’épaule du Gitan et elle le regarda, comme un enfant qui cherche à amadouer un parent furieux. Mais le cocher redoubla de violence. Il cracha par terre, leva le bras et dit : « Tu veux tâter du fouet toi aussi ? »
L’humeur changea et aussi le paysage. Ils arrivèrent au sommet d’une colline aux flancs râpés. Plus de fleurs, plus de cyprès, à peine quelques oliviers qui survivaient au milieu de la rocaille. Une impression de stérilité se dégageait de cette colline. On n’était plus en Toscane, pensa Mathilde, mais au far west. Ils descendirent de la carriole et ils marchèrent jusqu’à une petite bâtisse blanche et sans charme, dont le toit consistait en un vulgaire morceau de tôle. Ce n’était pas une maison, mais une sommaire enfilade de pièces de petite taille, sombres et humides. L’unique fenêtre, placée très haut pour se protéger des invasions de nuisibles, laissait pénétrer une faible lumière. Sur les murs, Mathilde remarqua de larges auréoles verdâtres provoquées par les dernières pluies. L’ancien locataire vivait seul ; sa femme était rentrée à Nîmes après avoir perdu un enfant et il n’avait jamais songé à faire de ce bâtiment un endroit chaleureux, susceptible d’accueillir une famille. Mathilde, malgré la douceur de l’air, se sentit glacée. Les projets qu’Amine lui exposait la remplissaient d’inquiétude.
*
Le même désarroi l’avait saisie quand elle avait atterri à Rabat, le 1er mars 1946. Malgré le ciel désespérément bleu, malgré la joie de retrouver son mari et la fierté d’avoir échappé à son destin, elle avait eu peur. Elle avait voyagé pendant deux jours. De Strasbourg à Paris, de Paris à Marseille puis de Marseille à Alger, où elle avait embarqué dans un vieux Junkers et avait cru mourir. Assise sur un banc inconfortable, au milieu d’hommes aux regards fatigués par les années de guerre, elle avait eu du mal à retenir ses cris. Pendant le vol, elle pleura, elle vomit, elle pria Dieu. Dans sa bouche se mêlèrent le goût de la bile et celui du sel. Elle était triste, non pas tant de mourir au-dessus de l’Afrique, mais à l’idée d’apparaître sur le quai où l’attendait l’homme de sa vie dans une robe fripée et maculée de vomi. Finalement elle atterrit saine et sauve et Amine était là, plus beau que jamais, sous ce ciel d’un bleu si profond qu’on aurait dit qu’il avait été lavé à grande eau. Son mari l’embrassa sur les joues, attentif aux regards des autres passagers. Il lui saisit le bras droit d’une façon qui était à la fois sensuelle et menaçante. Il semblait vouloir la contrôler.
Ils prirent un taxi et Mathilde se serra contre le corps d’Amine qu’elle sentait, enfin, tendu de désir, affamé d’elle. « Nous allons dormir à l’hôtel ce soir », annonça-t-il à l’adresse du chauffeur et, comme s’il voulait prouver sa moralité, il ajouta : « C’est ma femme. Nous venons de nous retrouver. » Rabat était une petite ville, blanche et solaire, dont l’élégance surprit Mathilde. Elle contempla avec ravissement les façades art déco des immeubles du centre et elle colla son nez contre la vitre pour mieux voir les jolies femmes qui descendaient le cours Lyautey, leurs gants assortis à leurs chaussures et à leur chapeau. Partout, des travaux, des immeubles en chantier devant lesquels des hommes en haillons venaient demander du travail. Là des bonnes sœurs marchaient à côté de deux paysannes, portant sur leur dos des fagots. Une petite fille, à qui l’on avait coupé les cheveux à la garçonne, riait sur un âne qu’un homme noir tirait. Pour la première fois de sa vie, Mathilde respirait le vent salé de l’Atlantique. La lumière faiblit, gagna en rose et en velouté. Elle avait sommeil et elle s’apprêtait à poser sa tête sur l’épaule de son mari quand celui-ci annonça qu’on était arrivés.
Ils ne sortirent pas de la chambre pendant deux jours. Elle, qui était pourtant si curieuse des autres et du dehors, refusa d’ouvrir les volets. Elle ne se lassait pas des mains d’Amine, de sa bouche, de l’odeur de sa peau, qui, elle le comprenait maintenant, avait à voir avec l’air de ce pays. Il exerçait sur elle un véritable envoûtement et elle le suppliait de rester en elle aussi longtemps que possible, même pour dormir, même pour parler.
La mère de Mathilde disait que c’était la souffrance et la honte qui ravivaient le souvenir de notre condition d’animal. Mais jamais on ne lui avait parlé de ce plaisir-là. Pendant la guerre, les soirs de désolation et de tristesse, Mathilde se faisait jouir dans le lit glacé de sa chambre, à l’étage. Lorsque retentissait l’alarme qui annonçait les bombes, quand commençait à se faire entendre le vrombissement d’un avion, Mathilde courait, non pas pour sa survie, mais pour assouvir son désir. À chaque fois qu’elle avait peur, elle montait dans sa chambre dont la porte ne fermait pas mais elle se fichait bien que quelqu’un la surprenne. De toute façon les autres aimaient rester groupés dans les trous ou dans les sous-sols, ils voulaient mourir ensemble, comme des bêtes. Elle s’allongeait sur son lit, et jouir était le seul moyen de calmer la peur, de la contrôler, de prendre le pouvoir sur la guerre. Allongée sur les draps sales, elle pensait aux hommes qui partout traversaient des plaines, armés de fusils, des hommes privés de femmes comme elle était privée d’homme. Et tandis qu’elle appuyait sur son sexe, elle se figurait l’immensité de ce désir inassouvi, cette faim d’amour et de possession qui avait saisi la terre entière. L’idée de cette lubricité infinie la plongeait dans un état d’extase. Elle jetait la tête en arrière et, les yeux révulsés, elle imaginait des légions d’hommes venir à elle, la prendre, la remercier. Pour elle, peur et plaisir se confondaient et dans les moments de danger, sa première pensée était toujours celle-là.
Au bout de deux jours et deux nuits, Amine dut presque la tirer du lit, mort de soif et de faim, pour qu’elle accepte de s’attabler à la terrasse de l’hôtel. Et là encore, tandis que le vin lui réchauffait le cœur, elle pensait à la place qu’Amine, bientôt, reviendrait combler entre ses cuisses. Mais son mari avait pris un air sérieux. Il dévora la moitié d’un poulet avec les mains et voulut parler d’avenir. Il ne remonta pas avec elle dans la chambre et s’offusqua qu’elle lui propose une sieste. Plusieurs fois, il s’absenta pour passer des coups de téléphone. Quand elle lui demanda à qui il avait parlé et quand ils quitteraient Rabat et l’hôtel, il se montra très vague. « Tout ira très bien, lui disait-il. Je vais tout arranger. »
Au bout d’une semaine, alors que Mathilde avait passé l’après-midi seule, il rentra dans la chambre, nerveux, contrarié. Mathilde le couvrit de caresses, elle s’assit sur ses genoux. Il trempa ses lèvres dans le verre de bière qu’elle lui avait servi et il dit : « J’ai une mauvaise nouvelle. Nous devons attendre quelques mois avant de nous installer sur notre propriété. J’ai parlé au locataire et il refuse de quitter la ferme avant la fin du bail. J’ai essayé de trouver un appartement à Meknès, mais il y a encore beaucoup de réfugiés et rien à louer pour un prix raisonnable. » Mathilde était désemparée.
« Et que ferons-nous alors ?
— Nous allons vivre chez ma mère en attendant. »
Mathilde sauta sur ses pieds et elle se mit à rire.
« Tu n’es pas sérieux ? » Elle avait l’air de trouver la situation ridicule, hilarante. Comment un homme comme Amine, un homme capable de la posséder comme il l’avait fait cette nuit, pouvait-il lui faire croire qu’ils allaient vivre chez sa mère ?
Mais Amine ne goûta pas la plaisanterie. Il resta assis, pour ne pas avoir à subir la différence de taille entre sa femme et lui. D’une voix glacée, les yeux fixés sur le sol en granito, il affirma :
« Ici, c’est comme ça. »
Cette phrase, elle l’entendrait souvent. À cet instant précis, elle comprit qu’elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. Amine était sur son territoire à présent, c’était lui qui expliquait les règles, qui disait la marche à suivre, qui traçait les frontières de la pudeur, de la honte et de la bienséance. En Alsace, pendant la guerre, il était un étranger, un homme de passage qui devait se faire discret. Lorsqu’elle l’avait rencontré durant l’automne 1944 elle lui avait servi de guide et de protectrice. Le régiment d’Amine était stationné dans son bourg à quelques kilomètres de Mulhouse et ils avaient dû attendre pendant des jours des ordres pour avancer vers l’est. De toutes les filles qui encerclèrent la Jeep le jour de leur arrivée, Mathilde était la plus grande. Elle avait des épaules larges et des mollets de jeune garçon. Son regard était vert comme l’eau des fontaines de Meknès, et elle ne quitta pas Amine des yeux. Pendant la longue semaine qu’il passa au village, elle l’accompagna en promenade, elle lui présenta ses amis et elle lui apprit des jeux de cartes. Il faisait bien une tête de moins qu’elle et il avait la peau la plus sombre qu’on puisse imaginer. Il était tellement beau qu’elle avait peur qu’on le lui prenne. Peur qu’il soit une illusion. Jamais elle n’avait ressenti ça. Ni avec le professeur de piano quand elle avait quatorze ans. Ni avec son cousin Alain qui mettait sa main sous sa robe et volait pour elle des cerises au bord du Rhin. Mais arrivée ici, sur sa terre à lui, elle se sentit démunie.
*
Trois jours plus tard, ils montèrent dans un camion dont le chauffeur avait accepté de les conduire jusqu’à Meknès. Mathilde était incommodée par l’odeur du routier et par le mauvais état de la route. Deux fois, ils s’arrêtèrent au bord du fossé pour qu’elle puisse vomir. Pâle et épuisée, les yeux fixés sur un paysage auquel elle ne trouvait ni sens ni beauté, Mathilde fut submergée par la mélancolie. « Faites, se dit-elle, que ce pays ne me soit pas hostile. Ce monde me sera-t-il un jour familier ? » Quand ils arrivèrent à Meknès, la nuit était tombée et une pluie drue et glacée s’abattait contre le pare-brise du camion. « Il est trop tard pour te présenter ma mère, expliqua Amine. Nous dormons à l’hôtel. »
La ville lui parut noire et hostile. Amine lui en expliqua la topographie qui répondait aux principes émis par le maréchal Lyautey au début du protectorat. Une séparation stricte entre la médina, dont les mœurs ancestrales devaient être préservées, et la ville européenne, dont les rues portaient des noms de villes françaises et qui se voulait un laboratoire de la modernité. Le camion les déposa en contrebas, sur la rive gauche de l’oued Boufakrane, à l’entrée de la ville indigène. La famille d’Amine y vivait, dans le quartier de Berrima, juste en face du mellah. Ils prirent un taxi pour se rendre de l’autre côté du fleuve. Ils empruntèrent une longue route en montée, longèrent des terrains de sport et traversèrent une sorte de zone tampon, un no man’s land qui séparait la ville en deux et où il était interdit de construire. Amine lui indiqua le camp Poublan, base militaire qui surplombait la ville arabe et en surveillait les moindres soubresauts.
Ils s’installèrent dans un hôtel convenable et le réceptionniste examina, avec des précautions de fonctionnaire, leurs papiers et leur acte de mariage. Dans l’escalier qui les menait à leur chambre, une dispute faillit éclater car le garçon d’étage s’obstinait à parler en arabe à Amine qui s’adressait à lui en français. L’adolescent jeta à Mathilde des regards équivoques. Lui qui devait fournir aux autorités un petit papier pour prouver qu’il avait le droit, la nuit, de marcher dans les rues de la ville nouvelle en voulait à Amine de coucher avec l’ennemie et de circuler en liberté. À peine eurent-ils déposé leurs bagages dans leur chambre, qu’Amine remit son manteau et son chapeau. « Je vais saluer ma famille. Je ne tarderai pas. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre, claqua la porte et elle l’entendit courir dans l’escalier.
Mathilde s’assit sur le lit, ses jambes ramenées contre son torse. Que faisait-elle ici ? Elle ne pouvait s’en prendre qu’à elle-même et à sa vanité. C’est elle qui avait voulu vivre l’aventure, qui s’était embarquée, bravache, dans ce mariage dont ses amies d’enfance enviaient l’exotisme. À présent, elle pouvait être l’objet de n’importe quelle moquerie, de n’importe quelle trahison. Peut-être Amine avait-il rejoint une maîtresse ? Peut-être même était-il marié, puisque, comme son père le lui avait dit avec une moue gênée, les hommes ici étaient polygames ? Il jouait peut-être aux cartes dans un bistrot à quelques pas d’ici, se réjouissant devant ses amis d’avoir faussé compagnie à sa pesante épouse. Elle se mit à pleurer. Elle avait honte de céder à la panique, mais la nuit était tombée, elle ne savait pas où elle était. Si Amine ne revenait pas, elle serait complètement perdue, sans argent, sans ami. Elle ne connaissait même pas le nom de la rue où ils logeaient.
Quand Amine rentra, un peu avant minuit, elle était là, échevelée, le visage rouge et décomposé. Elle avait mis du temps à ouvrir la porte, elle tremblait et il crut que quelque chose s’était passé. Elle se jeta dans ses bras et elle tenta d’expliquer sa peur, sa nostalgie, l’angoisse folle qui l’avait étreinte. Il ne comprenait pas, et le corps de sa femme, accrochée à lui, lui sembla affreusement lourd. Il l’attira vers le lit et ils s’assirent l’un à côté de l’autre. Amine avait le cou mouillé de larmes. Mathilde se calma, sa respiration se fit plus lente, elle renifla plusieurs fois et Amine lui tendit un mouchoir qu’il avait caché dans sa manche. Il lui caressa lentement le dos et lui dit : « Ne fais pas la petite fille. Tu es ma femme maintenant. Ta vie est ici. »
Deux jours plus tard, ils s’installèrent dans la maison de Berrima. Dans les étroites ruelles de la vieille ville, Mathilde agrippa le bras de son mari, elle avait peur de se perdre dans ce labyrinthe où une foule de commerçants se pressaient, où les vendeurs de légumes hurlaient leurs boniments. Derrière la lourde porte cloutée de la maison, la famille l’attendait. La mère, Mouilala, se tenait au milieu du patio. Elle portait un élégant caftan de soie et ses cheveux étaient recouverts d’un foulard vert émeraude. Pour l’occasion, elle avait ressorti de son coffre en cèdre de vieux bijoux en or ; des bracelets de cheville, une fibule gravée et un collier si lourd que son corps chétif était un peu courbé vers l’avant. Quand le couple entra elle se jeta sur son fils et le bénit. Elle sourit à Mathilde qui prit ses mains dans les siennes et contempla ce beau visage brun, ces joues qui avaient un peu rougi. « Elle dit bienvenue », traduisit Selma, la petite sœur qui venait de fêter ses neuf ans. Elle se tenait devant Omar, un adolescent maigre et taiseux, qui garda les mains derrière son dos et les yeux baissés.
Mathilde dut s’habituer à cette vie les uns sur les autres, à cette maison où les matelas étaient infestés de punaises et de vermine, où l’on ne pouvait se protéger des bruits du corps et des ronflements. Sa belle-sœur entrait dans sa chambre sans prévenir et elle se jetait sur son lit en répétant les quelques mots de français qu’elle avait appris à l’école. La nuit, Mathilde entendait les cris de Jalil, le plus jeune frère, qui vivait enfermé à l’étage avec pour seule compagnie un miroir qu’il ne perdait jamais de vue. Il fumait continuellement le sebsi, et l’odeur du kif se répandait dans le couloir et l’étourdissait.
Toute la journée, des hordes de chats traînaient leurs profils squelettiques dans le petit jardin intérieur, où un bananier couvert de poussière luttait pour ne pas mourir. Au fond du patio était creusé un puits dans lequel la bonne, ancienne esclave, faisait remonter de l’eau pour le ménage. Amine lui avait dit que Yasmine venait d’Afrique, peut-être du Ghana, et que Kadour Belhaj l’avait achetée pour sa femme sur le marché de Marrakech.
Extraits
« — Nous allons vivre chez ma mère en attendant. »
Mathilde sauta sur ses pieds et elle se mit à rire.
« Tu n’es pas sérieux ? » Elle avait l’air de trouver la situation ridicule, hilarante. Comment un homme comme Amine, un homme capable de la posséder comme il l’avait fait cette nuit, pouvait-il lui faire croire qu’ils allaient vivre chez sa mère ?
Mais Amine ne goûta pas la plaisanterie. Il resta assis, pour ne pas avoir à subir la différence de taille entre sa femme et lui. D’une voix glacée, les yeux fixés sur le sol en granito, il affirma :
« Ici, c’est comme ça. »
Cette phrase, elle l’entendrait souvent. À cet instant précis, elle comprit qu’elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. Amine était sur son territoire à présent, c’était lui qui expliquait les règles, qui disait la marche à suivre, qui traçait les frontières de la pudeur, de la honte et de la bienséance. En Alsace, pendant la guerre, il était un étranger, un homme de passage qui devait se faire discret. Lorsqu’elle l’avait rencontré durant l’automne 1944 elle lui avait servi de guide et de protectrice. Le régiment d’Amine était stationné dans son bourg à quelques kilomètres de Mulhouse et ils avaient dû attendre pendant des jours des ordres pour avancer vers l’est. De toutes les filles qui encerclèrent la Jeep le jour de leur arrivée, Mathilde était la plus grande. Elle avait des épaules larges et des mollets de jeune garçon. Son regard était vert comme l’eau des fontaines de Meknès, et elle ne quitta pas Amine des yeux. Pendant la longue semaine qu’il passa au village, elle l’accompagna en promenade, elle lui présenta ses amis et elle lui apprit des jeux de cartes. Il faisait bien une tête de moins qu’elle et il avait la peau la plus sombre qu’on puisse imaginer. Il était tellement beau qu’elle avait peur qu’on le lui prenne. Peur qu’il soit une illusion. Jamais elle n’avait ressenti ça. Ni avec le professeur de piano quand elle avait quatorze ans. Ni avec son cousin Alain qui mettait sa main sous sa robe et volait pour elle des cerises au bord du Rhin. Mais arrivée ici, sur sa terre à lui, elle se sentit démunie. » p. 22-23
« Lorsque Amine l’avait épousée, Mathilde avait à peine vingt ans et, à l’époque, il ne s’en était pas inquiété. Il trouvait même la jeunesse de son épouse tout à fait charmante, ses grands yeux ravis et surpris de tout, sa voix encore fragile, sa langue tiède et douce comme celle d’une petite fille. Il avait vingt-huit ans, ce qui n’était pas beaucoup plus vieux, mais plus tard il devrait reconnaître que son âge n’avait rien à voir avec ce malaise que sa femme, parfois, lui inspirait. Il était un homme et il avait fait la guerre. Il venait d’un pays où Dieu et l’honneur se confondent et puis il n’avait plus de père… » p. 41
« Pendant les quatre premières années à la ferme, ils allaient connaître toutes les déconvenues, et leur vie prendre des accents de récit biblique. Le colon qui avait loué la propriété pendant la guerre avait vécu sur une petite parcelle cultivable, derrière la maison, et tout restait à faire. D’abord, il fallut défricher et débarrasser la terre du doum, cette plante vicieuse et tenace, qui demandait aux hommes un travail épuisant. Contrairement aux colons des fermes avoisinantes, Amine ne put compter sur l’aide d’un tracteur et ses ouvriers durent arracher le doum à la pioche, pendant des mois. Il fallut ensuite consacrer des semaines à l’épierrage, et le terrain, une fois libéré de la rocaille, fut défoncé à la charme et labouré. On y planta des lentilles, des petits pois, des haricots et des arpents entiers d’orge et de blé tendre. L’exploitation fut alors attaquée par un vol de sauterelles. Un nuage roussâtre, tout droit sorti d’un cauchemar, vint dans un crépitement dévorer les récoltes et les fruits dans les arbres. Amine s’emporta contre les ouvriers qui pour faire fuir les parasites se contentaient de taper contre des boîtes de conserves. » p. 49
« Pendant l’été 1954, Mathilde écrivit souvent à Irène mais ses lettres restèrent sans réponse. Elle pensa que les troubles qui agitaient le pays étaient responsables de ces dysfonctionnements et elle ne s’inquiète pas du silence de sa sœur. Francis Lacoste, nouveau résident général, avait succédé au général Guillaume et à son arrivée, en mai 1954, il promit de lutter contre la vague d’émeutes et d’assassinats qui terrorisaient la population française. Il menaça les nationalistes de terribles représailles et Omar, le frère d‘Amine, n’avait pas de mot trop dur pour lui. Un jour, ce dernier s’en prit à Mathilde et il l’insulte. Il avait appris la mort, en prison, du résistant Mohammed Zerktouni et il écumait de rage. « Il n’y a plus que les armes qui permettront de libérer ce pays. Ils vont voir ce que les nationalistes leur réservent. » Mathilde essaya de le calmer. « Tous les Européens ne sont pas comme ça, tu le sais très bien. » Elle lui cita l’exemple de Français qui s’étaient clairement déclarés favorables à l’indépendance et qui s’étaient même parfois fait arrêter pour avoir apporté une aide logistique… » p. 169
« Omar haïssait son frère autant qu’il haïssait la France. La guerre avait été sa vengeance, son moment de grâce. Il avait fondé beaucoup d’espoir sur ce conflit et il avait pensé qu’il en sortirait doublement libre. Son frère serait mort et la France serait vaincue. En 1940, après la capitulation, Omar afficha avec délice son mépris pour tous ceux qui manifestaient la moindre obséquiosité devant les Français. Il prenait du plaisir à les bousculer, à les pousser dans les queues des magasins, à cracher sur les chaussures des dames. Dans la ville européenne, il insultait les domestiques, les gardiens, les jardiniers qui tendaient, La tête basse, leur certificat de travail aux policiers français qui menaçaient : « Quand tu as fini de travailler, tu dégages : compris ? » Il appelait à la révolte, montrait du doigt les pancartes qui, au bas des immeubles, interdisaient les ascenseurs ou la baignade aux indigènes. » p. 211
« Un soir, alors qu’ils finissaient de dîner, un homme se présenta à leur porte. Dans l’obscurité du hall d’entrée, Amine ne reconnut pas tout de suite son compagnon d’armes. Mourad était trempé par la pluie, il grelottait dans ses habits mouillés. D’une main, il tenait fermés les pans de son manteau, de l’autre, il secouait sa casquette qui dégoulinait. Mourad avait perdu ses dents et il parlait comme un vieillard, en mâchant l’intérieur de ses joues. Amine le tira à l’intérieur et le serra contre lui, si fort qu’il put sentir chacune des côtes de son ancien compagnon. Il se mit à rire et il se fichait bien de mouiller ses vêtements. « Mathilde! Mathilde! » hurla-t-il en tirant Mourad derrière lui jusqu’au salon. Mathilde poussa un cri. Elle se souvenait parfaitement de l’ordonnance de son mari, un homme timide et délicat pour qui elle avait eu de l’amitié sans pouvoir jamais le lui exprimer. «Il faut qu’il se change, il est trempé jusqu’aux os. Mathilde, va lui chercher des vêtements. » Mourad s’insurgea, il mit les mains devant son visage et les agita nerveusement. » p. 239
À propos de l’auteur
Leïla Slimani est une journaliste et écrivaine franco-marocaine née à Rabat, Maroc le 3 octobre 1981, d’une mère franco-algérienne et d’un père marocain. Élève du lycée français de Rabat, elle a grandi dans une famille d’expression française. Son père, Othman Slimani, est banquier, sa mère est médecin ORL. En 1999, elle vient à Paris. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle s’essaie au métier de comédienne (Cours Florent), puis se forme aux médias à l’École supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe). Elle est engagée au magazine Jeune Afrique en 2008 et y traite des sujets touchant à l’Afrique du Nord. Pendant quatre ans, son travail de reporter lui permet d’assouvir sa passion pour les voyages, les rencontres et la découverte du monde. En 2013, son premier manuscrit est refusé par toutes les maisons d’édition auxquelles elle l’avait envoyé. Elle entame alors un stage de deux mois à l’atelier de l’écrivain et éditeur Jean-Marie Laclavetine. Elle déclare par la suite: «Sans Jean-Marie, Dans le jardin de l’ogre n’existerait pas».
En 2014, elle publie son premier roman chez Gallimard, Dans le jardin de l’ogre. Le sujet (l’addiction sexuelle féminine) et l’écriture sont remarqués par la critique et l’ouvrage est proposé pour le Prix de Flore 2014. Son deuxième roman, Chanson douce, obtient le prix Goncourt 2016, ainsi que le Grand Prix des lectrices du magazine ELLE 2017. Il est adapté au cinéma en 2019, avec Karin Viard et Leïla Bekhti. En 2016, elle publie Le diable est dans les détails, recueil de textes écrits pour l’hebdomadaire Le 1. En parallèle, avec entre autres Salomé Lelouch, Marie Nimier, Ariane Ascaride et Nancy Huston, réunies sous le nom Paris des Femmes, elle cosigne l’ouvrage collectif théâtral Scandale publié dans la Collection des quatre-vents de L’avant-scène théâtre. En 2017 elle publie trois ouvrages: Sexe et mensonges: La vie sexuelle au Maroc qui a eu un fort retentissement médiatique, le roman graphique Paroles d’honneur, ainsi que Simone Veil, mon héroïne. Elle a été nommée représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie en novembre 2017. En 2020 paraît le premier tome d’une trilogie familiale, Le Pays des autres. Mère de deux enfants, elle est mariée depuis 2008 à un banquier. (Source: Babelio)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
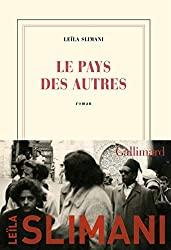


Tags:


