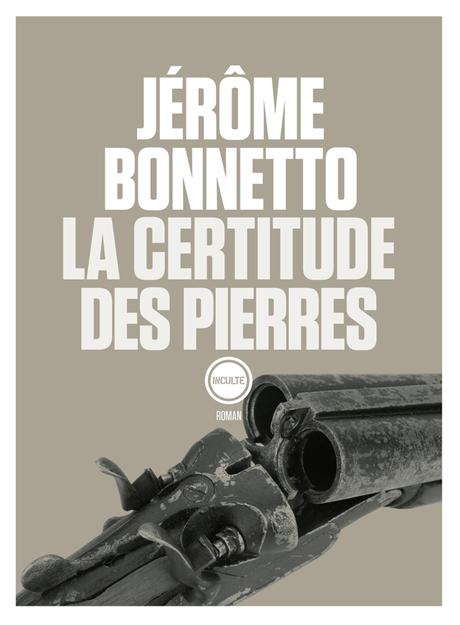

En deux mots:
Après un séjour en Afrique, Guillaume retrouve ses parents et son village où il décide de devenir berger. Mais ses moutons gênent les chasseurs qui entendent ne pas céder un pouce de leur terrain de jeu. Le conflit va petit à petit s’envenimer jusqu’à une lutte sans merci.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
Les moutons de la discorde
Dans un roman rural construit comme une tragédie grecque, Jérôme Bonnetto nous entraîne dans un conflit entre un berger et des chasseurs. Et à une réflexion sur la place de l’autre au sein d’une communauté repliée sur elle-même.
Comme le fils prodigue, Guillaume Levasseur a choisi de partir pour découvrir le vaste monde, en travaillant notamment pour des ONG en Afrique. Le voici die retour à Ségurian, un petit village de montagne où il retrouve ses parents, Jacques et Catherine. «À aucun moment ils n’eurent l’idée de lui faire le moindre reproche. Guillaume était devenu un homme. Le verbe, surtout, avait changé. Il s’exprimait mieux, ses phrases coulaient dans une syntaxe ample que des mots précis et nuancés irisaient. Il était devenu un homme fin et fort tout à la fois.»
C’est là, dans ce village de 400 âmes qui «n’était pas un pays mais un jardin», qu’il entend s’installer en communion avec la nature et reprendre le métier de berger qui avait disparu au fil des ans.
Une initiative que les autochtones vont d’abord regarder avec indifférence avant de constater que ces moutons gênent leur loisir favori, la chasse. Désormais, ils sont entravés dans leurs battues, gênés par le troupeau. Guillaume sait qu’il a le droit avec lui et refuse de dégager. Mais que peut le droit face aux traditions solidement ancrées et à une histoire qui s’est cristallisée au fil des ans autour de la famille Anfosso? Leur entreprise de construction règne depuis des générations sur le village. Il suffit d’une visite au cimetière pour comprendre la manière dont la communauté fonctionne: «En dehors des Anfosso, on y trouvait quelques noms connus. Pastorelli, Casiraghi, Barral, Leonetti. Des familles bien de chez nous. Deux ou trois d’entre elles avaient fait les grandes guerres. On leur avait donné un emplacement à l’ombre sous des pierres lourdes et admirables. D’autres avaient défendu l’Algérie française. Allée principale, plein soleil. Chacun était à sa place et de la place, il y en avait pour tout le monde. Au fond dormait le caveau de la famille Levasseur. La pierre était lisse et fraîche, elle n’avait pas eu le temps de se polir, de faire des racines. On jurerait qu’elle sonne creux. Seulement une génération sous la terre. Une pièce rapportée, des estrangers, des messieurs de la ville comme on dit.»
Au fil des jours, le conflit s0envenime, les positions se figent. La Saint-Barthélemy, le jour de la fête du village célébrée 24 août, marquant le point d’orgue d’une guerre qui ne va pas restée larvée. Un mouton est retrouvé égorgé et il ne fait guère de doute sur l’origine de l’attaque. Mais Guillaume préfère minimiser l’affaire et se concentrer sur l’accroissement de son troupeau. «On continuait de se regarder de travers, des regards tendus comme une corde de pendu, mais – et c’était bien l’essentiel – on partageait la montagne, même si on le faisait un peu comme on séparerait le bon grain de l’ivraie. La vie poursuivait son cours.»
Construisant son roman comme une tragédie grecque, avec unité de lieu et même un chœur de femmes qui «s’ouvrait sur une étrange mélodie, tremblante, incertaine, comme le vol d’une chauve-souris en plein jour», Jérôme Bonnetto réussit à faire monter la tension page après page jusqu’à cet épilogue que l’on redoute. Ce roman est à la fois un traité de l’intolérance, une leçon sur les racines de la xénophobie et un conte cruel sur l’entêtement qui peut conduire au pire, mais c’est avant tout un bonheur de lecture.
La certitude des pierres
Jérôme Bonnetto
Éditions Inculte
Roman
192 p., 16,90 €
EAN 9782360840274
Paru le 8/01/2020
Où?
Le roman se déroule en France, dans un village de montagne baptisé Ségurian.
Quand?
L’action se situe de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Ségurian, un village de montagne, quatre cents âmes, des chasseurs, des traditions. Guillaume Levasseur, un jeune homme idéaliste et déterminé, a décidé d’installer une bergerie dans ce coin reculé et paradisiaque. Un lieu où la nature domine et fait la loi. Accueilli comme une bête curieuse par les habitants du village, Guillaume travaille avec acharnement ; sa bergerie prend forme, une vie s’amorce.
Mais son troupeau pâture sur le territoire qui depuis toujours est dévolu à la chasse aux sangliers. Très vite, les désaccords vont devenir des tensions, les tensions des vexations, les vexations vont se transformer en violence.
La certitude des pierres est un texte tendu, minéral, qui sonde les âmes recroquevillées dans l’isolement, la monotonie des jours, l’hostilité de la montagne et de l’existence qu’elle engendre, la mesquinerie ordinaire et la peur de l’inconnu, de l’étranger.
D’une écriture puissante, ample, poétique, Jérôme Bonnetto nous donne à voir l’étroitesse d’esprit des hommes, l’énigme insondable de leurs rêves, et l’immensité de leur folie.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
La Cause littéraire (Cathy Garcia)
L’Espadon
Lireka, le blog
Blog Bonnes feuilles et mauvaise herbe
Blog Blacknovel 1
Blog Lire au lit
Blog sistoeurs.net
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« Prologue
Le vent de Ségurian remonte le chemin Saint-Bernard et va se perdre tout en haut de la montagne, au-delà des forêts. C’est un vent tiède et amer comme sorti de la bouche d’une vieille, un souffle chargé de poussières de cyprès et d’olives séchées qui emporte avec lui les derniers rêves des habitants et les images interdites – les seins de la voisine guettés dans l’entrebâille -ment d’une porte, les rires des hommes à tête de chien, la dame blanche qui hante les bois. Dans sa course, il écarte ses bras et fait bruisser les feuillages des arbustes, les herbes folles, comme une rumeur. Partout sur les chemins, il efface les traces de pas.
Le village est plongé dans la torpeur, il est un corps suspendu, pour quelques instants encore, le temps de planter le décor.
On dort. Personne ne sait à qui appartient la nuit. Tout est gris-mauve et les chats ont des yeux de loup. La montagne le sait : bientôt, le disque solaire se reflétera dans la mer et la loi des hommes reprendra ses droits. Tout pourra recommencer.
On allume ici une lampe, là une cafetière, on fait glisser une savate, claquer l’élastique d’un slip. On avance à petits pas.
On a transpiré toute la nuit dans la mollesse des matelas, on s’est tourné et retourné en quête d’un peu de frais, pour quelques secondes à peine, puis on a retrouvé la chaleur froissée des draps. On en veut à l’autre d’être gras, de dégager toute cette moiteur, si bien qu’on a fini par le pousser un peu du talon, comme ça, en douce, pour gagner quelques centimètres.
La nuit peut être infernale par ici. On a cru que cette fois, on ne parviendrait pas à s’endormir, mais on a fini par y arriver, on a passé l’heure des braves, comme toujours, en bout de course, plus fatigué encore d’avoir lutté, les reins inondés de sueur tiède et la bouche sèche. Plus tard, on dira qu’il a fait chaud, juste pour lancer la conversation, mais on admet qu’on ne serait pas mieux dans le froid du Nord. On ne serait mieux nulle part ailleurs au fond. Inutile de chercher.
On est une race, un bois. La mesure se prend dans le ventre, on ne trouverait pas vraiment les mots pour bien l’expliquer. Ça se sent, voilà tout. C’est qu’on vient d’un pays à l’intérieur d’un autre pays comme la langue chante son accent local, son vocabulaire, une autre langue au fond de la langue, d’autres hommes parmi les hommes. C’est la terre qui décide ici, c’est elle qui trace les mêmes lignes sur les fronts, les mêmes cors aux pieds, les mêmes gestes. On est un bois, un bloc, une race.
On se comprend. On fait à notre idée. On a nos règles, les seules qui vaillent. Les autres peuvent passer, on les salue, de loin, comme ça. Du plus loin possible.
Les premiers rayons caressent la montagne. Chaque jour serait une naissance s’il n’y avait les hommes. Deux coups de chevrotine déchirent l’aube. Voilà, ça va commencer. Pas besoin de faire un dessin.
LA PREMIÈRE SAINT-BARTHÉLEMY
Il nous faut un homme, inconnu, avec un grand sac, un homme qui arrive par la route : le noir d’un point, d’une silhouette tout d’abord, longue, lointaine, puis un corps déjà, qui soulève un peu de poussière comme un petit nuage bas, puis un être, plus précis dans un savant contre-jour qui dessine le va-et-vient des cheveux au balancier de la marche, enfin un homme.
Il est grand, robuste. Il semble venir de loin. Il avance dans un frottement de jean, de cuir et de coton, arrangement naturel pour la mélodie légère des boucles métalliques du sac sur lesquelles rebondit une sorte de grigri africain. C’est la seule musique audible, juste suffisante pour égayer la marche.
On reste un peu avec lui, comme un ange invisible. On n’est pas si mal sur son épaule. On voit haut et bien. On écoute sa longue respiration que la barbe filtre. On s’en voudrait de fouiller dans ses poches ou d’ouvrir son sac. On saura bien assez tôt ce qu’il trimballe. Pour l’instant, il coupe la lumière prometteuse du matin.
Dans un virage s’esquisse à peine un petit chemin de terre. La pente est un peu plus rude par là, à l’écart de la route, et le soleil plus incisif, mais le chemin plus direct. Il n’est guère emprunté dorénavant et, malgré de longues années d’abandon, il résiste aux hautes herbes, comme si la terre, tellement foulée et refoulée, avait perdu toute vertu de fertilisation.
C’est ce chemin qu’il choisit, sans la moindre hésitation. Le village n’est plus qu’à un petit kilomètre, mais un kilomètre de rude montée en ligne presque droite. On aperçoit un ou deux lacets en contrebas des premières maisons, puis, tout là-haut, le clocher.
Le rythme de sa marche ne faiblit pas malgré la raideur de la pente. Par endroits, il pourrait presque toucher le sol simplement en tendant les bras. Son souffle s’accélère, raisonnablement. On ne perçoit pas de fatigue particulière. Parfois, les pierres roulent derrière lui, en entraînant d’autres au passage. Parfois, il prend appui sur une tige plus haute et plus solide que les autres, la serrant d’une main puissante. Parfois, les racines cèdent, alors il jette la tige dans les broussailles avant de s’agripper à une autre.
Il avance, mais c’est ici que l’on s’arrête. Le village est tout près. De dos, sa progression paraît encore plus rapide. Les herbes et le chemin au premier plan, il s’enfonce dans le cadre. On le devine désormais enroulant le dernier lacet. Puis sa tête disparaît.
C’était un 24 août. Guillaume Levasseur allait entrer dans le village.
C’était jour de fête. Comme tous les 24 août, on fêtait la Saint-Barthélemy et ce n’est pas rien.
Le 14 juillet, on faisait la fine bouche, on buvait un coup, on se couchait un peu plus tard, mais au fond on se préservait. Il y avait bien les enfants pour ouvrir de grands yeux devant le feu d’artifice, mais les anciens savaient que même les plus hautes fusées de la ville ne parviendraient jamais jusqu’au village. La révolution, on n’y était pas, on ne savait plus trop ce que ça signifiait. Il avait fallu trancher des têtes, on avait changé de salauds.
Le 24 août, c’était quand même autre chose. C’était la fête du Saint-Patron. Le reste du monde s’en contrefoutait et on adorait ça. Notre saint à nous. Bénédiction et protection. Ad vitam æternam, pour nous seuls.
Le 24 août, tout le village était sur la place jusqu’au petit jour. C’était chaque année la même musique, on n’aurait raté ça pour rien au monde. On y pensait longtemps à l’avance, dès les premières vapeurs de l’été, on se sentait bien quand la fête approchait, on se lançait des clins d’œil, on rejouait la partition des plus beaux millésimes, on élaborait sa propre mythologie, on fondait une nation.
C’est le 24 août qu’on était devenu homme, frère, amant, et fier surtout.
Même les jeunes de leur plus frêle maturité avaient mis deux trois sous de côté pour l’occasion. On tapait dans le cochon en porcelaine, on faisait les yeux doux à la grand-mère, on grattait ici et là, on prenait sur le permis de conduire s’il le fallait pour être à la hauteur et marquer l’histoire de son empreinte.
Le 24 août s’ouvraient les tiroirs, les penderies, parfois on tombait sur une vieille photo et on perdait un peu de temps dans la contemplation attendrie d’un autre soi déjà défunt. La Saint-Barthélemy était le mètre étalon de nos vies, l’arbre sur lequel on regardait passer les saisons. On oubliait toujours un peu trop combien on avait changé, mais on s’aimait bien au fond pour ce qu’on avait été dans ce qu’on était devenu. Puis on refermait la parenthèse et on finissait par se concentrer sur l’essentiel : trouver sa plus belle chemise, s’assurer qu’on rentrait toujours dans le pantalon. On sortait le sent-bon du fond de l’armoire, celui aux vertus magiques, on inondait le cou et les cheveux, on soulignait la raie sur le côté, on s’ajustait devant le miroir et on était prêt. »
Extraits
« Charles partageait avec Joseph l’entreprise de construction et il se pliait le plus souvent à ses décisions. C’était à son ombre qu’il avait poussé et, à Ségurian, l’ombre était un bien précieux. Parfois, Joseph emmenait son petit Emmanuel. Anfosso III. Mais Emmanuel n’aimait pas trop ça, aller au cimetière. L’idée de finir un jour sous la terre l’angoissait un peu, d’autant plus qu’on ne lui avait rien expliqué, on ne lui avait pas dit comment les choses émergent, passent et disparaissent. Il voyait la mort comme une punition. Et puis ce grand-père, il ne l’avait jamais connu. Qu’est-ce que ça pouvait bien lui faire d’avoir les mêmes yeux? Ces yeux en amande, c’était comme une signature, une légende sous une photo. Anfosso. Le cimetière de Ségurian offrait son traité de sociologie à qui savait le lire. En dehors des Anfosso, on y trouvait quelques noms connus. Pastorelli, Casiraghi, Barral, Leonetti. Des familles bien de chez nous. Deux ou trois d’entre elles avaient fait les grandes guerres. On leur avait donné un emplacement à l’ombre sous des pierres lourdes et admirables. D’autres avaient défendu l’Algérie française. Allée principale, plein soleil. Chacun était à sa place et de la place, il y en avait pour tout le monde. »
« Au fond dormait le caveau de la famille Levasseur. La pierre était lisse et fraîche, elle n’avait pas eu le temps de se polir, de faire des racines. On jurerait qu’elle sonne creux. Seulement une génération sous la terre. Une pièce rapportée, des estrangers, des messieurs de la ville comme on dit. Va falloir qu’ils fassent leurs preuves, les Levasseur. Va falloir me remplir ce caveau avant d’élever la voix, avant de faire les fiers, avant de touiller la soupe au pistou. C’est comme ça, c’est l’ordre des choses. Guillaume était arrivé au pays par la voie Levasseur, un chemin un peu biscornu. Après avoir travaillé toute leur vie en ville, Jacques et Catherine Levasseur avaient décidé de partir, de goûter un peu à la tranquillité des villages perchés, loin des fourmilières déshumanisées parce que la vraie vie, finalement, c’était là, dans un espace retiré, en dialogue avec la nature, avec d’authentiques échanges et du temps pour profiter de ces authentiques échanges. De l’humain avant tout. Ils avaient voulu transmettre ça à leur enfant, ce sens-là de l’existence. Il y avait un monde qu’on ne comprenait plus vraiment tout en bas, un monde qui s’atrophiait et qui n’allait pas tarder à se déchirer. Il valait mieux dé poser les armes. On voulait terminer en beauté, dans la quiétude. Ils avaient emménagé dans la maison du grand- oncle Levasseur, un original dont on savait peu de choses. Il avait fait le tour du monde et fini sa course. »
« Les retrouvailles avaient dépassé toutes les espérances de Jacques et Catherine. Ils s’embrassaient, ils riaient, ils se racontaient des histoires. Guillaume avait travaillé en Afrique pour une ONG . Il avait passé des mois à installer des mini stations d’épuration dans de petites villes, dans des villages reculés. Il avait été très occupé. La mission terminée, il s’était permis de voyager quelques semaines à travers le continent, puis il était rentré. On n’en saurait pas beaucoup plus pour l’instant. À aucun moment ils n’eurent l’idée de lui faire le moindre reproche. Guillaume était devenu un homme. Le verbe, surtout, avait changé. Il s’exprimait mieux, ses phrases coulaient dans une syntaxe ample que des mots précis et nuancés irisaient. Il était devenu un homme fin et fort tout à la fois. »
« La troisième Saint-Barthélemy
Des mois étaient passés, on ne savait trop comment. On faisait aller. L’hiver replie les âmes sur elles-mêmes, rétracte les envies comme les coins d’une vieille lettre jetée aux flammes. Le berger avait fini par oublier les chasseurs, petit à petit, il avait cessé d’attendre une explication concernant la mort du mouton. L’assurance avait refusé de rembourser sous prétexte qu’il fallait le collier du chien pour preuve du préjudice. Finalement, Guillaume s’était recentré sur son travail et il avait fait fructifier, c’était le moins que l’on puisse dire. Les premières rentrées d’argent avaient dépassé ses espérances. Son cheptel s’était très vite fait une place sur le marché. C’est qu’il faisait de la qualité, le berger, tout le monde le disait dans le métier. Il commençait déjà à se faire un nom. Il voulait réinvestir sans attendre. Il prospectait déjà en vue d’acquérir de nouvelles bêtes jusqu’à doubler dès l’été son troupeau. Il n’avait aucun besoin : un peu d’essence dans la moto, quelques pochettes de tabac à rouler et, pour la nourriture, il vivait encore, sans se l’être explicitement formulé, dans le giron de Catherine, sa mère, qui n’arrivait jamais les mains vides et laissait chaque jour des plats cuisinés ou abandonnait ici et là des boîtes, des fruits et des sacs gorgés de victuailles. Guillaume faisait semblant de s’en offusquer, il soufflait, refusait, s’énervait même. » p. 77
« Les chasseurs, eux, étaient restés sur leur coup d’éclat. Ils menaient un mouton à zéro, ce n’était déjà pas si mal. Parfois, au café, une allusion échappait, des oreilles se tendaient, Charles et Lucien souriaient, Joseph faisait les gros yeux, et puis on passait à autre chose. Il y avait du boulot au chantier. On continuait de se regarder de travers, des regards tendus comme une corde de pendu, mais – et c’était bien l’essentiel – on partageait la montagne, même si on le faisait un peu comme on séparerait le bon grain de l’ivraie. La vie poursuivait son cours. » P. 78
« Au village, Jeanne avait très vite senti qu’on lui réservait un traitement spécial. Elle faisait la queue comme tout le monde à l’épicerie ou à la poste et elle notait à chaque fois comme un voile, un masque qui tombait sur le visage des employés quand venait son tour. Le geste amical laissait place à un ton poli, presque à l’excès parfois, toujours gêné. Jeanne sentait bien ces choses-là, elle avait développé dans son métier un instinct particulier, une perspicacité, elle savait lire les disputes des parents dans les yeux des enfants. » P. 88
« Le chœur des femmes se répandait discrètement dans l’air comme on souffle sur la fleur de pissenlit des dictionnaires Larousse. Rome s’est faite avec le chœur des femmes et le corps des hommes. On a détruit Babylone par corps d’hommes soumis au chœur des femmes. C’était il y a longtemps et tout cela finirait bien par changer. Mais pas à Ségurian. Le berger, ses moutons et ses problèmes. Le chœur des femmes s’ouvrait sur une étrange mélodie, tremblante, in certaine, comme le vol d’une chauve-souris en plein jour. Puis le chant fuguait un peu plus bas. Pianissimo . On hésitait un peu, même les femmes de chasseurs va cillaient, surtout celles qui avaient une tendresse pour la tranquillité et les bêtes blessées, mais il faudrait bien s’accorder. Il y en avait une ou deux qui parlaient plus fort que les autres au bout de la rue, les solistes entraînaient le chœur. » P. 102
« Quand l’épaule de Joseph se déroba sous la rondelle de bois, saint Barthélemy bascula en avant et se brisa aux pieds du chasseur. La tête se sépara du corps et roula sur deux mètres en accrochant la poussière. Après l’éblouissement, Joseph se releva et la ramassa. Il crut voir alors se dessiner sur le saint plâtre un petit sourire en coin, un sourire de berger. » P. 117
À propos de l’auteur
Jérôme Bonnetto est né à Nice en 1977 il vit désormais à Prague où il enseigne le français. La certitude des pierres est son troisième roman. (Source : Éditions Inculte)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
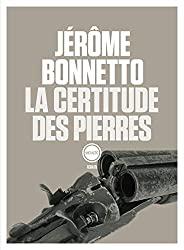


Tags:


