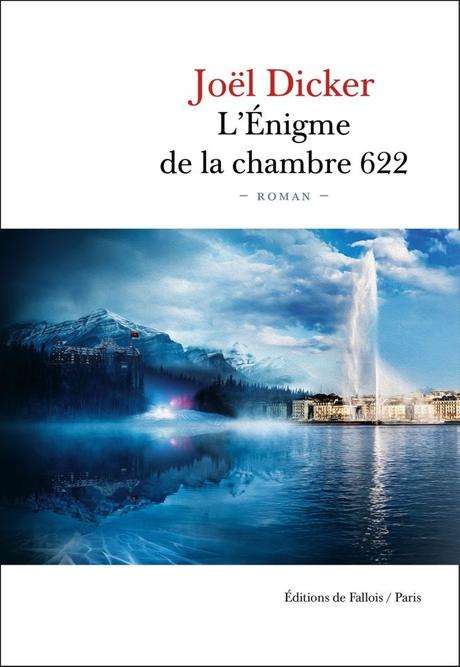

En deux mots:
Un meurtre a été commis dans la chambre 622 du palace de Verbier durant le Grand week-end organisé par une grande banque suisse. Des années plus tard l’énigme reste entière, mais une cliente de l’hôtel va encourager l’écrivain venu en pèlerinage dans cet endroit chéri par son éditeur décédé à reprendre l’enquête.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
L’éditeur, l’écrivain et le banquier
Joël Dicker a réussi avec L’énigme de la chambre 622 l’exploit de raconter quatre histoires en une. Un meurtre mystérieux, un hommage à Bernard de Fallois, l’enquête d’un écrivain et de son acolyte et l’hommage d’un fils à son père.
Une fois n’est pas coutume, je me permets de commencer cette chronique par un souvenir personnel qui remonte à l’automne 1997. À l’occasion de la parution du roman Une affaire d’honneur, Vladimir Dimitrijevic, fondateur de la maison d’édition L’Age D’homme avait organisé une rencontre avec l’auteur Hubert Monteilhet et Bernard de Fallois, coéditeur de l’ouvrage. J’ai donc eu l’honneur et le privilège de rencontrer quelques années avant Joël Dicker ses deux éditeurs successifs. Vladimir Dimitrijevic qui a accepté de publier son premier roman Le dernier jour de nos pères avant de mourir en voiture et Bernard de Fallois qui le publiera finalement, non sans avoir renâclé. Cette entrée en matière pour confirmer la personnalité et les qualités d’un homme exceptionnel, pour souligner combien l’hommage rendu par Joël Dicker à son éditeur dans les premières lignes de L’énigme de la chambre 622 est sincère et émouvant: «Bernard de Fallois était l’homme à qui je devais tout. Mon succès et ma notoriété, c’était grâce à lui. On m’appelait l’écrivain, grâce à lui. On me lisait, grâce à lui. Lorsque je l’avais rencontré, j’étais un auteur même pas publié: il avait fait de moi un écrivain lu dans le monde entier.»
Bien entendu, l’hommage à cet homme disparu le 2 janvier 2018, n’est que l’une des pièces du puzzle savamment construit par l’écrivain genevois et qui, livre après livre, entraîne son lecteur dans des récits qui, comme des strates géologiques, se superposent et finissent par constituer un ensemble aux teintes et aux couleurs variées. Voilà donc un écrivain qui se brouille avec sa nouvelle conquête parce qu’il la délaisse au profit du livre qui l’accapare et qui décide de partir pour Verbier découvrir enfin ce palace que son éditeur voulait lui faire connaître. Là-bas il fait la rencontre d’une charmante voisine, qui rêve de le seconder dans l’écriture de son prochain livre. Elle a même l’idée de départ, en découvrant la mystérieuse absence de chambre 622 dans ce palace. D’autant que Scarlett – un prénom qui est aussi un hommage à Bernard de Fallois qui aimait Autant en emporte le vent – va découvrir que c’est parce qu’un meurtre a été commis dans cette suite qu’elle a été rebaptisée 621 bis. L’écrivain (c’est ainsi que sa nouvelle équipière va désormais l’appeler) va donc, au lieu de profiter du calme de la station, s’atteler à son nouveau livre en espérant résoudre cette énigme. Entre Verbier et Genève, il part avec sa charmante coéquipière à la rencontre des témoins, interroger les proches, les policiers chargés de l’enquête et faire partager au lecteur le résultat de leurs investigations.
Nous voici de retour quelques années plus tôt, au moment où se prépare comme chaque année le «Grand week-end» organisé par la Banque Ebezner et durant laquelle vont se jouer plusieurs drames, dont ce meurtre non élucidé. Il y a là tous les employés de la prestigieuse banque genevoise, à commencer par Macaire Ebezner, qui devrait être nommé directeur, même si les règlements de succession ne sont plus uniquement héréditaires. Ce qui aiguise les appétits et les rivalités, d’autant que l’amour vient se mêler aux luttes de pouvoir. Anastasia, la femme de Macaire a une liaison avec son principal rival, Lev Levovitch dont l’ascension fulgurante ne laisse pas d’étonner. Pour lui aussi, ce rendez-vous de Verbier revêt une importance capitale. Le ballet qui se joue autour d’eux est machiavélique, chacun essayant de tirer les ficelles d’un jeu dont on découvrira combien il a été biaisé dès le départ.
Les amateurs d’énigme à tiroir seront ravis. Mais ce qui fait le sel de ce roman très dense, c’est l’histoire de Sol et Lev Levovitch, émigrés arrivés miséreux en Suisse et qui vont, à force de travail, tenter de grimper les échelons et de s’intégrer dans le pays qui les a accueilli. Sol espère réussir une carrière de comédien, mais ses tournées achèvent de le ruiner. Il accepte alors une place au Palace de Verbier où il parviendra aussi à faire embaucher son fils, avec l’idée fixe de la faire réussir là où lui a échoué.
Roman de la transmission et de l’héritage, L’énigme de la chambre 622 est aussi le plus personnel de Joël Dicker dont la famille fuyant le nazisme est arrivée en 1942 à Genève et franchir à la fois les difficultés liées à leur statut de réfugié et l’antisémitisme bien installé au bout du lac. Depuis La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert «l’écrivain» a indéniablement gagné en assurance sans pour autant oublier de poser un regard d’enfant sur le monde. Cela en agacera certains, moi je me régale !
L’énigme de la chambre 622
Joël Dicker
Éditions de Fallois
Roman
576 p., 23 €
EAN : 9791032102381
Paru le 27/05/2020
Où?
Le roman se déroule en Suisse, principalement à Genève et Verbier, mais on y passe par Martigny et Le Châble, dans quelques capitales européennes et à Corfou.
Quand?
L’action se situe en 2018, avec des retours en arrière dans les histoires familiales des protagonistes.
Ce qu’en dit l’éditeur
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?
Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Le Parisien (Pierre Vavasseur)
L’Illustré (Didier Dana – entretien avec l’auteur)
Le Temps (Lisbeth Koutchoumoff Arman)
Les Échos week-end (Thierry Gandillot)
Journal de Québec (Marie-France Bornais)
Cosmopolitan
Culturellement vôtre (Lucia Piciullina)
Blog L’Apostrophée
À l’occasion de la sortie de son nouveau roman Joël Dicker dévoile les livres de sa vie. © Production Cosmopolitan
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« Le jour du meurtre
(Dimanche 16 décembre)
Il était 6 heures 30 du matin. Le Palace de Verbier était plongé dans l’obscurité. Dehors, il faisait encore nuit noire et il neigeait abondamment.
Au sixième étage, les portes de l’ascenseur de service s’ouvrirent. Un employé de l’hôtel apparut avec un plateau de petit-déjeuner et se dirigea vers la chambre 622.
En y arrivant, il se rendit compte que la porte était entrouverte. De la lumière filtrait par l’interstice. Il s’annonça, mais n’obtint aucune réponse. Il prit finalement la liberté d’entrer, supposant que la porte avait été ouverte à son intention. Ce qu’il découvrit lui arracha un hurlement. Il s’enfuit pour aller alerter ses collègues et appeler les secours.
À mesure que la nouvelle se propagea à travers le Palace, les lumières s’allumèrent à tous les étages.
Un cadavre gisait sur la moquette de la chambre 622.
Chapitre 1.
Coup de foudre
Au début de l’été 2018, lorsque je me rendis au Palace de Verbier, un hôtel prestigieux des Alpes suisses, j’étais loin d’imaginer que j’allais consacrer mes vacances à élucider un crime commis dans l’établissement bien des années auparavant.
Ce séjour était censé m’offrir une pause bienvenue après deux petits cataclysmes personnels survenus dans ma vie. Mais avant de vous raconter ce qui se passa cet été-là, il me faut d’abord revenir sur ce qui fut à l’origine de toute cette histoire: la mort de mon éditeur, Bernard de Fallois.
Bernard de Fallois était l’homme à qui je devais tout.
Mon succès et ma notoriété, c’était grâce à lui.
On m’appelait l’écrivain, grâce à lui.
On me lisait, grâce à lui.
Lorsque je l’avais rencontré, j’étais un auteur même pas publié: il avait fait de moi un écrivain lu dans le monde entier. Bernard, sous ses airs d’élégant patriarche, avait été l’une des personnalités majeures de l’édition française. Pour moi, il avait été un maître et surtout, malgré les soixante ans qui nous séparaient, un grand ami.
Bernard était décédé au mois de janvier 2018, dans sa quatre-vingt-douzième année, et j’avais réagi à sa mort comme l’aurait fait n’importe quel écrivain : en me mettant à écrire un livre sur lui. Je m’y étais lancé corps et âme, enfermé dans le bureau de mon appartement du 13 avenue Alfred-Bertrand, dans le quartier de Champel, à Genève.
Comme toujours en période d’écriture, la seule présence humaine que je tolérais était celle de Denise, mon assistante. Denise était la bonne fée qui veillait sur moi. Éternellement de bonne humeur, elle organisait mon agenda, triait et classait le courrier des lecteurs, relisait et corrigeait ce que j’avais écrit. Accessoirement, elle remplissait mon frigidaire et m’approvisionnait en café. Enfin, elle s’attribuait des fonctions de médecin de bord, débarquant dans mon bureau, comme si elle montait sur un navire après une interminable traversée, et me prodiguait des conseils de santé.
— Sortez d’ici ! ordonnait-elle gentiment. Allez faire un tour dans le parc pour vous aérer l’esprit. Ça fait des heures que vous êtes enfermé !
— Je suis déjà allé courir tôt ce matin, lui rappelais-je.
— Vous devez vous oxygéner le cerveau à intervalles réguliers ! insistait-elle.
C’était presque un rituel quotidien : j’obtempérais et je sortais sur le balcon du bureau. Je m’emplissais les poumons de quelques bouffées de l’air frais de février, puis, la défiant d’un regard amusé, j’allumais une cigarette. Elle protestait et me disait, d’un ton consterné :
— Vous savez, Joël, je ne viderai pas votre cendrier. Comme ça, vous vous rendrez compte de ce que vous fumez.
Tous les jours, je m’astreignais à la routine monacale qui était la mienne en phase d’écriture et qui se décomposait en trois étapes indispensables : me lever à l’aube, faire un jogging et écrire jusqu’au soir. C’est donc indirectement grâce à ce livre que je fis la connaissance de Sloane. Sloane était ma nouvelle voisine de palier. Depuis son récent emménagement, tous les habitants de l’immeuble parlaient d’elle. Pour ma part je n’avais jamais eu l’occasion de la rencontrer. Jusqu’à ce matin où, de retour de ma séance de sport quotidienne, je la croisai pour la première fois. Elle revenait elle aussi d’un jogging et nous pénétrâmes ensemble dans l’immeuble. Je compris aussitôt pourquoi Sloane faisait l’unanimité parmi les voisins : c’était une jeune femme au charme désarmant. Nous nous contentâmes d’un salut poli avant de disparaître chacun dans notre appartement. Derrière ma porte, je restai béat. Cette brève rencontre avait suffi à me faire tomber un peu amoureux.
Je n’eus bientôt plus qu’une idée en tête : faire la connaissance de Sloane.
Je tentai une première approche par l’entremise de la course à pied. Sloane courait presque tous les jours, mais sans horaires réguliers. Je passais des heures à errer dans le parc Bertrand, désespérant de la croiser. Puis soudain, je la voyais qui filait le long d’une allée. En général, j’étais bien incapable de la rattraper et j’allais l’attendre à l’entrée de notre immeuble. Je trépignais devant les boîtes aux lettres, faisant semblant de relever le courrier chaque fois que des voisins allaient et venaient, jusqu’à ce qu’elle arrive enfin. Elle passait devant moi, me souriait, ce qui me faisait fondre et me décontenançait : le temps de trouver quelque chose d’intelligent à lui dire, elle était déjà rentrée chez elle.
C’est la concierge de l’immeuble, madame Armanda, qui me renseigna sur Sloane : elle était pédiatre, anglaise par sa mère, père avocat, elle avait été mariée deux ans mais ça n’avait pas marché. Elle travaillait aux Hôpitaux Universitaires de Genève et alternait des horaires de jour ou de nuit, ce qui expliquait ma difficulté à comprendre sa routine.
Après l’échec de la course à pied, je décidai de changer de méthode : je confiai à Denise la mission de surveiller le couloir à travers le judas et de m’avertir lorsqu’elle la voyait apparaître. Aux cris de Denise (« Elle sort de chez elle ! ») je déboulais de mon bureau, pomponné et parfumé, et j’apparaissais à mon tour sur le palier, comme s’il s’agissait d’une coïncidence. Mais nos échanges étaient limités à une salutation. En général, elle descendait à pied, ce qui coupait court à toute conversation. Je lui emboîtais le pas, mais à quoi bon ? Arrivée dans la rue, elle disparaissait. Les rares fois où elle prenait l’ascenseur, je restais muet et un silence gêné s’installait dans la cabine. Dans les deux cas, je remontais ensuite chez moi, bredouille.
— Alors ? demandait Denise.
— Alors rien, maugréais-je.
— Oh, mais vous êtes nul, Joël ! Enfin, faites un petit effort !
— C’est que je suis un peu timide, expliquais-je.
— Oh, arrêtez vos histoires, voulez-vous ! Vous n’avez pas l’air timide du tout sur les plateaux de télévision !
— Parce que c’est l’Écrivain que vous voyez à la télévision. Joël, lui, est très différent.
— Allons, Joël, ce n’est vraiment pas compliqué : vous sonnez à sa porte, vous lui offrez des fleurs et vous l’invitez à dîner. Vous avez la flemme d’aller chez le fleuriste, c’est ça ? Vous voulez que je m’en charge ?
Puis il y eut ce soir d’avril, à l’opéra de Genève, où je me rendis seul à une représentation du Lac des Cygnes. Voilà que pendant l’entracte, sortant fumer une cigarette, je tombai sur elle. Nous échangeâmes quelques mots puis, comme on sonnait déjà le rappel des spectateurs, elle me proposa d’aller boire un verre après le ballet. Nous nous retrouvâmes au Remor, un café à quelques pas de là. C’est ainsi que Sloane entra dans ma vie.
Sloane était belle, drôle et intelligente. Certainement l’une des personnes les plus fascinantes que j’aie rencontrées. Après notre soirée au Remor, je l’invitai à sortir plusieurs fois. Nous allâmes au concert, au cinéma. Je la traînais au vernissage d’une improbable exposition d’art contemporain qui nous valut un sérieux fou rire et d’où nous nous enfuîmes pour aller dîner dans un restaurant vietnamien qu’elle adorait. Nous passâmes plusieurs soirées chez elle ou chez moi, à écouter de l’opéra, à discuter et refaire le monde. Je ne pouvais m’empêcher de la dévorer du regard : j’étais en adoration devant elle. Sa façon de cligner les yeux, de replacer ses mèches de cheveux, de sourire doucement lorsqu’elle était gênée, de jouer avec ses doigts vernis avant de me poser une question. Tout chez elle me plaisait.
Je ne pensai bientôt plus qu’à elle. Au point de délaisser momentanément l’écriture de mon livre.
— Vous avez l’air complètement ailleurs, mon pauvre Joël, me disait Denise en constatant que je n’écrivais plus une ligne.
— C’est à cause de Sloane, expliquais-je derrière mon ordinateur éteint.
Je n’attendais que le moment de la retrouver et de poursuivre nos interminables conversations. Je ne me lassais pas de l’écouter me raconter sa vie, ses passions, ses envies et ses ambitions. Elle aimait les films d’Elia Kazan et l’opéra.
Une nuit, après un dîner arrosé dans une brasserie du quartier des Pâquis, nous atterrîmes dans mon salon. Sloane contempla, amusée, les bibelots et les livres dans les bibliothèques murales. Elle s’arrêta longuement sur un tableau de Saint-Pétersbourg que je tenais de mon grand-oncle. Puis, elle s’attarda sur les alcools forts de mon bar. Elle aima l’esturgeon en relief qui ornait la bouteille de vodka Beluga, je nous en servis deux verres sur glaçons. J’allumai la radio sur le programme de musique classique que j’écoutais souvent le soir. Elle me mit au défi d’identifier le compositeur qui était en train d’être diffusé. Facile, c’était du Wagner. C’est donc sur La Walkyrie qu’elle m’embrassa et m’attira contre elle, en me murmurant à l’oreille qu’elle avait envie de moi.
Notre liaison allait durer deux mois. Deux mois merveilleux. Mais au fil desquels, peu à peu, mon livre sur Bernard reprit le dessus. D’abord je profitai des nuits où Sloane était de garde à l’hôpital pour avancer. Mais plus j’avançais, plus j’étais emporté par mon roman. Un soir, elle me proposa de sortir : pour la première fois je déclinai. « Il faut que j’écrive », expliquai-je. Au début Sloane fut parfaitement compréhensive. Elle aussi avait un travail qui parfois la retenait davantage que prévu.
Puis je déclinai une seconde fois. Là encore, elle n’en prit pas ombrage. Comprenez-moi bien : j’adorais chaque instant passé avec Sloane. Mais j’avais le sentiment qu’avec Sloane, c’était pour toujours, que ces moments de connivence se répéteraient indéfiniment. Alors que l’inspiration pour un roman pouvait partir aussitôt qu’elle arrivait : c’était une opportunité qu’il fallait saisir.
Notre première dispute eut lieu un soir de la mi-juin lorsque, après lui avoir fait l’amour, je me levai de son lit pour me rhabiller.
— Tu vas où ? me demanda-t-elle.
— Chez moi, répondis-je comme si c’était parfaitement naturel.
— Tu ne restes pas dormir avec moi ?
— Non, je voudrais écrire.
— Alors quoi, tu viens tirer ton coup et puis tu te barres ?
— Il faut que j’avance dans mon roman, expliquai-je, penaud.
— Mais tu ne vas pas passer tout ton temps à écrire, quand même ! s’emporta-t-elle. Tu y passes toutes tes journées, toutes tes soirées et même tes week-ends ! Ça devient insensé ! Tu ne me proposes plus rien.
Je sentis que notre relation risquait de s’étioler aussi vite qu’elle s’était enflammée. Il me fallait agir. C’est ainsi que quelques jours plus tard, à la veille de partir pour une tournée de dix jours en Espagne, j’emmenai Sloane dîner dans son restaurant préféré, le japonais de l’Hôtel des Bergues, dont la terrasse se trouvait sur le toit de l’établissement, offrant une vue à couper le souffle sur toute la rade de Genève. Ce fut une soirée de rêve. Je promis à Sloane moins d’écriture et plus de « nous », lui répétant combien elle comptait pour moi. Nous ébauchâmes même un projet de vacances, en août et en Italie, pays que nous aimions particulièrement tous les deux. Est-ce que ce serait la Toscane ou les Pouilles ? Nous ferions des recherches dès mon retour d’Espagne.
Nous restâmes à notre table jusqu’à la fermeture du restaurant, à une heure du matin. La nuit, en ce début d’été, était chaude. Durant tout le repas, j’avais eu cette étrange sensation que Sloane attendait quelque chose de moi. Et voilà qu’au moment de nous en aller, lorsque je me levai de ma chaise et que les employés se mirent à passer la serpillière sur la terrasse autour de nous, Sloane me dit :
— Tu as oublié, hein ?
— Oublié quoi ? demandai-je.
— C’était mon anniversaire, aujourd’hui…
En voyant mon air atterré, elle comprit qu’elle avait raison. Elle partit, furieuse. Je tentai de la retenir, me confondant en excuses, mais elle monta dans le seul taxi disponible devant l’hôtel, me laissant seul sur le perron, comme l’imbécile que j’étais, sous le regard goguenard des voituriers. Le temps de récupérer ma voiture et de rejoindre le 13 avenue Alfred-Bertrand, Sloane était déjà rentrée chez elle, avait coupé son téléphone et refusa de m’ouvrir. Je partis le lendemain pour Madrid, et pendant tout mon séjour là-bas, mes nombreux messages et mes courriels restèrent sans réponse. Je n’eus aucune nouvelle d’elle.
Je rentrai à Genève le matin du vendredi 22 juin, pour découvrir que Sloane avait rompu avec moi.
C’est madame Armanda, la concierge, qui fut la messagère. Elle m’intercepta à mon arrivée dans l’immeuble :
— Voici une lettre pour vous, me dit-elle.
— Pour moi ?
— C’est de la part de votre voisine. Elle ne voulait pas la mettre dans la boîte aux lettres à cause de votre assistante qui ouvre votre courrier.
J’ouvris immédiatement l’enveloppe. J’y trouvai un message de quelques lignes :
Joël,
Ça ne marchera pas.
À bientôt.
Sloane
Ces mots m’atteignirent en plein cœur. La tête basse, je montai jusqu’à mon appartement. Je songeai qu’au moins, il y aurait Denise pour me remonter le moral ces prochains jours. Denise, la gentille femme abandonnée par son mari au profit d’une autre, icône de la solitude moderne. Rien de tel, pour se sentir moins seul, que de trouver plus esseulé que soi ! Mais en pénétrant chez moi, je tombai sur Denise qui semblait s’en aller. Il n’était même pas midi.
— Denise ? Où allez-vous ? lui demandai-je pour toute salutation.
— Bonjour, Joël, je vous avais dit que je partirais tôt aujourd’hui. J’ai mon vol à 15 heures.
— Votre vol ?
— Ne me dites pas que vous avez oublié ! Nous en avions parlé avant votre départ pour l’Espagne. Je pars à Corfou avec Rick pour quinze jours.
Rick était un type que Denise avait rencontré sur Internet. Nous avions effectivement discuté de ces vacances. Cela m’était complètement sorti de la tête.
— Sloane m’a quitté, annonçai-je.
— Je sais, je suis vraiment désolée.
— Comment ça, vous savez ?
— La concierge a ouvert la lettre que Sloane lui a laissée pour vous et m’a tout raconté. Je ne voulais pas vous l’annoncer à Madrid. »
Extrait
« Bernard était un grand éditeur, dis-je. Mais il était aussi beaucoup plus que ça. Il était un grand homme, doté de toutes les supériorités, qui avait eu, au cours de sa carrière dans l’édition, plusieurs vies. À la fois homme de lettres et grand érudit, il était également un redoutable homme d’affaires, doté d’un charisme et d’un talent de conviction hors du commun : il eût été avocat, tout le barreau parisien était au chômage. Il y avait eu une époque pendant laquelle Bernard avait été le patron, craint et respecté, des plus importants groupes d’édition français, tout en étant proche de grands philosophes et d’intellectuels du moment, ainsi que d’hommes politiques au pouvoir. Dans la dernière partie de sa vie, après avoir régné sur Paris, Bernard s’était mis en retrait sans perdre une once de son aura : il avait créé une petite maison d’édition, à son image : modeste, discrète, prestigieuse. C’était le Bernard que j’avais connu, moi, lorsqu’il m’avait pris sous son aile. Génial, curieux, joyeux et solaire : il était le maître dont j’avais toujours rêvé. Sa conversation était scintillante, spirituelle, allègre et profonde. Son rire était une leçon permanente de sagesse. Il connaissait tous les ressorts de la comédie humaine. Il était une inspiration pour la vie, une étoile dans la Nuit. » p. 26-27
À propos de l’auteur
Joël Dicker est né en 1985 à Genève où il vit toujours. Ses romans sont traduits dans le monde entier et sont lus par des millions de lecteurs. Son œuvre a été primée dans de nombreux pays. En France, il a reçu le Prix Erwan Bergot pour Les Derniers Jours de nos pères, puis le Prix de la vocation Bleustein-Blanchet, le Grand prix du roman de l’Académie française et le Prix Goncourt des Lycéens pour La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert. Ce dernier roman a aussi été élu parmi les 101 romans préférés des lecteurs du Monde et a été adapté en série télévisée par Jean-Jacques Annaud. Il a publié en 2015 Le Livre des Baltimore, en 2018 La Disparition de Stephanie Mailer et en mai 2020 L’Énigme de la chambre 622. (Source : Éditions De Fallois)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
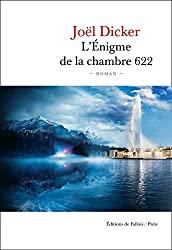


Tags:


