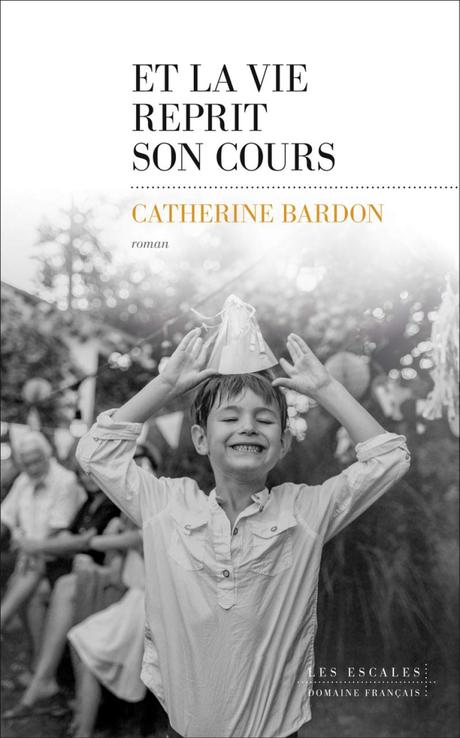


En deux mots:
Avec son ami Arturo venu lui rendre visite à Sosúa, Ruth s’offre une récréation au carnaval et tombe amoureuse de son frère Domingo. Une passion brûlante qui s’achève avec un mariage rassemblant toute la famille et les connaissances. Une occasion rêvée pour faire le point sur leurs parcours respectifs.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
Ruth fonde une famille
Le troisième volet de la saga dominicaine de Catherine Bardon couvre les années 1967-1979. L’occasion pour Ruth, la narratrice, de trouver l’amour et d’affronter de nouveaux défis. On la suit avec toujours autant de plaisir.
«Il y avait là deux continents, quatre pays, cinq langues, trois générations. Comme Wilhelm Rosenheck aurait été fier de cette belle et grande famille née de son exil et du sacrifice de sa terre natale.» À l’image de l’émotion qui étreint Ruth qui retrouve tous les membres de sa tribu à Sosúa à l’occasion de son mariage, le lecteur qui l’a suivie depuis Les déracinés à l’impression de faire partie de la noce. Pour un peu, il lèverait son verre avec eux, heureux de partager ce moment de bonheur. Car il sait ce qu’ils ont enduré depuis cet exil en République dominicaine dans les sombres années de l’Anschluss.
La belle histoire de ce troisième tome commence avec l’arrivée sur l’île d’Arturo, son ami pianiste installé à New York. Le jeune homme est venu passer quelques jours auprès de sa famille – de riches industriels du tabac – et retrouver Ruth. Il était pourtant loin d’imaginer que son escapade au carnaval avec son frère Domingo aboutirait à un mariage. Faisant fi des conventions – inutile d’ajouter qu’elle nous avait habitué à ça – Ruth se laisse aller dans les bras de cet homme marié et plonge à corps perdu dans une «passion folle, impétueuse, exaltée, excessive même.»
Un tourbillon qui va tout balayer en quelques mois et trouver son apothéose dans ce mariage célébré en novembre 1967, quelques mois après la fin de la Guerre des six jours que la branche des émigrés installés en Israël a vécu au plus près.
Car Catherine Bardon – comme dans les précédents épisodes – profite de cette chronique qui embrasse la période de 1967 à 1979, pour revenir sur les faits historiques marquants qui vont toucher de près la diaspora. On se souvient qu’après avoir joué L’Américaine (qui vient de paraître en poche chez Pocket), Ruth avait choisi de revenir en République dominicaine pour poursuivre l’œuvre de son père et diriger le journal de Sosúa. Elle est donc aux premières loges pour commenter les soubresauts du monde, notamment quand ceux-ci touchent directement la communauté. Au choc de l’assassinat de Martin Luther King succéderont les images du premier homme sur la lune, puis celles terribles de cette guerre au Vietnam qui n’en finit pas.
Bien entendu, elle ne pourra laisser sous silence les accords de Camp David et cette photo chargée de tant d’espoirs rassemblant Jimmy Carter, Anouar El Sadate et Menahem Begin, espoir douché à peine une année plus tard par la sanglante prise d’otages aux J.O. de Munich.
Aux bras de son mari, Ruth nous fait aussi partager son quotidien et nous raconte la vie sur ce bout de terre des Caraïbes et la chape de plomb imposée par le dictateur Balaguer. Je vous laisse notamment vous régaler des péripéties engendrées par la visite de Jacques Chirac en 1971 et la course à un objet de l’ethnie tainos à offrir à ce grand amateur d’arts premiers.
Et le roman dans tout ça? J’y viens, d’autant plus qu’il occupe la part prépondérante du livre, comme le titre le laisse du reste suggérer. Lizzie, l’amie d’enfance de Ruth, qui avait émigré aux États-Unis et avait rejoint le flower power en Californie, lui a fait la surprise d’être présente à son mariage. Mais derrière l’excentricité se cachait la gravité. C’est une personne malade qu’elle accueille chez elle et qu’elle entend aider. Et pour que la vie reprenne son cours paisible, il faut aussi que Gaya, la fille de Christopher, accepte son beau-père. Disons simplement qu’un voyage aux États-Unis servira à dénouer ce problème, avec une belle surprise à la clé.
Catherine Bardon se régale et nous régale. Elle est passée maître dans l’art de faire rebondir son récit, de mettre tour à tour les différents protagonistes au premier plan, de faire brusquement rejaillir le passé, comme par exemple quand un tableau de Max Kurzweil se retrouve dans une galerie de Tel-Aviv…
Et si un quatrième tome est déjà programmé, la romancière aimerait bien s’affranchir de sa famille dominicaine pour se lancer dans une autre histoire, totalement différente. En attendant, ne boudons pas notre plaisir !
Voici, avec l’aimable complicité de Catherine Bardon, quelques bonus…
 «Notre plage faisait toujours le même effet à ceux qui la découvraient. C’était magique. Les yeux s’arrondissaient, les lèvres dessinaient un oh ou un ah d’admiration. Puis venait l’envie irrépressible de courir vers la mer, d’enfouir ses pieds dans le sable tendre et de laisser l’eau lécher les orteils.» (extrait de Et la vie reprit son cours) © Catherine Bardon
«Notre plage faisait toujours le même effet à ceux qui la découvraient. C’était magique. Les yeux s’arrondissaient, les lèvres dessinaient un oh ou un ah d’admiration. Puis venait l’envie irrépressible de courir vers la mer, d’enfouir ses pieds dans le sable tendre et de laisser l’eau lécher les orteils.» (extrait de Et la vie reprit son cours) © Catherine Bardon
Liste des personnages
Les Rosenheck: Wilhelm est né à Vienne en 1906. Ses parents, Jacob et Esther, sont décédés pendant la Shoah. En 1935 il a épousé Almah Kahn (née en 1911). Almah et Wilhelm ont eu un fils, Frederick, en octobre 1936. Ils ont quitté l’Autriche en décembre 1938 et sont arrivés à Sosúa, en République dominicaine, en mars 1940. Leur fille Ruth est née le 8 octobre 1940. Leur fille Sofie, née en décembre 1945, n’a vécu que cinq jours. Wilhelm est mort des suites d’un accident de voiture en juin 1961.
Myriam: sœur de Wilhelm. Née en 1913, elle a épousé Aaron Ginsberg, architecte, en mai 1937. Juste après son mariage, le couple a quitté l’Autriche pour émigrer aux États-Unis. Ils vivent à Brooklyn et ont un fils, Nathan, né en septembre 1955.
Svenja Reisman: Autrichienne d’origine polonaise, psychologue, elle est arrivée à Sosúa en mai 1940 avec son frère Mirawek, juriste. Ils ont quitté Sosúa en juillet 1949 pour s’établir en Israël. Svenja a épousé Eival Reisman, médecin, rencontré dans un kibboutz. Ils vivent à Jérusalem. Mirawek occupe de hautes fonctions dans le gouvernement israélien.
Markus Ulman: né en 1909, il est autrichien. Juriste et comptable, il est arrivé à Sosúa en mars 1941. Il est devenu l’ami de Wilhelm. Il a épousé Marisol, une Dominicaine originaire de Puerto Plata, en mars 1943.
Liselotte Kestenbaum: née en 1939, arrivée à Sosúa en décembre 1944 avec ses parents, Lizzie est l’amie d’enfance de Ruth. Ses parents se sont séparés et elle a émigré aux États-Unis avec sa mère Anneliese en 1959.
Jacobo: c’est le régisseur de la finca des Rosenheck. Sa femme Rosita s’occupe de la maison. Il est le fils de Carmela, une vieille Dominicaine dont Almah a fait la connaissance en mai 1940.
Arturo Soteras: benjamin d’une riche famille dominicaine d’industriels du tabac de Santiago, il est devenu l’ami de Ruth lors de leurs études à New York où il vit désormais. Il est pianiste et professeur de musique à la Julliard School.
Deborah: fille d’une famille de cultivateurs aisés du Midwest, c’est une amie d’université de Ruth.
Et la vie reprit son cours
Catherine Bardon
Éditions Les Escales
Roman
352 p., 19,90 €
EAN 9782365695176
Paru le 28/05/2020
Où?
Le roman se déroule en République dominicaine. Mais on y voyage aussi principalement de et vers Israël et les États-Unis.
Quand?
L’action se situe de 1967 à 1979.
Ce qu’en dit l’éditeur
LA SAGA LES DERACINES
Après Les Déracinés et L’Américaine, découvrez le troisième tome de la superbe fresque historique imaginée par Catherine Bardon. Au cœur des Caraïbes, en République dominicaine, la famille Rosenheck ouvre un nouveau chapitre de son histoire.
Jour après jour, Ruth se félicite d’avoir écouté sa petite voix intérieure : c’est en effet en République dominicaine, chez elle, qu’il lui fallait poser ses valises. Il lui suffit de regarder Gaya, sa fille. À la voir faire ses premiers pas et grandir aux côtés de ses cousines, elle se sent sereine, apaisée. En retrouvant la terre de son enfance, elle retrouve aussi Almah, sa mère, l’héroïne des Déracinés. Petit à petit, la vie reprend son cours et Ruth – tout comme Arturo et Nathan – sème les graines de sa nouvelle vie. Jusqu’au jour où Lizzie, son amie d’enfance, retrouve le chemin de Sosúa dans des conditions douloureuses.
Roman des amours et de l’amitié, Et la vie reprit son cours raconte les chemins de traverse qu’emprunte la vie, de défaites en victoires, de retrouvailles en abandons.
Guerre des Six-Jours, assassinat de Martin Luther King, chute de Salvador Allende… Catherine Bardon entrelace petite et grande histoire et nous fait traverser les années 1960 et 1970. Après Les Déracinés, salué par de nombreux prix, et le succès de L’Américaine, elle poursuit sa formidable fresque romanesque.
«La saga qui nous transporte.» Olivia de Lamberterie, ELLE
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Bande-annonce de Et la vie reprit son cours de Catherine Bardon © Production éditions Les Escales
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« Prologue
Je tirai sur les rênes, un coup sec, et j’arrêtai mon cheval. Je pris une profonde inspiration, relâchai tous les muscles de mon corps. La vue, les parfums, les sons, c’était une symphonie pour les sens. Un instant parfait dans les couleurs pâles du petit matin de l’hiver caraïbe.
À l’aube de ce premier jour, je m’étais réveillée avec les lueurs du jour naissant. Dressée sur ses jambes potelées, agrippée aux barreaux de son petit lit de bois, Gaya jouait à l’ascenseur, enchaînant les flexions, une deux, une deux, en gazouillant. Je l’avais changée en vitesse, j’avais passé un pantalon, une chemise, enfilé une paire de bottes, serré ma fille contre moi dans son écharpe de portage, puis j’avais sellé un cheval.
Je m’étais arrêtée un instant avant de talonner ma monture. De notre ferme perchée au sommet de sa colline, on voyait les propriétés alentour et tout le village en contrebas, puis le regard filait vers la mer dont le turquoise encore incertain virait au bleu profond et se perdait au loin, butant contre l’azur du ciel.
C’était notre terrain de jeu, les champs, les pâturages, le village, la plage… C’est là où j’étais née, c’est là où j’avais grandi, c’est là où j’avais choisi de vivre. Chaque parcelle de mon âme appartenait à cette île. Je n’avais plus d’états d’âme, j’étais Ruth Rosenheck, j’étais née à Sosúa, j’étais dominicaine, je parlais l’espagnol, l’anglais et l’allemand et même quelques bribes d’hébreu, j’aimais les quatuors à cordes de Schubert et les merengues de Julio Alberto Hernández, je dansais la valse et la bachata, j’étais blanche, blonde et juive dans un pays de métis catholiques, j’avais des amis, éparpillés aux quatre coins du monde.
À regarder le paysage paisible du haut de la colline, le ciel bosselé de nuages douillets, le bétail essaimé dans les lomas ondulantes piquetées de cocotiers, la mer étale, déjà scintillante dans son écrin de sable blanc, le village endormi sous le soleil levant, on aurait pu croire que rien n’avait changé. J’aurais pu avoir l’illusion que je reprenais ma vie là où je l’avais laissée six ans auparavant. « Tu as ta propre vie à construire, loin des scories des nôtres », m’avait dit ma mère quand j’étais partie. Et voilà, j’étais de retour.
Un cri suraigu, comme seuls en émettent les tout petits enfants, accompagné d’une gesticulation désordonnée de petites jambes et de petits bras me vrilla les tympans et me ramena à la réalité. Gaya se manifestait.
L’illusion vola en éclats. Tout avait changé. Rien n’était plus comme avant. Mon frère s’était marié, la famille s’était agrandie, il avait deux enfants, j’en avais un.
Je posai un baiser sur le sommet du crâne finement duveté de noir, sur cet espace si fragile où une dépression à peine perceptible disait que Gaya n’était encore qu’un bébé. Je resserrai l’étreinte de mes jambes autour du ventre du cheval et enfonçai fermement mes talons dans ses flancs. Après quelques pas, ma monture prit le trot sur la piste poussiéreuse. Gaya laissa échapper de légers hoquets de pur ravissement. Ses petites mains battaient l’air, elle gloussait de plaisir à chaque soubresaut.
*
Je guidai le cheval dans l’étroite sente creusée dans la pierre corallienne qui descendait à la plage et l’arrêtai face à la mer. Elle était toujours là, la plage de mon enfance. Telle qu’en mon souvenir, immense bande de sable blanc en croissant, ombragée de raisiniers et d’amandiers, ourlée d’une eau transparente qu’un soleil triomphant ferait bientôt miroiter implacablement.
Sur ma droite, se dressaient les pilotillos, tout ce qui restait d’une ancienne jetée où s’amarraient autrefois les navires de la United Fruit Company pour charger leur cargaison de fruits tropicaux. La mer ne les avait pas épargnés. Rongés par l’érosion, ils me parurent désespérément petits. Les fières et hautes colonnes de mon enfance n’étaient plus que des piles incertaines, aux contours irréguliers, sapées par l’assaut permanent de la mer. Je reconnus les vieux bancs de béton du bañadero, haut lieu de la vie sociale, usés par des générations de fessiers, le grand álamo vigoureux dont les feuilles en décoction soulageaient de bien des maux, les massifs de coraux de la islita grouillant de vie sous-marine qui affleuraient au loin…
Sans que j’y prenne garde, les souvenirs commencèrent à déferler. Des émotions mêlées m’envahirent. Je sentis mon cœur se gonfler.
Je me souvenais.
Je chassai les images et je mis pied à terre, conduisant le cheval jusqu’à un amandier où j’attachai les rênes à une branche basse. Je me déchaussai et j’avançai jusqu’à l’eau. Le sable était encore frais de la nuit, une caresse. Gaya s’agitait, roucoulant de petits mots dans son sabir incompréhensible. Je dénouai l’écharpe qui la retenait prisonnière et la déposai sur le sable.
Sans réfléchir, je la déshabillai, et moi ensuite. Je n’avais pas prévu de maillots de bain, nous étions nues sur la plage. Je rattrapai Gaya, déjà dans l’eau jusqu’au cou, et entamai une danse tribale à grands coups de sauts et d’éclaboussures. C’était le bain le plus délicieux que j’avais pris depuis une éternité. Gaya riait, renversait sa tête en arrière et battait l’eau de ses menottes. Et m’échappa. Je la vis se débattre sous l’eau puis se calmer. Elle flottait juste sous la surface et… nageait, agitant lentement bras et jambes. Ma fille de deux ans nageait aussi naturellement qu’un de ces minuscules poissons colorés qui s’ébattaient autour de son corps aux contours rendus flous par ses mouvements. Elle s’ébroua pour reprendre sa respiration, je la rattrapai. Ma fille nageait, et j’y vis un signe, un bon signe.
Bien des années plus tard, quand Gaya me demanderait de lui raconter cette première chevauchée, je n’omettrais aucun détail, ses cheveux fins comme du duvet, le parfum de vanille de son cou, la chaleur de son petit corps contre mon ventre, ses minuscules menottes qui battaient l’air, son instinctive nage sous l’eau. Nous tomberions d’accord : cette première chevauchée, ce premier bain avaient décidé de sa destinée.
*
Nous reprîmes le chemin de la ferme. Mes cheveux dégoulinaient dans mon cou. Sur mes lèvres, un goût de sel. Je remontai par cette piste de terre qui avait eu raison de mon père quelques années plus tôt. Les clôtures des pâturages avaient été renforcées, c’étaient maintenant de hautes et solides palissades de bois sombre. Infranchissables par le bétail. Blottie au sommet de sa colline, la ferme semblait encore endormie.
J’aimais la beauté pure de la terre resplendissante, j’aimais cette lumière d’une limpidité sans pareille, j’aimais la puissance des couleurs crues, le jeu des formes aussi abondantes que tumultueuses, j’aimais l’air embaumant les multiples fragrances des tropiques, j’aimais ces paysages pleins de poésie enfantine…
En observant le spectacle de ce matin-là, je commençai à guérir d’un mal dont je ne savais même pas que j’avais souffert, le manque de mon île.
Je sentis une énergie incroyable m’animer. Je débordais d’un enthousiasme neuf que rien ne pourrait battre en brèche. J’avais des projets plein la tête, des projets qui s’étaient forgés au fil de ces six années passées entre les États-Unis et Israël, sans que j’en eusse véritablement conscience.
Remettre à flot le journal de mon père. En faire un quotidien digne de ce nom, qui compterait dans le panorama médiatique du pays.
Me faire un nom dans le journalisme.
Aider ma mère à développer sa fondation humanitaire.
Soutenir son projet fantaisiste avec Markus, cet atelier de menuiserie qui produisait des fauteuils Adirondack qui n’intéressaient personne.
Et surtout, je voulais offrir à ma fille une enfance de radeaux, de plongeons, d’explorations sous-marines, d’élevages de têtards, de chevauchées fantastiques, de cabanes dans les arbres… Oui, Je voulais que ma fille grandisse ici, dans cet endroit si paisible et si beau.
J’avais enfin reconnu notre place, c’étaient la terre, le ciel et la mer qui me le disaient.
Quand je franchis le portique de la finca Polka, je croisai Jacobo. Dans son fourreau de cuir, sa machette battait sa cuisse au rythme des pas de son mulet. Il leva la main et me décocha un grand sourire: «Hola amores, qué tal las princesas?»
Oui, nous étions les princesses de Sosúa.
Finalement rien n’avait changé. »
Extrait
« Jérusalem, juillet 1967
Chère Almah,
Cette courte lettre pour te rassurer.
Une guerre de plus.
Il est donc écrit que nous ne vivrons jamais en paix. Nous aurions pu croire, après ce que nous avons traversé, particulièrement notre peuple, que le monde serait plus sage. Nous aurions tant aimé qu’il soit plus sage, comme nous aspirions si fort à la paix. Et nous allons de déception en déception. Plus que jamais je pense que la guerre est une fatalité et la paix une utopie.
Le pire c’est qu’ici les Israéliens sont euphoriques, malgré les horreurs commises dans les deux camps. Il y a eu un terrible pogrom à Tripoli et certains des 4 000 Juifs libyens sauvés par le Joint sont arrivés ici après avoir transité par l’Italie. Notre victoire est totale, notre supériorité avérée, le pays s’est agrandi de façon spectaculaire. Les images des soldats au Mur des lamentations tournent en boucle. Aux dires des politiques, Jérusalem est enfin libérée. Moi, je préfère dire réunifiée.
Mais à quel prix ? Plus de 20 000 vies, sans compter les dizaines de milliers de blessés, avons-nous le droit de nous en réjouir ? Je suis infiniment triste et j’ai honte. Entre libération et conquête, où est la vérité ?
Entre votre guerre et les nôtres, l’horreur n’en finit jamais. Parfois j’ai envie de me retirer dans un ashram et de vivre ce qui me reste de temps loin du tumulte des hommes. M’accompagnerais-tu ? Ce serait enfin notre repos des guerrières !
Je t’embrasse très fort, Almah,
en souhaitant nous voir bientôt réunies,
Svenja
P.-S. : Tu ne trouves pas que notre Moshe Dayan a l’air d’un pirate ?
Cette lettre qui suintait le découragement ne ressemblait pas à Svenja. L’écriture était hachée, les lignes se tordaient comme sous l’effet de la colère ou du chagrin. Seul le post-scriptum ressuscitait un peu son ancienne verve.
Almah était peinée pour son amie. Elle non plus n’approuvait pas la politique conquérante d’Israël, même si, par loyauté, elle la soutenait. Il y avait des combats justes, mais la politique était une affaire complexe dont les enjeux les dépassaient, et celle d’Israël plus encore. Une ride se creusa au milieu de son front qu’elle effaça en décidant de se concentrer sur les préparatifs de la fête à venir. »
À propos de l’auteur
Catherine Bardon est une amoureuse de la République dominicaine où elle a vécu de nombreuses années. Elle est l’auteure de guides de voyage et d’un livre de photographies sur ce pays. Son premier roman, Les Déracinés (Les Escales, 2018 ; Pocket, 2019), a rencontré un vif succès. (Source: Éditions Les Escales)
Commandez les livres en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
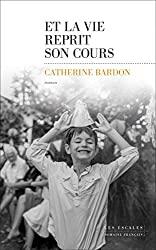
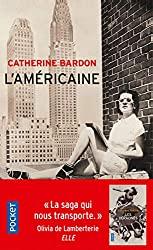
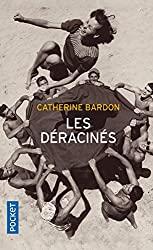








Tags:


