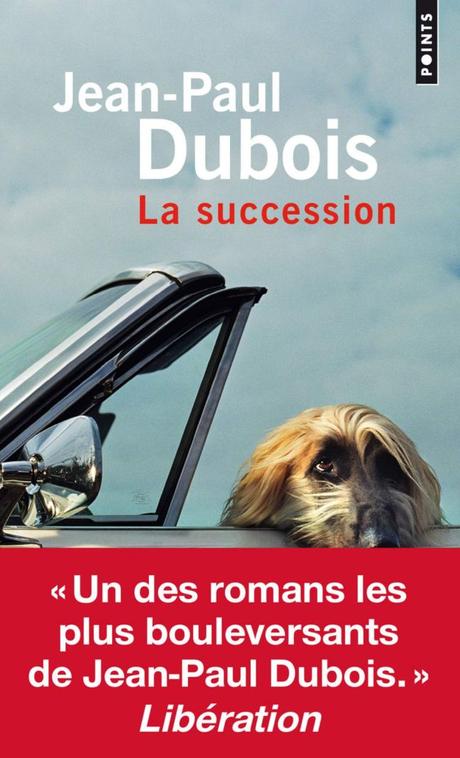
En deux mots:
Paul Katrakilis doit oublier sa vie de pelotari à Miami pour enterrer son père à Toulouse et se confronter à la tragédie familiale des suicides en série. Un très grand roman !
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Si vous voulez en savoir plus…
Ma chronique complète publiée lors de la parution du roman en grand format
Les premières lignes
« Tous les jours, le bonheur
Ce furent des années merveilleuses. Quatre années prodigieuses durant lesquelles je fus soumis à un apprentissage fulgurant et une pratique intense du bonheur. Il m’avait fallu attendre vingt-huit ans pour éprouver chaque jour cette joie d’être en vie au petit matin, de courir pour polir mon souffle, de respirer librement, de nager sans peur, et de ne rien espérer d’autre d’une journée sinon qu’elle m’accompagne comme l’on promène une ombre et que le soir venu elle me laisse en l’état, simplement satisfait, abruti de quiétude et de paix loin de ce territoire désarticulé que j’avais abandonné, et surtout loin de ceux qui m’avaient mis au monde par des voies naturelles, m’avaient élevé, éduqué, détraqué et sans aucun doute transmis le pire de leurs gènes, la lie de leurs chromosomes.
Sur ce dernier point je sais parfaitement ce dont je parle.
De la mi-novembre 1983 au 20 décembre 1987, je fus donc un homme profondément heureux, comblé en toutes choses et vivant modestement des revenus que me procurait la pratique du seul métier que j’aie jamais rêvé d’exercer depuis mon enfance : pelotari.
En Floride, et surtout au Jaï-alaï de Miami, j’ai fait partie de ce petit cercle de professionnels de la pelote basque rétribués à l’année pour danser sur les murs, jouer du grand gant, fendre l’air avec une cesta punta et propulser des balles de buis cousues de peau de chèvre à 300 km/h sur le plus grand fronton du monde – un Vatican peuplé de cent papes aux mains d’osier – frôlé par les avions de l’aéroport de Miami International, et fréquenté alors par ce qui se faisait de mieux dans une ville qui, il faut bien le reconnaître, n’avait jamais été trop regardante sur la fabrique de son aristocratie.
Pour pratiquer dans cette arène aux trois murs peints du vert profond des océans basques, pour jouer à ce rythme, à un tel niveau, faire simplement partie de la liturgie, j’aurais autrefois engagé des fortunes. Et voilà qu’au contraire j’étais rémunéré par contrat, à l’année, pour mitrailler ces murs et faire hurler de joie dix ou quinze mille types qui avaient parié sur moi le temps d’une quiniela avant de choisir de miser l’instant d’après sur un autre arrière. Pour cette foule de parieurs je n’étais rien d’autre qu’un support de pari mutuel, un chien de cynodrome, un bourrin d’hippodrome. Mais cette condition me convenait. Je ne jouais jamais pour eux, mais pour moi. Comme quand j’étais enfant, autiste, coupé du monde, lové dans mon gant, agrippé à ma pelote, martelant sans fin les frontons libres d’Hendaye, de Saint-Jean-de-Luz ou d’Itxassou.
Et puis, sachant d’où je venais, même un statut de modeste trotteur crottant du dollar çà et là, faisait mon affaire. J’avais passé mon enfance à travailler, étudier, apprendre des choses inutiles et insensées sous le regard étrange d’une famille restreinte de quatre personnes totalement déroutantes, déboussolées et parfois même terrifiantes.
Mon grand-père, Spyridon Katrakilis, prétendait entre autres faits d’armes avoir été l’un des médecins de Staline et posséder une fine lamelle de son cerveau dérobée lors de l’autopsie qu’il avait lui-même pratiquée plusieurs jours après l’hémorragie cérébrale de Vissarionovitch Djougachvili. Il se suicidera en 1974 dans de singulières conditions.
Mon père, Adrian Katrakilis, également praticien, faisait valoir des singularités moins exotiques mais n’en était pas moins un homme assez inquiétant. Il disait souvent des choses incompréhensibles, criait « strofinaccio » à tue-tête et sans raison – mot qui veut dire « bout de chiffon » en italien – et avait pour habitude de recevoir ses patients en short dès les premiers beaux jours. Cette excentricité ne datait pas d’hier puisque pendant ses études, lorsqu’il assurait des gardes de nuit à l’hôpital, il était réputé pour avoir examiné ses patients en slip.
Anna Gallieni, ma mère, ne remarquait pas vraiment les singularités de son mari, et ne s’en inquiétait pas le moins du monde. Elle avait suffisamment à faire auprès de son frère cadet, Jules, avec qui elle partageait un petit magasin familial dédié à la réparation de montres en tout genre. Avec ce frère, elle vivait avec nous dans la maison commune. Avec ce frère, sur le canapé, elle regardait aussi tous les soirs la télévision jusqu’à ce que Jules s’endorme et pose sa grosse tête dans le creux de l’épaule de sa sœur. Jules était toujours collé à Anna et Anna toujours auprès de Jules.
Ce dernier mit fin à ses jours au printemps 1981. Ma mère l’imita au début de l’été dans une mise en scène qui laissa mon père perplexe sans que cela semble pour autant l’affecter.
Enfant, je grandis donc devant Spyridon qui marinait devant sa tranche de cervelet, un père court vêtu vivant comme un célibataire, et une mère quasiment mariée à son propre frère qui aimait dormir contre sa sœur et devant les litanies de la télévision. Je ne savais pas ce que je faisais parmi ces gens-là et visiblement, eux non plus.
Certes, les suicides de tous les miens mettront un peu d’ordre dans la confusion de ces liens, ces apparentements désordonnés, cette inaptitude à s’aimer et à donner à un enfant ne fût-ce que l’image d’un peu de confiance et de bonheur. Le plus étrange, c’est que la mort traversa à plusieurs reprises notre maison et les survivants s’en aperçurent à peine, la regardant passer comme une vague femme de ménage. »
L’avis de… Michel Abescat (Télérama)
« On rit et on pleure de tout cela, une fois encore, sans savoir si l’auteur invente ou s’inspire de la fantaisie du réel et l’on apprécie hautement l’exercice de funambule entre légèreté, cocasserie et gravité. Le roman pourtant semble grignoté par la nuit, plus sombre que les précédents, profondément mélancolique. Décidément marqué par le masque de Scotch rougi qui brûle en son centre. »
Vidéo
Jean-Paul Dubois présente La succession. © Production Librairie Mollat
Tags:

