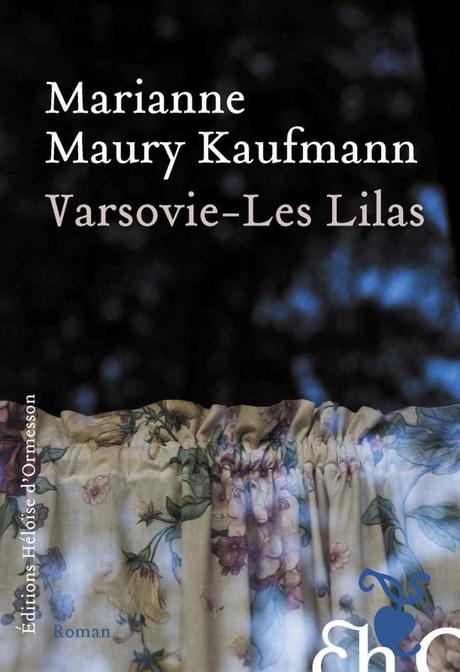



Sélectionné par les « 68 premières fois »
Sélectionné pour le « Prix Orange du livre 2019 »
En deux mots:
Francine passe sa vie dans le bus qui relie La porte des lilas à la gare Montparnasse. Parce que Francine ne peut rester sans bouger, parce que Francine est une rescapée de la Shoah, parce que Francine est seule. Sauf qu’elle va faire une rencontre…
Ma note:
★★★ (bien aimé)
Ma chronique:
La femme du bus 96
Le second roman de Marianne Maury Kaufmann met en scène Francine, née le 16 mai 1939 à Varsovie. On la retrouve plus d’un demi-siècle plus tard dans un bus parisien avec qu’une rencontre ne vienne changer sa vie.
L’histoire de Francine débute bizarrement, dans le bus parisien 96, celui qui assure la liaison entre la Porte de Lilas et la Gare Montparnasse. Si par hasard vous l’empruntez un jour, vous pourriez très bien la croiser, car elle y vit. «Dire qu’elle y vit est une façon de parler, naturellement. Mais c’est presque vrai. Francine passe quasiment tout son temps dans le bus. La seule chose qu’elle n’y fait pas, c’est dormir. Si on lui proposait, d’ailleurs, il est probable qu’elle accepterait de bonne grâce d’être emportée au garage à la fin de la tournée. On ne lui propose pas. Disons que Francine vit dans le 96 le plus clair de son temps – qu’il est plus réaliste d’appeler le moins obscur.»
Car le côté obscur, Francine le porte depuis sa naissance ou presque, le 16 mai 1939, à Varsovie. Pas plus ses parents qu’elle ne devinent qu’ils n’auront guère plus d’une année de vie commune à partager. Son père s’engage dans l’armée Anders qui deviendra l’armée polonaise de l’Ouest. Sa mère, qui a obtenu son diplôme de médecin, est raflée et part avec Francine vers les camps. «Heureusement, elle ne sait pas encore que rien de ce qu’elle a rêvé n’adviendra, heureusement, elle ignore l’horreur qui le remplacera.»
Francine sera libérée, mais conservera de cette expérience ce traumatisme qui se concrétise par l’impossibilité de rester quelque part sans bouger. Imaginant peut-être qu’une vie «normale» l’aidera à surmonter ce besoin irrépressible, elle se marie. Mais son époux ne peut qu’assister impuissant à ses escapades incessantes. C’est d’abord à pied qu’elle arpente la capitale, puis les musées avant de se rabattre, l’âge venant, sur les bus. Entre temps, elle s’est retrouvée seule, ce qui n’a pas arrangé les choses.
Il y a bien son rendez-vous hebdomadaire, le repas chez Gérard et Sandra. Mais cela fait bien longtemps qu’elle considère ce rituel comme une corvée. D’ailleurs Sandra «en a marre des survivants, de leurs cicatrices et de leurs obsessions». Ce soir-là, elle pourrait leur raconter qu’elle a croisé un regard dans le bus et que cette femme a éclairé son après-midi. Mais elle préfèrera se taire. Et tenter de la revoir.
Quelques temps plus tard sa vie aura changé. «Toutes les vieilles habitudes sont obsolètes. Pleine d’une énergie neuve qu’elle ne sait à quoi employer, elle n’est plus qu’une toupie qui tourne autour de son idée fixe, dans un monde resté désespérément semblable.»
Avril, qu’elle a surnommé la Bougie en raison de sa stature très rigide, a accepté de partager sa solitude avec elle. Et même si elle est toxique, leur relation va balayer ses – mauvaises – habitudes.
Dans ce court mais percutant roman, Marianne Maury Kaufmann réussit à faire le lien entre les drames d’hier et d’aujourd’hui et à réunir les rivières souterraines qui emportent le cœur de deux femmes vers des rives mouvantes.
Varsovie-Les Lilas
Marianne Maury Kaufmann
Éditions Héloïse d’Ormesson
Roman
176 p., 16 €
EAN 9782350874869
Paru le 17/01/2019
Où?
Le roman se déroule en France, principalement à Paris. On y évoque aussi la Pologne et l’Allemagne.
Quand?
L’action se situe de nos jours, avec des retours en arrière jusqu’en 1939.
Ce qu’en dit l’éditeur
L’histoire qu’on traîne derrière soi, il faudrait pouvoir la déposer quand elle ne nous va plus. Francine la trimballe, et voudrait bien s’en délester. Mais à qui raconter? Aux psys, aux amis d’autrefois, à cette araignée de Dina? Et si elle parlait plutôt à cette drôle de fille-là, qu’elle a croisée dans le bus où elle bourlingue toute la journée? Dans Paris qui scintille, la bonne oreille n’est pas toujours celle que l’on croit!
Sur le trajet Varsovie – Les Lilas, une femme est décidée à faire triompher la vie. La vie, contre l’indicible blessure qui hante les rescapés. Guidée par sa plume énergique et tendre, Marianne Maury Kaufmann vous invite à un voyage imprévisible aux sentiers escarpés, où la vie est têtue, et belle!
68 premières fois
Blog motspourmots.fr (Nicole Grundlinger)
Blog Les livres de Joëlle
Le blog du petit carré jaune (Sabine Faulmeyer)
Les autres critiques
Babelio
Lecteurs.com
L’Yonne républicaine (Blandine Hutin-Mercier)
Blog Le boudoir de Nath
Marianne Maury Kaufmann présente Varsovie-Les Lilas © Production Librairie Mollat
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« TIENS, UN TEXTO. Francine consulte sa messagerie. Le téléphone est vieux et paresseux, les touches répondent mal et déjà pointe la mauvaise humeur, qui est, chez Francine, une touche ultrasensible. C’est sa fille, voilà qui va permettre à la mauvaise humeur de se déployer largement. Que veut-elle, Roni, à part éviter de parler de vive voix à sa mère? Le message dit: «Ça va? Baisers».
Si Roni désirait sincèrement de ses nouvelles, elle demanderait juste «Ça va?». Les baisers sont un paratonnerre. Francine pianote en retour «Ça va», elle expédie le message et referme le couvercle du téléphone, d’une tape. Tout autour de son cœur déferle alors une vague poivrée d’adrénaline. Elle aurait dû ajouter «Baisers», elle aussi. Ça se fait. Elle le sait bien. Il ne s’agit pas de s’embrasser pour de bon. Il ne s’agit même pas d’en avoir envie. Il s’agit d’une convention, la vie doit beaucoup aux conventions. Il s’agit d’un code. Et voilà, elle va se torturer pour une histoire de code. C’est extraordinaire à quel point sa fille est douée pour lui casser le moral : en trois mots, elle la fiche par terre.
Les avertisseurs du bus, ces petits coups de cloche que Francine n’entend plus d’habitude, semblent dirigés expressément vers son crâne et même vers un point précis de son crâne. C’est un peu facile. S’occuper de sa vieille mère, ça ne se limite pas à ça. Elle voit Roni comme si elle l’avait devant elle. Elle l’entend.
«J’ai encore oublié d’appeler ma mère. Je vais plutôt lui envoyer un message, ça ira plus vite.»
Et alors? Elle est où la chaleur? Francine écoute souvent des vieilles se plaindre au téléphone, raconter leurs journées, leurs résultats d’analyses. À qui d’autre qu’à leur marmaille infligent-elles ça? C’est dans l’ordre. C’est normal. À quoi ça sert d’avoir des enfants, si ce n’est à adoucir le grand âge? Elle est mal tombée, voilà tout.
Francine tripote son téléphone, et finalement elle relit sa réponse. Elle pourrait ajouter une ligne sur la météo, à la rigueur. Une ligne sur cette glu qu’ils prédisent à la radio. Comme s’il était nécessaire de la prédire vu qu’elle est déjà installée et pour six mois, ce qui est évident puisque le même phénomène se reproduit chaque année (Francine peut leur faire, leur météo). Une ligne sur ce thème, c’est une excellente idée.
Elle a commencé à rédiger, grisaille, tunnel et cetera, mais elle s’interrompt. Roni est tellement rouée qu’elle est capable de la contrer, même là-dessus. Même sur la durée de l’hiver parisien. Pour le plaisir. Pour le sport. Et puis elle vaque certainement à des affaires d’une importance supérieure, à l’instant même. D’autant plus légère qu’en envoyant son message lapidaire, elle s’est délestée d’une corvée. Le bulletin météo a toutes les chances de tomber à plat. Francine range son téléphone et se jure de ne plus y toucher. Elle regarde dehors. Le bus fonce dans le couloir qui lui est réservé, au ras des files de voitures immobilisées. Et il attrape un feu orange, et il survole un carrefour. Ils sont doués, ces chauffeurs. Parfois même, virtuoses. Dans un cahot, Francine décolle du siège. Pendant une seconde, elle se sent libre. Une seconde. Et c’est reparti. Qu’est-ce qu’ils sont nombreux, les gens, dans cette ville. Et quel spectacle ils offrent, tassés dans leurs voitures à l’arrêt. Pires que des bêtes. Elle les enjamberait bien tous, tiens, et elle traverserait Paris d’un seul bond. Son vol plané lui a remis les idées en place : il aurait été ridicule, son post-scriptum.
Cette histoire débute, donc, dans un bus. Un choix qui n’est ni arbitraire, ni facétieux. Un choix qui n’est même pas un choix, à vrai dire, mais une obligation. Car Francine vit dans le bus. Et plus précisément dans le bus numéro 96.
Dire qu’elle y vit est une façon de parler, naturellement. Mais c’est presque vrai. Francine passe quasiment tout son temps dans le bus. La seule chose qu’elle n’y fait pas, c’est dormir. Si on lui proposait, d’ailleurs, il est probable qu’elle accepterait de bonne grâce d’être emportée au garage à la fin de la tournée. On ne lui propose pas. Disons que Francine vit dans le 96 le plus clair de son temps – qu’il est plus réaliste d’appeler le moins obscur.
Les machinistes se posent sans doute parfois la question de savoir ce qui leur vaut cette compagnie, même si, à leur poste, rien n’étonne plus. En tout cas, ils ont bien compris qu’elle ne va nulle part, celle qui, après les avoir salués d’une voix basse presque d’homme, droite comme un i, bien habillée, bien coiffée, leur reste sur les bras de terminus en terminus. Ils ont aussi compris que son nulle part, elle y va seule. Elle est seule dans la vie tout court, supposent-ils. Et ils n’ont pas tort. Ils s’en coltinent tellement, de ces naufragés.
Une chose, cependant, distingue celle-ci des autres: sa façon de bondir soudain, de changer de siège sans raison apparente. Ça, on peut dire que ça la caractérise, oui. Ils sont nombreux à travailler sur la ligne, et tous ont repéré ses caprices. Ils ont repéré comment à longueur de journée cette vieille ricoche, de la rotonde à la sortie, de la sortie à l’avant, et ainsi de suite. Tous, ils savent qu’il faut s’attendre à ce qu’elle les quitte aussi soudainement et à n’importe quel point du parcours. Ils savent qu’elle plongera dehors, pour, une fois sur le trottoir, attendre que le prochain bus la cueille, un bus en tous points semblable à celui dont elle vient de s’éjecter en catastrophe. Avec un comportement pareil, ils ne peuvent pas supposer qu’elle emprunte les transports pour voyager d’un point à un autre. Il leur faut l’admettre, elle est dans le bus pour être dans le bus.
Ce qu’ils ne peuvent pas deviner, en revanche, c’est la raison de cette dépendance. Ce qu’ils ne peuvent pas deviner, c’est le vertige. Celui qui prend Francine dès qu’elle est immobile. Dès qu’elle stationne. Les chauffeurs ne peuvent pas savoir que c’est lui qui la jette en avant. Que c’est lui qui la précipite dans leurs bus et l’en expulse avec la même autorité. Le vertige qui survient irrésistiblement dès qu’elle se pose quelque part, comme une force supérieure qui veille à ce qu’il ne lui pousse jamais la moindre racine.
À l’école il est déjà là, le vertige, et on le qualifie d’indiscipline. Dieu sait qu’avec le retard qu’elle a pris dès le début de sa scolarité, Francine devrait se tenir à carreau sur son banc, au lieu de gigoter comme un poisson. Mais cette agitation n’a rien à voir avec la volonté. La preuve, c’est qu’il se passe la même chose quand elle est invitée chez ses petits camarades, d’où elle grille d’envie de repartir à peine arrivée – et comment expliquer ça sans être désagréable? Son vertige la prend même au cinéma, où elle ne visionne les films qu’avec le ventre noué de crampes, ce qui ne l’aide pas à aimer ce passe-temps.
Elle doit se déplacer. Et cette bougeotte, ce n’est ni de l’impolitesse ni de l’impatience, Dieu le sait bien, contrairement aux chauffeurs de bus.
Quand elle se marie, très jeune, avec le premier homme qui demande sa main, ils s’installent à Paris, dans l’appartement qu’elle occupe toujours. Mais hélas, le sol ne se stabilise pas pour autant. Le vertige ne desserre pas son étreinte. Les murs, sur lesquels son mari compte pour la rassurer, le toit qui pourrait, croit-il, l’en abriter, ne prémunissent pas Francine contre sa manie. Et elle les quitte, les murs et l’époux, dès le matin. Elle s’envole pour ne revenir qu’à la nuit, avec rien à raconter si ce n’est une interminable randonnée. Car à l’époque, elle marche.
Elle sillonne la ville en tous sens. Tête baissée, indifférente au décor, elle parcourt des kilomètres. Elle peut très bien trotter comme ça sans s’arrêter, et faire sa journée de huit heures comme tout le monde. Toutefois, comme tout le monde également, elle ressent la plupart du temps la nécessité d’avoir un but. Alors elle fréquente les musées, où elle rejoint d’autres désœuvrés dans son genre. La beauté des œuvres ne l’atteint pas, la beauté, elle ne sait pas ce que c’est. Mais pour se distraire et avoir un but à l’intérieur du but, elle note la date et la provenance des œuvres. Elle accomplit ainsi, sans oublier un seul recoin, le tour de toutes les salles. Puis elle ressort, la tête farcie comme un pense-bête, soulagée que rien ne l’ait retenue.
S’il n’y a pas de musée sur sa trajectoire, elle peut faire des achats. Mais comme elle se sent encore moins à l’aise dans les magasins qu’au milieu des tableaux, elle ne prend aucun risque et s’arrête toujours dans les mêmes boutiques. Là, imitant les autres, elle achète. Elle achète en se posant beaucoup de questions, et emporte toujours un reçu qui lui permettra d’échanger au cas où elle s’apercevrait qu’elle a pris n’importe quoi, ce qui arrive toujours, et c’est tant mieux car ces allers-retours gonflent bien son emploi du temps. Et la cavalcade reprend, rive gauche, rive droite.
Ce marathon n’ayant rien d’un choix.
Enfin, petit à petit, l’âge venant et la fatigue avec, Francine prend l’habitude des bus. Intra-muros, il n’y a pas une ligne qu’elle n’ait empruntée. Et comme un dé, elle roule d’un quartier à l’autre, au hasard des correspondances. Elle roule tandis que la ville s’ébroue, se parfume, part travailler, déjeune, travaille encore, ne sent plus si bon, traîne avant l’heure du dîner, bâille, met ses chaussons et s’endort. Dans tous les quartiers c’est la même routine, le même tempo, le monde qui roule du matin au soir et Francine qui roule dans son sillage. Alors finalement, pour l’usage qu’elle en fait, un bus en valant un autre, un beau jour elle décide de se cantonner au 96, qui présente l’avantage de passer juste en bas de chez elle.
Ça fait des années maintenant qu’elle tourne à son bord. Des années de microbes dégelés en hiver, de sueur en été. Des années à préférer le sens de la marche, à privilégier la place côté couloir, d’où l’on peut déguerpir facilement. Des années bercées au son du diesel, seul capable d’endormir le grondement si ancien qui enfle de nouveau lorsque le soir, Francine gravit les marches de l’escalier menant à l’appartement, et s’apprête à affronter le silence. Un silence qui a pris ses quartiers du temps de Jean.
Jean, ce fut pourtant sa chance. Lui qui l’aima au point de la délester de tout tracas et de toute responsabilité. Lui qui prit toutes les décisions à sa place, comme celle d’avoir un enfant, idée qui jamais ne serait venue à Francine. »
Extrait
« Francine est née le 16 mai 1939, à Varsovie. Le soir même, le rabbin consigne sa naissance. Sur son registre, il inscrit «Edda», un prénom qui ne servira pas longtemps, vite jugé un peu trop voyant (c’est toute la complexité des biographies des personnes nées dans ces années-là, vers ces endroits-là). Edda-Francine portera également, durant les six premières années de sa vie, plusieurs noms de famille. Des noms qu’on lui fait répéter jusqu’à ce qu’elle les sache par cœur et qu’ils écrasent le précédent, avant de la prier de les oublier à jamais. Des noms qu’adulte elle entend encore parfois, ressurgissant à l’improviste, comme des chemises froissées du fond d’une armoire.
Elle arrive donc ce jour de printemps, et fait la joie de ses parents. Son père est un oto-rhino-laryngologiste aux yeux bleus. Francine ne saura jamais rien de plus sur lui, si ce n’est qu’il a le sens patriotique, mais pas celui de la famille. Sa mère, Dorota, a vingt-cinq ans lorsqu’elle accouche. Elle vient d’obtenir son diplôme de médecin et de s’inscrire à une spécialisation en gynécologie qu’elle ne pourra jamais faire. Ces deux-là, fraîchement débarqués à la capitale, se sont rencontrés un an plus tôt à Radom.
L’été passe. La panique règne. Les magasins, les écoles, les cafés ferment. Puis c’est l’automne et Varsovie devient le pire endroit sur terre. Encerclée, affamée, brûlée et bombardée par les nazis, elle finit par se rendre, et une nuit glaciale de novembre, les parents de Francine embarquent avec leur bébé à l’arrière d’un camion dont ils ont payé le chauffeur pour qu’il les conduise à Lwów, qui est sous contrôle soviétique. La vie de famille s’achève peu de temps après leur arrivée, lorsque le père de Francine s’engage dans l’armée Anders, basée sur le sol russe. Il part sans soupçonner le voyage fou qui l’emportera jusqu’en Palestine, ni sa durée ni son issue. Il part pour toujours mais il ne le sait pas, et avant de prendre congé d’elle il rassure son épouse.
«Ce ne sera pas bien long», lui dit-il. »
À propos de l’auteur
Marianne Maury-Kaufmann est l’auteur de Pas de chichis! et Dédé, enfant de salaud publiés en 2013 et 2014. Varsovie – Les Lilas est son deuxième roman. Elle est également illustratrice de presse et tient la chronique hebdomadaire «Gloria» dans Version Femina. (Source: Éditions Héloïse d’Ormesson)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
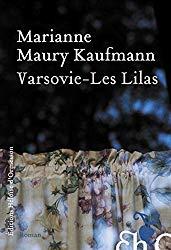


Tags:


