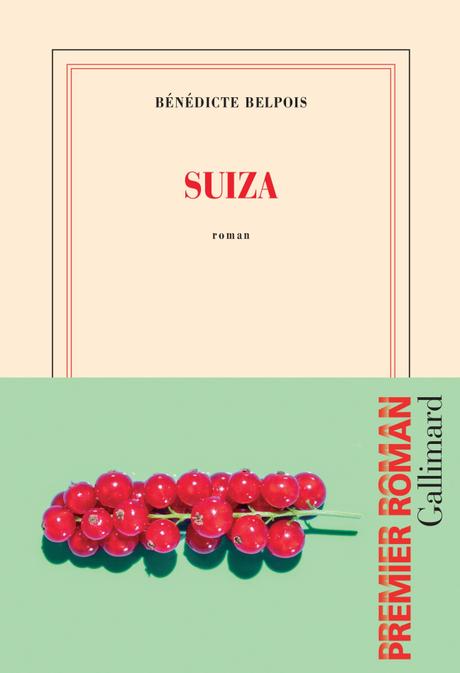

Sélectionné pour le « Prix Orange du livre 2019 »
En deux mots:
Sur un coup de tête, une jeune femme décide de quitter la Suisse en direction du sud. Elle arrive en Galice, trouve refuge dans un village où elle est engagée comme serveuse avant que Tomás ne s’en saisisse. Suiza et lui vont alors apprendre à s’apprivoiser, à s’aimer.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
L’été meurtrier
Le premier roman de Bénédicte Belpois, va secouer les consciences. «Suiza» est une belle étrangère qui débarque dans un village de Galice, où elle va provoquer un séisme.
Quel choc! Une fois n’est pas coutume, je vais commencer par l’épilogue de ce terrible roman (dans tous les sens du terme). Sans rien en dévoiler, je vous dirai simplement qu’il vous surprendra et ne pourra vous laisser indifférent. Et si je vous en parle d’emblée, c’est parce qu’il est à l’image de tout le roman, très loin du politiquement correct, se jouant des codes et de la bienséance. S’il n’était signé par une femme, j’imagine même qu’on aurait volontiers taxé l’auteur d’«affreux macho».
Sauf que Bénédicte Belpois a plus d’un tour dans son sac pour torpiller ce jugement à l’emporte-pièce, en particulier une habile construction.
Mais venons-en au récit qui s’ouvre sur une première scène forte en émotions: Tomás vient d’apprendre qu’il est atteint d’un cancer et que ses jours sont comptés. De retour dans son exploitation agricole située dans un village de Galice, il choisit de raconter que les médecins lui ont trouvé une pleurésie et de continuer à travailler dans ses champs.
Quand il rejoint ses amis au bistrot, une surprise l’attend. Álvaro s’est adjoint les services d’une jeune femme qui a quitté la Suisse pour partir vers le sud et qui, après quelques pérégrinations va finir chez lui. Une serveuse dont il fait peu de cas : «Elle parle pas espagnol. Tu peux lui dire qu’elle est conne, elle comprend pas. Tu peux l’insulter, elle bouge pas d’un poil. La femme idéale, j’te dis.»
Celle qu’Álvaro a décidé d’appeler Suiza va subjuguer Tomás. Son innocence, son visage, ses cheveux blonds, son odeur vont le rendre fou. «J’étais comme un dingue. Un prédateur. J’avais envie de la mordre, là où les veines battent, et de ne lâcher son cou que lorsqu’elle aurait fini de se débattre. Me revenait en mémoire une scène similaire de renard étouffant une caille, la froideur scintillante de ses yeux patients et déterminés. Je me suis levé, au ralenti, tout doucement, pour la surprendre, la coincer au plus vite. J’avais au moins trois têtes de plus qu’elle, ça allait être facile.»
Comme Álvaro avant lui, il va prendre la jeune femme et l’installer chez lui.
Donnant la parole à Suiza, Bénédicte Belpois va retracer le parcours de la jeune femme et détailler son état d’esprit. Il n’y est nullement question de rancœur ou de colère mais bien davantage de se construire une nouvelle vie.
À force d’attentions et de persévérance elle va gagner le cœur de Tomás. Lui qui s’est retrouvé très vite marié et qui aura très vite perdu cette épouse décédée d’un cancer bénéficie en quelque sorte d’une seconde chance. Avant de partir à son tour, il veut offrir à Suiza un avenir, lui montre comment gérer la ferme, lui offre des cours d’espagnol, lui fait découvrir la mer, lui offre une garde-robe, encourage ses talents artistiques…
De cette rencontre d’êtres meurtris, Bénédicte Belpois fait une épopée tragique, un opéra en rouge et noir que l’on pourrait fort bien lire sur un air de Carmen:
L’amour est enfant de Bohême,
Il n’a jamais connu de loi;
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime,
Si je t’aime, prends garde à toi.
Suiza
Bénédicte Belpois
Éditions Gallimard
Roman
256 p., 20 €
EAN 9782072825729
Paru le 07/02/2019
Où?
Le roman se déroule en Espagne, dans un petit village de Galice. On y évoque aussi le Jura français et suisse.
Quand?
L’action se situe de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
«Elle avait de grands yeux vides de chien un peu con, mais ce qui les sauvait c’est qu’ils étaient bleu azur, les jours d’été. Des lèvres légèrement entrouvertes sous l’effort, humides et d’un rose délicat, comme une nacre. À cause de sa petite taille ou de son excessive blancheur, elle avait l’air fragile. Il y avait en elle quelque chose d’exagérément féminin, de trop doux, de trop pâle, qui me donnait une furieuse envie de l’empoigner, de la secouer, de lui coller des baffes, et finalement, de la posséder. La posséder. De la baiser, quoi. Mais de taper dessus avant.»
La tranquillité d’un village de Galice est perturbée par l’arrivée d’une jeune femme à la sensualité renversante, d’autant plus attirante qu’elle est l’innocence même. Comme tous les hommes qui la croisent, Tomás est immédiatement fou d’elle. Ce qui n’est au départ qu’un simple désir charnel va se transformer peu à peu en véritable amour.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Blog Les livres de Joëlle
Blog La page déchirée
Blog La bibliothèque de Delphine-Olympe
Blog Agathe the book
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« Ici, les gens vont raconter n’importe quoi sur mon compte, après un fait divers pareil. N’importe quoi. Que j’avais ça dans les gènes, la violence et l’ennui, que j’étais bien le fils de mon père et que ça devait arriver. Ils vont raconter ma vie, même à ceux qui ne demanderont rien, ceux qui seront juste de passage, ceux qui viendront au village pour voir une connaissance, ou visiter la région. Mais personne ne sait vraiment l’histoire, à part Ramón. Agustina aussi, si je réfléchis bien, mais elle, elle ne pouvait pas être tout à fait objective, j’étais comme son fils. C’était surtout Ramón qui aurait eu le droit de l’ouvrir, parce que lui, il vivait presque avec nous.
Il a su le premier que j’étais malade. Un truc vraiment grave, une saloperie. Oui, c’est comme ça que ça a commencé, cette histoire, avec une bonne maladie bien dégueulasse.
Et sournoise, en plus, parce que je n’ai pas su tout de suite. Au début, je ne faisais que cracher et tousser, j’avais de la fièvre, j’ai cru que c’était une simple grippe. Je n’ai même pas arrêté de fumer. Don Confreixo m’a collé sous antibiotiques, mais ça ne passait pas. Je me sentais mal. Il m’avait envoyé aux urgences à Lugo au bout d’une semaine, et là j’ai eu droit au grand shampooing. Scanner des poumons, puis de tout le corps, grand ballet de docteurs qui venaient se disputer au pied de mon lit sur la poursuite du protocole, les examens complémentaires et le diagnostic, pendant que je m’agitais en pensant à la tonne de boulot qu’il me restait : les foins allaient débuter dans quelques jours alors qu’un de mes meilleurs tracteurs m’avait lâché, en plus des contrôles sanitaires qui s’annonçaient périlleux : il traînait encore en Terra Chá quelques cas de fièvre catarrhale qui nous plombaient les exportations. J’ai fini par me tirer contre avis médical, en leur demandant de transmettre à mon médecin, quand ils seraient enfin d’accord sur le diagnostic et la marche à suivre. Mais je sentais bien que ça craignait.
Le lendemain même, Don Confreixo m’a appelé, à la première heure, après la traite.
— Tomás ? Tu es rentré ? Il faut que tu passes ce matin, l’hôpital m’a appelé, j’ai tes résultats.
— Ça va pas être possible, docteur. Aujourd’hui j’ai le contrôle pour les troupeaux. Et il faut que j’aille à Orense pour un tracteur. Je suis déjà en retard.
— Ce n’est pas une question, Tomás, il faut que tu viennes, c’est impératif. S’il te plaît.
Ramón venait d’arriver, je courais vers le tracteur, j’ai dit « oui oui » pour me débarrasser de lui. J’étais juste énervé parce que je savais qu’il allait me bouffer une matinée de boulot.
Quand j’ai été devant lui, il a chaussé ses lunettes de vrai docteur et il a ouvert la bouche puis l’a refermée sans rien dire, après une grande inspiration. Il a fait le crapaud deux ou trois fois, ça m’a gonflé, j’ai dit très rapidement :
— C’est grave ?
— Oui.
— Un cancer ?
— Oui, il a répondu, cet abruti.
Franco. Il déglutissait avec difficulté et me regardait avec des yeux de lémurien aveugle, j’ai vite compris que pour la pommade et le décorum, il allait falloir que je m’adresse ailleurs.
— Il me reste combien de temps ?
Je l’ai dit sans y penser vraiment, parce que dans les films c’est toujours ce que l’on dit après une annonce pareille. Avec un visage angoissé. Le film passe en noir et blanc, les héros crispent les mandibules et susurrent des phrases bibliques dans un souffle que l’on pense être l’avant-dernier.
— Tomás, tu vas un peu vite en besogne ! On n’est pas là pour parler de survie, mais pour parler de guérison.
Ah, quand même, il se fendait d’un encouragement, l’assassin.
Je me regardais les mains, mes grosses paluches de paysan, je trouvais que j’avais les ongles encore assez propres malgré tout et je me demandais si j’allais avoir le temps de m’envoyer un rioja avant de retourner au boulot.
Ont suivi le protocole, les rendez-vous à prendre, ceux à honorer, Don Confreixo s’occupait de tout mais évitait de me regarder dans les yeux. Il tripotait mon dossier et se raclait la gorge à intervalles réguliers, téléphonait à des confrères pour m’obtenir fissa un rendez-vous chez un pneumologue renommé.
J’ai retrouvé Ramón au bar.
— J’ai une pleurésie. Il va sûrement falloir que je retourne à l’hôpital quelques jours, pour des antibiotiques, et des nouvelles radios, peut-être même une intervention. Demande à Alberto s’il peut venir te filer un coup de main, pendant que je serai à Lugo.
La ferme, c’était facile, le vieux savait aussi bien que moi ce qu’il fallait faire. Le plus dur, c’était la valise : je n’avais même pas de pyjama. Je couche à poil. Ou tout habillé, quand je suis trop bourré.
J’ai eu le temps pour le rioja. J’en ai même bu trois, pendant que le vieux me mettait au parfum pour les champs.
Ça a commencé comme ça, vraiment. Le reste, je vais essayer de le raconter simplement. Parce que si je suis un mec un peu primaire, je ne suis pas le psychopathe qu’on raconte. J’ai fait comme j’ai pu, mais ça m’est tombé sur la gueule et je ne vois pas bien comment j’aurais pu agir autrement.
J’étais presque heureux de venir à l’hôpital finalement.
Pour le pyjama, ça n’avait pas été un problème, je ne devais pas être le seul. J’avais pris mon air de gamin de douze ans qui n’a pas de gentille maman pour glisser un pyjama dans sa valise de colo et les aides-soignantes m’avaient filé, compatissantes, une grande chemise de nuit ouverte dans le dos. Mon voisin de chambre voyait mon cul chaque fois que je me levais pour aller pisser, alors que je tentais pourtant de tenir les deux pans volages avec ma main gauche. Mais comme en même temps je poussais la potence de la main droite, et que j’ai toujours été agile comme un dragster, je finissais toujours par montrer mes fesses, pour ne pas buter dans le lit, la porte, la chaise, sur tous les obstacles rassemblés là exprès pour me faire chier et me rappeler que j’étais trop grand, trop gros, trop con.
Aux blouses blanches, j’avais envie de dire: opérez-moi. Enlevez-moi tout ce qu’il est possible d’enlever: les poumons, le foie, la rate et le cœur. Je ne veux plus de cette chair avariée, dans laquelle pousse quelque chose d’abominable, contre ma volonté. Les médecins n’étaient pas tous d’accord, il leur avait fallu deux jours pour décider que oui, on finirait par me découper les côtes pour aller chercher cette merde qui me dévorait le poumon.
Même après l’intervention, je crois que j’étais bien. Je n’avais pas mal, on me shootait à heure régulière, plus la pompe de morphine qui distillait dans mes veines un bonheur comateux. On s’occupait de moi, il n’y avait pas à dire. Les infirmières étaient gentilles mais grosses et moches: pas une pour relever le niveau, même pas de quoi s’inventer une petite branlette. Elles n’avaient pas les porte-jarretelles et les décolletés provocants des revues porno, elles couraient partout et tout le temps et ne venaient que pour me retourner comme une crêpe et me laver le dos avec un truc qui puait, genre eau de Cologne premier prix. Ça les faisait kiffer de me laver le dos, je ne savais pas pourquoi, elles me demandaient toujours après si je me sentais «plus frais». Je trouvais surtout que ça me piquait, mais je ne disais rien, je ne voulais pas casser leur bel enthousiasme. Elles me lavaient le sexe aussi, mais avec les gants en plastique, sans blague, ça ne me faisait aucun effet.
À part ça, deux jours qu’il faisait beau, avec une chaleur d’enfer exceptionnelle, même pour la saison. Pas d’orages, je transpirais comme un bœuf sur mon alèse en plastique et je pensais à mes champs, merde… J’aurais pu faire les foins, normalement. J’espérais que Ramón allait commencer par les champs du coteau, c’était toujours là que c’était le plus mûr. Mais il le savait mieux que moi.
Je lui avais interdit de venir me voir, je préférais qu’il s’occupe de mes champs et je n’avais pas envie qu’il comprenne que j’étais plus malade que je voulais bien le laisser paraître. Il me connaissait par cœur, je savais bien qu’il aurait tout deviné. On n’ouvrait pas un mec en deux pour une pleurésie. »
Extraits
« Álvaro est parti à nouveau d’un rire gras et fort, qui a secoué Ramón de devant sa télé et l’a poussé à s’intéresser lui aussi à la conversation.
— De Suisse, tu dis ?
— Eh oui, mon gars, c’est ça, la mondialisation ! Avant, c’est ceux de chez nous qui partaient pour nourrir leur famille et travaillaient comme des esclaves pour un salaire de misère, mais maintenant, c’est les Suisses qui viennent en Galice pour faire fortune.
— Si les Suisses viennent faire fortune chez toi, Álvaro, ils sont pas arrivés!
Ramón s’est mis à glousser lui aussi comme un dindon en lui claquant sa grosse main d’étrangleur sur l’épaule. Belle brochette de vieux séniles.
La femme, cette Suiza, est revenue à la table avec un plateau et la bière.
— Pour juste une bière, le plateau, c’est pas la peine, s’est appliqué à gueuler Álvaro.
— Pourquoi tu lui parles comme à une mongole? a demandé Ramón.
— Dis donc, pépé, faudrait voir à écouter quand on cause ! Elle parle pas espagnol. Tu peux lui dire qu’elle est conne, elle comprend pas. Tu peux l’insulter, elle bouge pas d’un poil. La femme idéale, j’te dis.
« À nouveau, j’étais comme un dingue. Un prédateur. J’avais envie de la mordre, là où les veines battent, et de ne lâcher son cou que lorsqu’elle aurait fini de se débattre. Me revenait en mémoire une scène similaire de renard étouffant une caille, la froideur scintillante de ses yeux patients et déterminés.
Je me suis levé, au ralenti, tout doucement, pour la surprendre, la coincer au plus vite. J’avais au moins trois têtes de plus qu’elle, ça allait être facile. Je l’ai regardée avec une telle intensité qu’elle a fini par lever les yeux vers moi, enfin, une fois la bière et le verre posés sans encombre. Elle m’a paru instantanément effrayée. Je sentais qu’elle percevait mon désir, ma puissance, et que je lui faisais peur. Son inquiétude la rendait encore plus immobile, mon regard la clouait au plancher.
Tous les deux, nous ne bougions plus d’un pouce, sachant que le premier qui esquisserait un mouvement entraînerait une attaque ou une fuite irréversible. J’étais dans les starting-blocks, prêt à jaillir. »
« Je me suis enfui. Je suis monté dans mon tracteur, j’ai démarré en trombe et roulé jusque chez moi, ballotté par les ornières, bercé par le bruit du moteur. J’ai marmonné des mots sans suite, légèrement penché en avant, accroché au volant. Je n’étais pas moi-même.
C’est le chien aboyant de joie qui m’a tiré de mon monologue. J’étais arrivé dans la cour de la ferme depuis un moment, le moteur était éteint. Je lui ai filé une caresse furtive puisqu’il fêtait mon retour et j’ai grimpé quatre à quatre les marches en pierre puis en bois qui montent au grenier, sans voir le reste de la maison. Entre les toiles d’araignées, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur la campagne environnante, c’était mon mirador. Tout petit déjà, je me réfugiais là, quand mon père m’avait grondé pour quelque bêtise d’enfant. J’avais placé un vieil escabeau sous le petit carré de ciel et maintenant je restais là à fumer, la tête dans la lucarne. Depuis cet observatoire, ma vue s’étendait sur toute ma campagne galicienne. Les champs à perte de vue, comme une houle verte et molle qui rappelait la mer si proche et pourtant invisible. Les eucalyptus, les gommiers bleus. La couleur bleu tendre des jeunes feuilles, le vert foncé qui vient plus tard. Quand le vent du matin se levait et faisait soupirer la forêt, c’était comme s’il y en avait deux en une. Bleue ou verte. Verte ou bleue. Selon sa force, c’était toujours différent. Si la brise agitait mollement les feuilles, c’était comme un grand banc d’anchois affolés, qui fuyaient devant les filets des pêcheurs, quand leurs ventres étincelants capturaient un rayon de soleil. Si la brise devenait vent, la forêt entière mugissait, et couraient alors dans les grandes branches et sur les cimes de fortes vagues bicolores, pleines d’écume, qui s’écrasaient contre le ciel. »
À propos de l’auteur
Bénédicte Belpois vit à Besançon où elle exerce la profession de sage-femme. Elle a passé son enfance en Algérie. C’est lors d’un long séjour en Espagne qu’elle a commencé à écrire «Suiza», son premier roman. (Source: Babelio)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
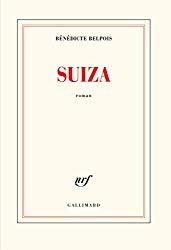


Tags:


