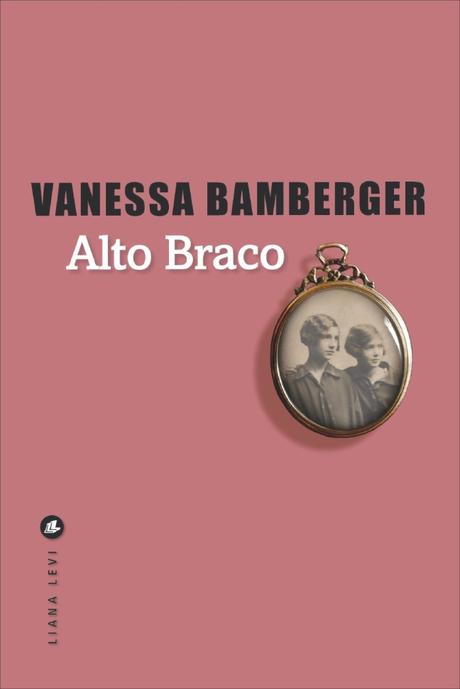


En deux mots:
À la mort de sa grand-mère, Brune tient sa promesse de l’enterrer dans son Aubrac natal. En quittant paris, elle ne sait pas encore que ce voyage va transformer sa vie, entre la révélation de secrets de famille et l’envie de construire sa propre histoire.
Ma note:
★★★★ (j’ai adoré)
Ma chronique:
L’Aubrac au cœur
Pour son second roman Vanessa Bamberger change de registre et renoue les fils d’une histoire familiale en retournant sur le plateau de l’Aubrac enterrer la grand-mère qui l’a élevée.
Nous avions découvert Vanessa Bamberger il y a deux ans avec la parution de Principe de suspension, dans lequel un patron de PME, victime d’un accident respiratoire, se retrouvait dans le coma au moment où son entreprise et son couple traversaient de fortes turbulences. Un premier roman audacieux et une plume solide, sans fioritures, que l’on retrouve ici avec plaisir, même si le sujet traité est fort différent.
La narratrice, répondant au doux prénom de Brune, vient de perdre Douce, la grand-mère qui l’a élevée avec sa sœur Annie, sa mère étant décédée à sa naissance. Installée dans la région parisienne, elle fait partie des descendants de bougnats, ces immigrants venus des hautes terres du Massif central et qui ont petit à petit mis la main sur le commerce du bois et du charbon livré à domicile), mais surtout des boissons. Ce qui les a conduits à gérer cafés, restaurants et hôtels. Leur succès a été tel que les Auvergnats de Paris formaient dans le premier tiers du XXe siècle la communauté immigrante la plus importante de la capitale française.
Brune a promis à Douce de l’enterrer dans son Aubrac natal et si Annie, proche de ses sous, a bien rechigné un peu face à la dépense, elle a fini par accepter de prendre la route derrière le corbillard.
À l’émotion du dernier adieu vient alors s’ajouter celle de ces paysages où les racines familiales sont bien plus profondément ancrées qu’elle ne s’imagine. Brune retrouve là son taiseux de père, Serge Alazard. Il avait choisi de lâcher son bistrot pour reprendre l’élevage de ses parents à Saint-Urcize, laissant Brune avec ses aïeules.
Dans un quadrilatère composé de Laguiole, Lacalm, Saint-Urcize et Nasbinals, elle va aussi retrouver des cousins, des traditions, des secrets de famille. Et cette certitude qu’elle est beaucoup plus proche de ce coin perdu qu’elle ne l’osait se l’avouer: « J’avais raison, je venais d’ici, j’étais d’ici. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Ou plutôt, il faut savoir d’où l’on vient pour pouvoir l’oublier. Je n’appartenais pas à une terre, mais à une histoire, dont je devais connaître le début pour en écrire la fin. »
Brune, qui a la phobie des couteaux et ne mange quasiment pas de viande, et surtout pas de viande rouge, va se transformer au fil des pages et au fil des rencontres. À Laguiole, avec son cousin germain Gabriel, qui travaille chez «Boyer & fils, maîtres couteliers depuis 1904» elle va non seulement apprendre à aimer les couteaux, mais aussi lever un coin du voile sur son ascendance. Douce avait été le grand amour de Maurice Boyer, mais ce dernier avait épousé Eliane. Le couple avait donné naissance à Chantal, tandis que Douce mettait au monde Rose, la mère de Brune et de Maurice. Du coup, Brune comprend mieux pourquoi Chantal avait haï Douce toute sa vie. Mais elle n’est pas pour autant au bout de ses surprises…
À Nasbinals où habite le cousin Bernard, elle va aussi rassembler des indices. Mais aussi s’intéresser à l’élevage et aux pratiques agricoles censées faire la richesse de cette région, au point de vouloir initier un projet pour transformer l’exploitation paternelle.
Au fil des pages, on comprend que le centre de gravité de sa vie s’est déplacé. Elle prend souvent la route de l’Aubrac, elle délaisse Maxime, ce cadre supérieur à la Société Générale, avec lequel elle s’est liée. Un peu comme s’il y avait urgence, un peu comme si c’était sa dernière chance de rassembler les pièces de son puzzle.
Les dernières pages sont magnifiques, riche en rebondissements et en révélations et viennent confirmer le talent de conteuse de Vanessa Bamberger.
Alta Braco
Vanessa Bamberger
Éditions Liana Levi
Roman
240 p., 19 €
EAN 9791034900749
Paru le 03/01/2019
Où?
Le roman se déroule en France, à Paris et dans la région parisienne, à Asnières, Levallois-Perret, Courbevoie, Vincennes et principalement dans l’Aubrac, entre Cantal, Lozère et Aveyron, à Laguiole, Lacalm, Saint-Urcize et Nasbinals, en passant par Saint-Flour
Quand?
L’action se situe de nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Alto braco, «haut lieu» en occitan, l’ancien nom du plateau de l’Aubrac. Un nom mystérieux et âpre, à l’image des paysages que Brune traverse en venant y enterrer Douce, sa grand-mère. Du berceau familial, un petit village de l’Aveyron battu par les vents, elle ne reconnaît rien, ou a tout oublié. Après la mort de sa mère, elle a grandi à Paris, au-dessus du Catulle, le bistrot tenu par Douce et sa sœur Granita. Dures à la tâche, aimantes, fantasques, les deux femmes lui ont transmis le sens de l’humour et l’art d’esquiver le passé. Mais à mesure que Brune découvre ce pays d’élevage, à la fois ancestral et ultra-moderne, la vérité des origines affleure, et avec elle un sentiment qui ressemble à l’envie d’appartenance.
Vanessa Bamberger signe ici un roman sensible sur le lien à la terre, la transmission et les secrets à l’œuvre dans nos vies.
Les critiques
Babelio
Lecteurs.com
Blog motspourmots.fr (Nicole Grundlinger – rencontre avec l’auteur) Chronique
Blog Sans connivence (Pierre Darracq)
INCIPIT (Les premières pages du livre)
« Je me suis réveillée en sursaut, le bras gauche paralysé. Paniquée, je me suis frotté vigoureusement la peau. Le sang a recommencé à circuler, et j’ai retrouvé l’usage de mon bras. Il m’a fallu quelques secondes pour me débarrasser des rets du sommeil, reprendre mes esprits. Nous étions le 30 octobre et j’enterrais Douce.
Ce jour-là, une partie de moi allait aussi disparaître, ensevelie sous cette terre noire d’Aubrac que je connaissais si mal mais à qui je donnais, à qui je rendais ma grand-mère. Les petits soupirs de la machine à café et l’odeur de moka brûlé m’ont apaisée. Il n’était que 6 heures. Je n’ai pas regardé mon téléphone, je n’ai pas voulu voir les dizaines d’appels manqués que Granita aurait inévitablement imprimés sur l’écran.
L’idée m’est venue de me faire des crêpes. Tous les soirs de sa vie, et bien qu’elle ait déjà passé la journée en cuisine, Douce jetait dans une casserole une noix de beurre et un grand verre de lait, cassait quatre œufs dans un petit saladier en Inox pour les fouetter avec du sucre, de la farine, et une cuiller à soupe d’eau de fleur d’oranger. L’opération ne prenait pas plus de trois minutes. Ensuite, elle filait se nettoyer le visage et les yeux à l’aide de cotons imprégnés d’eau chaude – le démaquillant, c’est pour les feignasses –, enfilait une liquette de soie achetée dans les grands magasins et s’abattait sur son lit jusqu’au lendemain.
Ma grand-mère était descendue travailler depuis une bonne heure quand mon réveil sonnait. Chaque matin, trois crêpes parfumées enveloppées de papier d’argent m’attendaient sur la table en Formica bleu de la petite cuisine. Sa sœur, Annie, que tout le monde appelait Granita, dormait encore : elle était du soir.
Mais ce 30 octobre, je me suis ravisée, je n’aurais rien pu avaler.
Le taxi a glissé le long du trottoir de la rue Catulle-Mendès. Au-dehors, le ciel ressemblait à l’intérieur d’une coupelle en métal martelé, des gouttes en tombaient par à-coups, le genre de pluie dont on ne sait si elle va s’arrêter ou redoubler, et qui correspondait bien à mon état d’esprit. Mes propres réactions m’étonnaient toujours. J’étais capable de m’effondrer pour un rien et de résister aux plus grandes catastrophes. De passer du rire aux larmes en quelques minutes. Je n’étais pas douée pour la mesure : je tenais cela de mes grands-mères. Mais contrairement à elles, je n’exprimais jamais mes émotions devant des inconnus.
La petite silhouette maigre qui attendait en bas de l’immeuble a fait un signe désespéré, comme si elle avait peur que la voiture ne s’arrête pas. De part et d’autre des bottines de Granita, deux bagages : un énorme, en vieux cuir brun, qui lui arrivait à la taille, et un plus petit, à roulettes. Je n’ai pas cherché à comprendre, je ne lui ai pas reproché de ne pas m’avoir attendue dans l’appartement ainsi que je le lui avais recommandé, je l’ai embrassée vite fait et l’ai aidée à porter la grande valise. Elle était vraiment lourde.
Je me suis efforcée de ne pas lever les yeux vers l’appartement du premier étage mais je n’y suis pas parvenue. Un instant, il m’a semblé qu’apparaissait le visage de Douce à la fenêtre, celui qu’elle prenait pour m’attendre les soirs où je sortais. Quand il m’arrivait d’être raccompagnée, avant que le garçon ne puisse l’apercevoir, je m’empressais de signaler la présence possible d’une vieille voisine insomniaque, une folle dont il fallait éviter à tout prix de croiser le regard de crainte qu’elle crie et réveille tout l’immeuble. J’avais honte des grands gestes qu’elle m’adressait. En larmes, elle se passait la main sur le front puis sur le cœur pour montrer son soulagement, tout juste si elle ne faisait pas le signe de croix.
J’aurais tant aimé la voir gesticuler derrière la vitre aujourd’hui. Grimper les quinze marches qui me séparaient de la minuscule cuisine en faïence beige où, pour tromper l’attente, elle avait préparé un gâteau caramélisé aux poires dont la surface grillée revêtait l’aspect d’un entrelacs de dentelles. Tout juste démoulé, il fumait délicatement quand j’en saisissais une part. Comme d’habitude, Douce avait pris soin de le découper ; à cause de mon anxiété, ainsi qu’elle la nommait– depuis toute petite, j’avais la phobie des couteaux. La félicité que j’éprouvais en mordant la pâte moelleuse n’était pas comparable au vague bien-être ressenti fugitivement quelques minutes plus tôt quand le garçon et moi avions partagé nos salives dans un doux roulis. Le vertige du fruit acide et brûlant fondant dans un claquement de langue, ma bouche s’emplissant de caramel craquant, de beurre chaud… J’avais toujours eu plus de plaisir à manger qu’à faire l’amour.
Mon regard s’est porté sur le rez-de-chaussée. Le Catulle était « fermé pour cause de deuil ». J’ai reconnu l’écriture de bonne élève de Granita sur le panneau en ardoise accroché à la porte du bistrot. Celui-là même sur lequel Douce inscrivait le plat du jour à la craie blanche.
Nous avons démarré en direction de Courbevoie. Dans le taxi, Annie n’a pas dit un mot, ce qui était pour le moins inhabituel. J’ai eu envie de placer ma main sur la sienne, qu’elle avait plantée dans le cuir de la banquette arrière, un dôme d’os tendu de cuir pommelé. A la place, j’ai doucement posé la semelle de ma chaussure sur l’avant de sa bottine. Elle avait de tout petits pieds et j’avais passé mon enfance à les écraser. Brune, tu as de si grands panards ! gloussait-elle, si bien que je riais aussi pour lui faire plaisir. Je ne l’ai jamais priée d’arrêter, ni ne lui ai jamais avoué que mes pieds m’ont complexée toute ma vie.
Mais ses yeux gris ne se sont pas allumés, ses joues sèches ne se sont pas teintées de rose. Elle semblait fixer les grues qui hérissaient le ciel pâlissant mais je savais bien que dans l’ombre des poutres métalliques, c’était le visage de sa petite sœur qu’elle guettait, ses grands yeux sombres bordés de cils-forêts, sa peau lisse et rebondie. Et dans ces traits un peu de leur Aubrac natal. Car Douce Rigal avait emporté son pays sur son visage. Son front bombé, une prairie éclaboussée de lumière, ses dents blanches, des pétales de narcisse du poète, sa fossette au menton, une combe, son corps long et délié, la rencontre d’un chemin pierreux et d’un cours d’eau. Elle est aussi belle que le nord Aveyron, reconnaissait Granita. Juste avant d’ajouter, dommage qu’elle soit idiote.
Annie, pour sa part, s’estimait petite, maigre et noiraude. Le teint brûlé, l’œil enfoncé mais vif, le nez racé. En vieillissant, ma grand-tante s’était trouvé une ressemblance avec Alice Sapritch, qu’elle cultivait en s’habillant de longues jupes noires et de chemises blanches à col amidonné lui conférant un petit air de duègne. Je ne l’avais jamais vue s’acheter une paire de chaussures, encore moins un bijou ou du maquillage. Elle entretenait un rapport ambivalent avec son physique, revendiquait orgueilleusement son statut de laide, se moquait des coquetteries de sa cadette dont l’évidente beauté suscitait en elle un curieux mélange de jalousie, d’admiration et de pitié.
J’ai été élevée par mes deux grands-mères. Je faisais l’amalgame pour simplifier, mais cette formulation creusait toujours entre les sourcils de mon interlocuteur un sillon de surprise, jusqu’à ce que je rectifie : en vérité, ma grand-mère et ma grand-tante. Douce et Annie Rigal. Deux sœurs, oui. Non, pas de mère, elle est morte en accouchant. Alors les sourcils de la personne se fronçaient doucement, son regard s’assombrissait, et sur ses lèvres s’esquissait un petit sourire de compassion.
On accédait à la morgue du centre hospitalier de Courbevoie par un escalier métallique en colimaçon qui menait au parking. Là, un employé des Pompes funèbres Barthot m’a précédée dans ce qui ressemblait à un utérus géant. Une pièce rectangulaire sans fenêtres, les murs tendus de tissu écarlate, le sol couvert d’une moquette carmin. Une grande croix de bois clair suspendue. Je me suis demandé quel effet cela produisait sur ceux dont ce n’était pas le symbole référent. Puis je me suis rappelé que j’allais être servie dans les jours qui venaient. Le pays d’Aubrac était, paraît-il, planté de centaines de croix. Tous les petits-enfants des cafetiers parisiens ramenaient-ils les corps de leurs grands-parents sur le plateau ?
Bref, je me disais n’importe quoi pour retarder le moment de plonger mon regard à l’intérieur du cercueil ouvert qu’on avait disposé sur des tréteaux au centre de la pièce. De toute façon, rien ne pouvait être pire que ce que j’avais vu à la maison de retraite de la Croix-Rose.
Le jour où les voisins du dessus m’avaient appelée pour la troisième fois en moins d’un mois, j’avais compris que ma grand-mère ne pouvait plus rester chez elle. Le bistrot était fermé, Granita injoignable. Une fumée noire s’échappait du dessous de la porte de l’appartement. J’étais entrée en criant. On ne voyait pas à un mètre. Douce avait oublié le lait et le beurre des crêpes sur le feu.
La casserole avait fondu. L’air était irrespirable. Cependant, je l’avais trouvée tranquillement installée dans le salon, à vingt centimètres de la télévision dont elle avait poussé le volume à fond : elle ne s’était aperçue de rien.
L’étage Alzheimer de la maison de la Croix-Rose. Une seule fois en six mois, l’espace de quelques secondes, Douce avait pris l’air réjoui en montrant le drapeau par la fenêtre : je suis ravie d’être en Suisse, avait-elle dit. Le reste du temps, elle semblait terriblement triste.
Aucun autre mot ne me venait à l’esprit quand je la retrouvais attachée à son fauteuil, les vêtements tachés, les cheveux sales. C’est à la mode de se préoccuper du bien-être de nos animaux, mais on devrait aussi se soucier du bien-être de nos vieux, avançait Granita d’une voix docte. Si on mettait des caméras dans les maisons de retraite, on ne verrait pas que des belles choses.
Je me consolais en me disant que je ne pouvais pas savoir, tous ces endroits devaient se ressembler, j’avais essayé de faire au mieux, en fonction de nos moyens financiers qui n’étaient pas minables. Avoir l’air minable, c’était la terreur de mes grands-mères.
A la fin, Douce ne nous reconnaissait presque plus. Je me souviens m’être penchée sur elle pour l’embrasser, elle marmonnait quelque chose. J’avais fini par comprendre, c’était « Lacalm ». Le nom de son village natal qu’elle invoquait de plus en plus souvent ces derniers temps.
Dans la chambre mortuaire de Courbevoie, je me suis approchée du cercueil avec appréhension, comme on le ferait d’une vitrine de musée dont on sait qu’elle abrite une momie.
Couchée sur un capiton de soie champagne – un choix qui avait fait l’objet d’une âpre discussion dans le bureau des Pompes funèbres Barthot, Granita ne jugeant aucune couleur digne de seoir à la complexion havane de sa sœur, expression délivrée un jour par une vendeuse de fonds de teint Dior –, Douce semblait gonflée à l’hélium. J’avais laissé ma grand-tante décider de ses derniers vêtements et elle avait fait, pour le moins, un choix osé. Douce reposait dans la robe violette avec ceinture et col à broderies dorées qu’une cliente lui avait rapportée du Maroc. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, une coiffure qu’elle n’avait jamais arborée de sa vie, en grande obsessionnelle des bigoudis. Un maquilleur fou lui avait peint les lèvres en rouge foncé et les paupières en turquoise. Sa fossette au menton avait disparu. Cela aurait pu être n’importe qui, de n’importe quel âge et cette idée m’a aidée, pour un temps, à fuir la réalité de sa disparition.
Interdite, j’ai regardé Granita s’avancer en traînant le gros bagage en cuir. Elle s’est penchée sur le cercueil et a embrassé sa sœur comme si elle était simplement malade. Je suis là, a-t-elle annoncé, je t’ai apporté plein de bonnes choses. Elle a couché la valise sur le flanc et l’a ouverte au beau milieu de la pièce. Elle a commencé par déballer un objet enrobé de papier de soie. C’était le cadre en argent que ma grand-mère conservait sur sa table de nuit, entre les deux lits jumeaux de sa chambre.
Sur la photographie, Douce a 42 ans. Elle vient d’emménager rue Catulle-Mendès et se tient bien droite au milieu du nouveau salon, le menton relevé et l’œil insolent, comme à chaque fois qu’on braque sur elle un objectif. A côté d’elle, une jeune fille chétive, un peu plus petite qu’elle : Rose, ma mère, l’air d’avoir 15 ans – elle en a 18. Le nourrisson dans les bras de cette adolescente, c’est moi.
J’ai songé à l’autre cadre en argent, sur la table de nuit de Granita, dans la chambre située à l’exact opposé de celle de Douce, de l’autre côté du couloir. Une configuration inversée : les deux lits jumeaux, la petite table au centre, et Granita sur la photo à la place de Douce.
Ma mère était morte quelques jours seulement après qu’on eut pris ces photos. »
Extraits
« J’ai été élevée par mes deux grands-mères. Je faisais l’amalgame pour simplifier, mais cette formulation creusait toujours entre les sourcils de mon interlocuteur un sillon de surprise, jusqu’à ce que je rectifie: en vérité, ma grand-mère et ma grand-tante. Douce et Annie Rigal. Deux sœurs, oui. Non, pas de mère, elle est morte en accouchant. Alors les sourcils de la personne se fronçaient doucement, son regard s’assombrissait, et sur ses lèvres s’esquissait un petit sourire de compassion.
On accédait à la morgue du centre hospitalier de Courbevoie par un escalier métallique en colimaçon qui menait au parking. Là, un employé des Pompes Funèbres Barthot m’a précédée dans ce qui ressemblait à un utérus géant. Une pièce rectangulaire sans fenêtres, les murs tendus de tissu écarlate, le sol couvert d’une moquette carmin. Une grande croix de bois clair suspendue. » p. 15
« Arrivées à Paris à la fin de l’été 1960, mes grands-mères avaient tout de suite commencé à travailler dans un bistrot d’Asnières, l’une comme serveuse et l’autre comme aide-cuisinière. Sans contrat, sans congés, sans déclaration ni jour de repos, la chambre de service au sixième étage avec WC au troisième, ma mère ballottée de droite à gauche. Le patron, un Nord-Aveyronnais originaire de Graissac, les avait à l’œil. Fais-moi ci, fais-moi ça, range les assiettes, essuie les couverts, épluche la lotte, le congre, la daurade. Fais tes preuves et après on verra. Il fallait de l’ambition et du caractère, ne rien lâcher.
Un an plus tard, on leur avait confié un bar en gérance appointée, un remplacement rue Baudin, à Levallois-Perret. Puis elles avaient pris un café en gérance propre à quelques centaines de mètres de là, Le Demoiselle, rue Danton, près de l’usine Citroën. Elles y étaient restées quinze ans.
L’important, convenaient-elles, et c’était bien la seule chose à propos de laquelle elles ne se disputaient jamais, était de ne pas prendre de vacances. » p. 19
« Tout comme ma mère, il n’avait pas réussi à me détester. Il m’admirait, même. J’avais aidé celui que je croyais être mon père à sauver ce qui se révélait être la terre de ma mère. Sans le savoir, j’avais préservé l’héritage de mes grands-mères. J’avais raison, je venais d’ici, j’étais d’ici.
Il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Ou plutôt, il faut savoir d’où l’on vient pour pouvoir l’oublier. Je n’appartenais pas à une terre, mais à une histoire, dont je devais connaître le début pour en écrire la fin. » p. 228
À propos de l’auteur
Vanessa Bamberger vit à Paris. Après Principe de suspension (2017), elle rend hommage à l’Aubrac envoûtant de ses aïeules et à l’univers des éleveurs avec Alto braco. (Source: Éditions Liana Levi)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
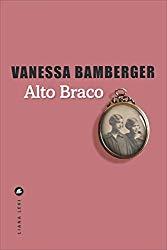


Tags:


