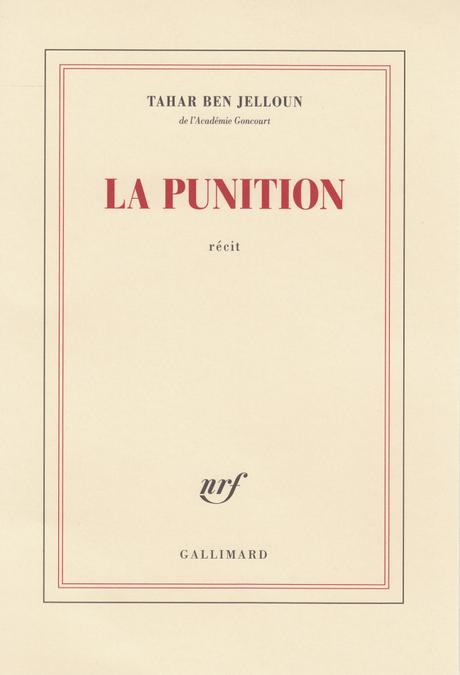
En deux mots:
Durant presque deux ans le narrateur a été contraint à un «service militaire» dans un camp qui ressemble davantage à une prison insalubre qu’à un centre de formation. Pou retracer cet épisode, Tahar Ben Jelloun aura mis plus de cinquante ans.
Ma note:
★★★ (bien aimé)
Ma chronique:
Avoir vingt ans dans l’Atlas
Tahar Ben Jelloun raconte comment sa vie s’est arrêtée un jour de 1966. Emprisonné dans un «camp militaire», il devra subir pendant dix-neuf mois vexations et humiliations.
Quand on a vingt ans, la vie devant soi, un premier amour et des envies plein la tête, on imagine combien un emprisonnement totalement arbitraire peut entraîner comme traumatisme. Il aura fallu un demi-siècle à Tahar Ben Jelloun pour «digérer» l’épisode qu’il retrace dans La punition et pour oser l’écrire.
Nous sommes en 1965. L’auteur, qui est aussi le narrateur, est étudiant. Avec quelques amis, il participe à des réunions pour parler des Droits de l’homme et défile pour davantage de liberté. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le groupe est infiltré par la police politique, que son nom est alors enregistré comme fauteur de trouble.
Un an plus tard un homme se présente chez lui, muni d’une convocation pour un «service militaire». Il doit se rendre dans un camp situé à El Hajeb dans les contreforts du Moyen Atlas. Outre des locaux proches de l’insalubrité et une cuisine qui ne mérite pas ce nom, il doit aussi subir les humeurs de sous-officiers bien décidés à les mater. Pour quelqu’un qui n’a rien à se reprocher, ces conditions de vie sont proprement insupportables. « Ici, pas de pensées, pas d’idées, que des ordres de plus en plus stupides avec un brin de cruauté au passage. »
Le courrier est censuré, les cheveux sont rasés, les humiliations quotidiennes.
Pour «s’évader», on peut lire et écrire. Avec un morceau de crayon et quelques feuilles de papier, l’auteur s’essaie à la poésie. Ce qui peut s’apparenter à une transgression suprême, car « poètes et philosophes sont ici indésirables, impensables, exclus. Nous sommes réduits à nos plus bas instincts, notre part bestiale, animale, inconsciente. Ils ont tout fait pour nous vider de ce qui nous engage à réfléchir, à penser. Je me bats la nuit contre moi-même pour ne pas devenir comme mes trois voisins de chambre qui agissent en militaires automates. Ils acceptent tout sans broncher. On dirait que leur cerveau a été déposé dans la consigne d’une gare perdue. »
Tout est alors bon pour ne pas sombrer, comme par exemple cet Ulysse qui traîne là. « Je lis la quatrième de couverture: c’est une histoire qui se passe durant une journée à Dublin, le 16 juin 1904. Leopold Bloom et Dedalus se promènent dans la ville… Je me demande quel est le rapport avec L’Odyssée. Je plonge le soir même dans le pavé. Je me sens perdu, en même temps heureux d’avoir un ami, un nouveau compagnon. Je ne comprends pas la finalité du roman, mais je le lis lentement comme s’il avait été écrit pour un amoureux de littérature privé de sa liberté. Quand je repense aujourd’hui à ce livre, je me souviens des émotions de la lecture volée, clandestine, et de la jouissance qu’elle me procure. Je me moquais pas mal de comprendre ou non ce que je lisais. »
Des maigres informations qui parviennent de l’extérieur la rumeur d’un conflit avec l’Algérie semble se concrétiser lorsque l’on vient leur annoncer leur transfert dans une autre caserne pour les préparer à défendre leur pays. En montant dans les camions bâchés, la peur de servir de chair à canon étreint la petite troupe. Mais elle va petit à petit s’avérer infondée. Au conflit avec l’algérie va suivre une tentative de coup d’État contre le roi et une extrême nervosité du côté des officiers qui va entraîner… la libération des «têtes brûlées».
Au-delà de ce terrifiant récit, on comprend entre les lignes comment est née la vocation de Tahar Ben Jelloun, comment la seule décision raisonnable pour lui était dès lors de quitter le pays. On se rend malheureusement aussi compte que depuis ce demi-siècle les choses n’ont sans doute guère changé dans ce royaume. Liberté, j’écris ton nom…
La punition
Tahar Ben Jelloun
Éditions Gallimard
Récit
160 p., 16 €
EAN : 9782070178513
Paru le 16 janvier 2018
Où?
Le roman se déroule au Maroc, notamment à Rabat, Fès, Meknès, El Hajeb, Taza, Abermoumou, Larache, Rmilat.
Quand?
L’action se situe en 1965, puis les mois et les années suivantes.
Ce qu’en dit l’éditeur
La punition raconte le calvaire, celui de dix-neuf mois de détention, sous le règne de Hassan II, de quatre-vingt-quatorze étudiants punis pour avoir manifesté pacifiquement dans les rues des grandes villes du Maroc en mars 1965. Sous couvert de service militaire, ces jeunes gens se retrouvèrent quelques mois plus tard enfermés dans des casernes et prisonniers de gradés dévoués au général Oufkir qui leur firent subir vexations, humiliations, mauvais traitements, manœuvres militaires dangereuses sous les prétextes les plus absurdes. Jusqu’à ce que la préparation d’un coup d’État (celui de Skhirat le 10 juillet 1971) ne précipite leur libération sans explication.
Le narrateur de La punition est l’un d’eux. Il raconte au plus près ce que furent ces longs mois qui marquèrent à jamais ses vingt ans, nourrirent sa conscience et le firent secrètement naître écrivain.
Les critiques
Babelio
Gallimard (entretien avec l’auteur)
L’Express (David Foenkinos)
Revue des deux mondes (Auriane de Viry)
Public Sénat (émission Des livres et vous… présentée par Adèle Van Reeth)
La République des livres
Publikart (Bénédicte de Loriol)
La Vie éco (Fadwa Misk – entretien avec l’auteur)
Le 360.ma (Bouthaina Azami)
Page des libraires (Eva Halgand, Librairie Fontaine Victor Hugo, Paris)
L’invité de Patrick Simonin © Production TV5MONDE
Les premières pages du livre
« En route pour El Hajeb
Le 16 juillet 1966 est un de ces matins que ma mère a mis de côté dans un coin de sa mémoire pour, comme elle dit, en rendre compte à son fossoyeur. Un matin sombre avec un ciel blanc et sans pitié.
De ce jour-là, les mots se sont absentés. Seuls restent des regards vides et des yeux qui se baissent. Des mains sales arrachent à une mère un fils qui n’a pas encore vingt ans. Des ordres fusent, des insultes du genre «on va l’éduquer ce fils de pute». Le moteur de la jeep militaire crache une fumée insupportable. Ma mère voit tout en noir et résiste pour ne pas tomber par
terre. C’est l’époque où des jeunes gens disparaissent, où l’on vit dans la peur, où l’on parle à voix basse en soupçonnant les murs de retenir les phrases prononcées contre le régime, contre le roi et ses hommes de main – des militaires prêts à tout et des policiers en civil dont la brutalité se cache derrière des formules creuses. Avant de repartir, l’un des deux soldats dit à mon père: «Demain ton rejeton doit se présenter au camp d’El Hajeb, ordre du général. Voici le billet de train, en troisième classe. Il a intérêt à ne pas se débiner.»
La jeep lâche un ultime paquet de fumée et s’en va en faisant crisser ses pneus. Je savais que j’étais sur la liste. Ils étaient passés hier chez Moncef qui m’avait prévenu que nous étions punis. Apparemment quelqu’un l’avait informé, peut-être son père qui avait un cousin à l’État-Major. Sur une vieille carte du Maroc je cherche El Hajeb. Mon père me dit : «C’est à côté de Meknès, c’est un village où il n’y a que des militaires.»
Le lendemain matin, je suis dans le train avec mon frère aîné. Il a tenu à m’accompagner jusque là-bas. Nous n’avons aucune information. Juste une convocation
sèche.
Mon crime ? Avoir participé le 23 mars 1965 à une manifestation étudiante pacifique qui a été réprimée dans le sang. J’étais avec un ami lorsque soudain devant nous des éléments de la brigade des «Chabakonis» (Ça va cogner), comme on les surnomme, se sont mis à frapper de toutes leurs forces les manifestants, sans aucune raison. Pris de panique, nous nous sommes mis à courir longtemps avant de trouver finalement refuge dans une mosquée. En chemin, j’ai vu des corps gisant par terre dans leur sang. Plus tard j’ai vu des mères courir vers des hôpitaux à la recherche de leur enfant. J’ai vu la panique, la haine. J’ai vu surtout le visage d’une monarchie ayant donné un blanc-seing à des militaires pour rétablir l’ordre par tous les
moyens. Ce jour-là, le divorce entre le peuple et son armée était définitivement consommé. On murmurait dans la ville que le général Oufkir en personne avait tiré sur la foule depuis un hélicoptère à Rabat et à Casablanca.
Le soir même, l’Union nationale des étudiants du Maroc (Unem) a tenu une réunion clandestine dans les cuisines du restaurant de la cité universitaire où j’ai eu la naïveté de me rendre. La réunion n’était même pas terminée qu’on entendit le bruit des jeeps certainement
alertées par un traître. Les responsables de l’Union suspectaient depuis longtemps que quelqu’un renseignait la police. Un type petit, sec, laid et très intelligent, en particulier, mais dont ils n’arrivaient pas à prouver la collaboration avec l’ennemi. Les policiers
sont entrés, ont embarqué les plus âgés et ont relevé les noms de tous les autres. Je m’étais cru sorti d’affaire… »

Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)
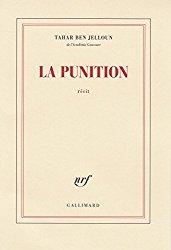


Tags:


