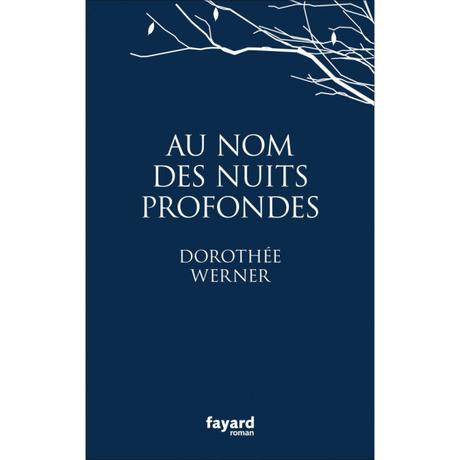
En deux mots:
La drôle de vie d’une «babyboomeuse», d’abord soumise puis se voulant femme libérée, sous l’œil vengeur de sa fille qui s’est sentie deux fois abandonnée.
Ma note
★★ (bon livre. Je ne regrette pas cette lecture)
Au nom des nuits profondes
Dorothée Werner
Éditions Fayard
Roman
180 p., 17 €
EAN : 9782213704814
Paru en août 2017
Où?
Le roman se déroule en France, sans oublier l’évocation de séjours en Angleterre et à New York
Quand?
L’action se situe des années cinquante à nos jours.
Ce qu’en dit l’éditeur
Au début, tout était à sa place. Comme dans les bonnes familles, en parfaite baby-boomeuse, sa mère était passée de fille à papa à femme au foyer. D’abord fière de sa grossesse, et puis désemparée par la maternité. Convaincue de l’infériorité intrinsèque de son sexe, absente à elle-même comme aux autres, elle passait son temps à se plaindre d’un quotidien qui ne valait pas le mal qu’elle se donnait pour le vivre.
Et puis tout a volé en éclats. Quelques années ont suffi pour faire basculer l’époque dans l’égalitarisme. Des femmes en tailleur pantalon deviennent cadres supérieurs, adieu victimes geignant au-dessus des casseroles, le mot « émancipation » est sur toutes les lèvres. Alors sa mère veut, comme tant d’autres, rattraper le temps perdu. Envers, contre tout et dans le désordre.
L’enfant n’a rien compris, mais elle a tout vu, tout entendu. Et un beau jour, une nuit, elle raconte sa version de l’histoire : ce destin de femme ensorcelée par l’appel de la liberté, à ses risques et périls. Une ode poétique et rageuse, un genre de fable, un roman d’amour trempé dans chaque époque traversée.
Ce que j’en pense
«Ton histoire lui a entaillé le cœur dès l’instant où elle est née.»
Selon l’adage, la vengeance est un plat qui se mange froid. Dorothée Werner nous en apporte une belle démonstration à travers cette diatribe adressée à sa mère, loin de toute complaisance, oubliant l’amour éternel qu’elle est censée devoir à sa génitrice, elle est tout à sa rage. «Alors on verra ce qu’on verra».
Et on ne tarde pas à voir. Déversant son fiel, lâchant sa colère en une adresse à la seconde personne du singulier, nous voilà emporté dans un monde pas si lointain où les jeunes filles, puis les femmes n’avaient pas le droit à la parole, où seules comptaient les apparences. Il suffisait « d’échafauder n’importe quoi pourvu que l’ensemble paraisse tenir debout: trahir. Trahir tout et tout le monde, trahir même un salaud, la vérité et aussi le mensonge. Trahir sans foi ni loi, puisque seuls les garçons faisaient leur droit ou leur médecine. On mariait les filles au plus tôt, le mieux possible, il fallait tenir son rang, et puis bon débarras. »
Un traitement jugé naturel qui semblait accepté par cette jeune fille qui passe de boîtes privées en boîtes à bac avec son incontournable jupe bleu marine. Après avoir essuyé les bancs des différents établissements scolaires, elle est envoyée en Angleterre comme jeune fille au pair « larbin chez les autres en attendant le mariage (…) Récurer les enfants des autres avant de se coltiner les vôtres, se faire la main domestique chez les Rosbifs, c’était la norme pour les cuisses de grenouille. »
Victime consentante, elle passe de «de fille à papa à femme au foyer». Et ne tard epas à mettre au monde un premier enfant. «Sentais-tu venir le gouffre qui te tendait les bras?»
Mais c’est alors que le roman bascule. La «parfaite babyboomeuse, absente à elle-même comme aux autres, convaincue de l’infériorité intrinsèque de son sexe» va se rebeller et faire voler en éclats toutes les belles conventions. Le féminisme sera sa nouvelle vocation, l’émancipation, les manifestations, le planning familial… Quitte à un oublier sa progéniture.
« Quelques années ont suffi pour faire basculer l’époque dans l’égalitarisme. Des femmes en tailleur pantalon devenaient cadres supérieurs, adieu victimes geignant au-dessus de leurs casseroles, le mot « émancipation » était sur toutes les lèvres.
Alors elle a voulu rattraper le temps perdu, envers, contre tout, et dans le désordre.
Son enfant n’a rien compris mais a tout vu, tout entendu. Et il fallait bien qu’un jour elle raconte sa version hallucinée de l’histoire: le destin d’une femme ensorcelée, comme tant d’autres de sa génération, par l’appel de la liberté. À ses risques et périls. »
On sent Dorothée Werner meurtrie pour ne pas dire déboussolée face à ce revirement. Mais existe-t-il ce chemin médian qu’elle semble appeler de ses vœux, celui qui voudrait qu’une mère ne soit pas forcément aliénée, celui qui ferait de la working girl une femme affranchie… La narratrice de ce court mais virulent roman devrait méditer ce conseil de Lena Dunham : « Une grande part du combat féministe est de donner aux autres femmes la liberté de faire des choix que l’on n’aurait pas forcément fait pour soi. »
Autres critiques
Babelio
ELLE (entretien avec l’auteur)
Blog Culur’Elles (Caroline Doudet)
Les premières pages du livre
« Tu as tout oublié.
Avec tes camarades, tu te jetais sur le grand portail noir chaque samedi, les poumons emplis d’un fol espoir, le cœur soulevé par l’éblouissante rumeur d’une épiphanie, prête à tout casser. Midi. Sac sur l’épaule, cheveux lâchés et tempes bouillantes, tu guettais la voiture qui, l’adulte qui, les bras qui, loin d’ici, te soulèveraient le temps d’un week-end, ailleurs vers d’autres plaines, au bord d’autres lacs. L’oubli en rafale détruirait les souvenirs. Tu guettais le moindre souffle, tu guettais la force et le baume. Réfectoire, hauts murs de prison, dortoirs javellisés, solitude claquemurée, les cauchemars valseront, qu’on n’en parle plus. Un vol de moineaux : les voitures freinaient. Fenêtres baissées, « Ma chérie », baisers vifs, « Viens mon Paulo », brèves étreintes. Les portières claquaient, « Ta sœur t’attend », clac, « Mon cher petit vieux », clac, pique-nique au programme, cinoche pour les plus chanceux, clac clac, ça redémarrait dans le chaos. Chacun s’évaporait, et puis toi rien. La suie blanche du silence retombait sur la scène soudain glacée. Aujourd’hui encore tu es sur ce trottoir à attendre, avec tes joues rondes de l’enfance éternelle et ton bon cœur qui n’en démord pas. D’où vient ce mystère que l’espoir ne t’a pas quittée ? Tu courais te cacher sous le grand escalier de pierre, à l’entrée de l’institution. Souffle suspendu, tu fouillais encore le murmure de la rue. Un signe, quelque part ? Les gravillons blanchissaient ta jupe bleu marine. Ils piquaient de points rouges tes paumes qui les broyaient. Pour toi personne ne viendrait jamais vraiment. Mais renoncer à croire, plutôt crever. L’œil mauvais, tu t’obstinais. Crispée sur le moindre embryon de bruit, une comptine montait en toi comme une menace, tu fredonnais salement La P’tite Hirondelle. « Qu’est-ce qu’elle a donc fait », soudain la rumeur d’une autre voiture s’approche et te voilà à nouveau aux aguets. Un coup de vent dans les branches de l’arbre, « trois p’tits sacs de blé », l’engin passait son chemin. « Trois p’tits coups de bâton », mâchoires serrées, goût de cendre sous la dent, tu laissais tomber les paroles, la chanson devenait muette. Comme tous les enfants qui toujours viendront, l’enfant à venir sera comme toi à jamais : entièrement tendue vers l’espoir jamais réalisé, vers l’amour qui ne vient jamais par où on l’attend, certaine pourtant, certaine en dépit du bon sens, qu’il était là quelque part, mais où bon sang ? La cloche sonnait et tout continuait. Ou plutôt rien, rien ni personne. Le réel s’obstinait. Tu n’avais pas d’existence, tu n’étais que ce qu’on en pensait. Comme tous les samedis à la même heure, un caillou blanc. Une bonne sœur grasse trottinait vers toi en te houspillant, une oie épaisse empêtrée dans sa robe sombre, des miettes encore collées au coin de la bouche : « Ah te voilà, toi. On t’a déjà dit de ne pas sortir sans autorisation. Rentre ici. Tu te crois où ? »
Extrait
« Comme un siècle auparavant, comme dans des centaines d’années, le vent agite en tous sens l’or sombre des genêts. Vous buvez à la santé du monde, vous trinquez à la grâce et au grand n’importe quoi des Hommes, aux blessures s’évanouissant dans les rafales.
Sous tes doigts, tu sens la pulpe ridée de ta peau. Tu as huit ans, tu as cent ans. Tu sais que le passé n’est qu’une fable, une fantaisie amère. Que la vérité, comme le sens de nos vies, est un torrent de montagne qui toujours se dérobe, coulant entre les cailloux de lave, se diluant dans la nuit. Que seul existe, d’ici on le voit à mille lieues à la ronde, un monde où ce qui brûle l’horizon court aussi dans les veines du moindre bouton d’or. Qu’un reste de l’amour blessé et blessant des mères demeure à jamais dans les lames de lumière poignardant les nuages.
Tu sais aussi maintenant, après « Papa », Dieu et les autres, comment tombe un très vieil arbre au terme de plusieurs siècles d’une vie flamboyante. Sa chute fait un bruit de craquement terrifiant. Un long silence sidéré fige la forêt. Il renvoie au sol une immense quantité de matière vivante, qui le nourrira pour des siècles et des siècles. Pour la première fois, le vide béant laissé par l’arbre permettra au jour de pénétrer le sous-bois. Une clarté inédite déboulera alors par flots continus, donnant à des milliers de formes de vies nouvelles la possibilité d’éclore. Comment ton enfant avait-elle pu grandir en trouvant, dans les recoins de son propre corps, tes sensations les plus intimes ? Pouvait-elle raisonnablement traverser en ton nom la colère, la rage et la haine dont tu n’avais jamais voulu, ô mère, ô toi la Femme et l’Enfance, tes colères et tes chagrins innommés, tes regrets et tes bouquets de violette, toi qui étais sa sœur et sa fille en même temps que sa mère, et qui se sera débattue comme toutes les sœurs et les filles en même temps que les mères? Elle avait écrit en vain. Elle avait trahi en vain. Ton mystère est intact. Un jour, la mort transformera ta vie en un destin français, mais c’est encore trop tôt : pour l’heure tu fumes dans le grand vent, ton vieux cœur tout content, et une petite cantate monte vers toi. Obsédante et maladroite, si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Une petite prière, mais sans un signe de croix. »
À propos de l’auteur
Née en 1969, Dorothée Werner vit à Paris. Elle est grand reporter au magazine Elle.
Après avoir publié A la santé du feu, un premier récit d’une grande force, elle a récidivé en 2015 avec Kouri et en 2017 avec Au nom des nuits profondes. (Source : Babelio)
Commandez le livre en ligne sur Amazon (il suffit de cliquer sur la couverture)




Tags:


